- 著者
- シャルル・イリアルト
- 初版
- 1891年
- 引用サイト
- Google Books
Internet Archive
Wikisource
ÉTUDES D'HISTOIRE ET D'ART
AUTOUR DES BORGIA
ALEXANDRE VI CÉSAR LUCRÈCE

LUCRECE BORGIA
Appartenant à M.Gugenheim
CHARLES YRIARTE AUTOUR DES BORGIA LES MONUMENTS LES PORTRAITS ALEXANDRE VI L'ÉPÉE DE CÉSAR CÉSAR LUCRÈCE L'ŒUVRE D'HERCULE DE FIDELI LES APPARTEMENTS BORGIA AU VATICAN ÉTUDES D'HISTOIRE ET D'ART AVEC IS PLANCHES EN COULEUR, EN NOIR ET SUR CUIVRE, ET 156 ILLUSTRATIONS D'APRÈS LES MONUMENTS CONTEMPORAINS PARIS J. ROTHSCHILD, ÉDITEUR 13 , RUE DES SAINTS-PÈRES, 13 1891 AUTCESAR AUT NIHIL ১১১১০ OFBIBLIOTHE 立 个 * A DON ONORATO GAETANI DUC DE SERMOΝΕΤΑ PRINCE DE TEANO
TABLE DES SOMMAIRES
ÉDICACE. TABLE DES SOMMAIRES. ..... AUTOUR DES BORGIA Pages. V VII Les Monuments des Borgia.- Les Tombeaux.- Investigations.- Viana.- La Mota de Medina del Campo. Excursion à Spoleto.- Sinigallia, Théâtre du Bellissimo Inganno. Faënza. Forli. Imola. Pesaro. Rimini.- Cesena. Premier portrait authentique de César.- Ferrare. Bologne. PREMIÈRE PARTIE LES APPARTEMENTS BORGIA AU VATICAN Les appartements avant Alexandre VI. rà 28 Part prise par le pontife aux embellissements de Rome et à ceux du Vatican.- La Tour Borgia. Les appartements sont-ils lieu d'apparat ou habitation privée? Preuves à l'appui tirées des dépêches des ambassadeurs et des diarii. La salle des Pontifes avant Léon X. État actuel. Le Pinturicchio et les Borgia. Catherine.- Le portrait d'Alexandre VI. La salle de la Viedes Saints. La Dispute de sainte Examen successif des diverses salles. sainte Catherine contient-elle des portraits historiques ? La fresque de Sort des appartements Borgia depuis Sixte V jusqu'à nos jours. Étatactuel.-Projet de restauration dû à l'initiative du pontife Léon XIII. 29 à 76 VIII AUTOUR DES BORGIA. DEUXIÈME PARTIE LES PORTRAITS DES BORGIA Pages. LES PORTRAITS D'ALEXANDRE VI. Les médailles d'Alexandre VI. Portrait d'AlexandreVI. La fresque du Pinturicchio.- Le portrait du muséede Valence (Espagne.) Le buste de Paul II au musée de 87 Berlin. de A. Gordon sur Alexandre VI . Un portrait d'Alexandre VI par le Titien au musée d'Anvers. Les Fresques. Le frontispice de l'ouvrage 77à LES PORTRAITS DE CÉSAR BORGIA. César Borgia d'après les contemporains. Les Médailles.- La Sculpture. Les Estampes. Portraits dans les divers musées.- Le portrait de Bergame.- Ancienne collection Castelbarco de Milan. Imola. Galerie Hope à Deep-Deen. Conclusion Musée de Forli. Museo Civico (Correr) . 88 à 114 LES PORTRAITS DE LUCRÈCE BORGIA.-Monuments cités parGregorovius.-Les médailles- Portrait à Ferrare.- Les Majoliques. portraits gravés. Le Titien de la Galerie Doria Pamphili. Musée de Dresde. Les Un portrait disparu et retrouvé à Londres. Deux nouveaux portraits à Florence et à Venise.- Lucrèce d'après les dépêches diplomatiques du temps. TROISIÈME PARTIE Conclusion . L'ÉPÉE DE CÉSAR BORGIA Ses origines.- Elle vient aux mains de l'abbé Galiani. Son enquête sur César. 115 à 140 Ses projets d'écrire une monographie.- Travail de M. Ademollo relatif à Galiani.- Comment l'arme passe des mains de Galiani à celles des ducs de Sermoneta. tion. Le Fourreau de l'épée. Description de l'épée. Le Graveur. des gravures. Sa personnalité. Les emblèmes. Son caractère. Les Gaetani et les Borgia.- Preuve de l'attribution de l'arme. Leur interpréta Interprétation Traits caractéristi ques du maître.- Essai de catalogue. Armes du même maître dans les diverses collections d'Europe (Paris, Londres, Vienne, Pesth, Berlin, Italie, Russie). Fideli, orfèvre du duc de Ferrare. Son état civil. Dessins du maître à Berlin. Conclusion. Hercule de Documents qui nous révèlent la personnalité de l'artiste. 141 à 209 TABLE DU PLACEMENT des 18 planches hors texte avec indicationdes pagesdonnant leur explication.211 à 212 TABLE DES ILLUSTRATIONS qui se trouventdans le texte.. TABLE ALPHABÉTIQUE. 213 à 215 217 à 220 AUTOUR DES BORGIA I
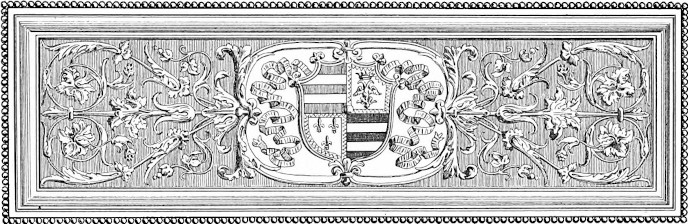
Frise dans le Palais de Ferrare.
AUTOUR DES BORGIA
Les Monuments des Borgia.- Les Tombeaux.- Investigations. Viana. La Mota de Medinadel Campo. Excursion à Spoleto.- Sinigallia, Théâtre du Bellissimo Inganno.-Pesaro. Rimini. Cesena. Bologne. Faenza. Forli. Imola. Premier portrait authentique de César. Ferrare. Après avoir, dans des études dont on n'a peut-être point perdu le souvenir, établi nettement les origines des Borgia, depuis le premier d'entre eux jusqu'au dernier de la race, nous nous sommes attaché à rechercher tous les monuments qui pouvaient rappeler le nom des trois grandes personnalités historiques de la famille, Alexandre VI, César et Lucrèce. Plus ces monuments sont rares, plus ils sont précieux; la vue de ceux qui ont été épargnés par le temps ou la rage des hommes donnera peut-être un peu plus de relief à nos récits. Nous avons suivi lesBorja-c'est leurnom d'origine avant que le doux parler d'Italie en ait adouci la consonnance depuis Jativa, la petite ville maure de la province de Valence qui fut leur berceau, jusqu'au Vatican où deux d'entre eux, Calixte III et Alexandre VI, ont ceint la tiare. Nous les avons cherchés à Spoleto dont Lucrèce fut gouverneur pour lepontife son père; à Pesaro, où elle suivit son premier époux, le seigneurGiovanni Sforza; à Ferrare, où elle vint s'asseoir sur le trône des princes de la Maison d'Este; à Sinigallia, que César a ensanglanté; à Piombino, à Forli, à Faënza, à Imola, à Cesena, à Rimini, dans chacune des cités 4 LES MONUMENTS DES BORGIA. des Romagnes où le Valentinois a combattu ou régné; dans la Castille, à La Mota de Medina del Campo, qui fut sa prison; dans la Navarre, à Pampelune, puis à Mendavia, sur le champ de bataille où le fils d'Alexandre tomba percé de coups de lances dans une obscure embuscade; enfin, jusque dans le chœur de l'église de Viana, où son beau-frère, le roi Jean de Navarre, déposa ses restes dans un sépulcre de marbre. Malgré tant d'efforts, nous n'avons su trouver ni les berceaux ni les tombes.
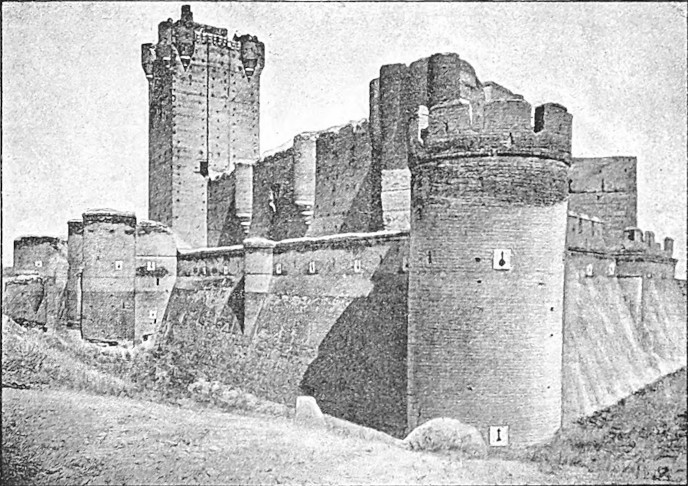
Prison de César Borgia en Espagne (La Mota de Medina del Campo).
Il est possible que les restes d'Alexandre VI reposent sous quelque pierre ano nyme dans les cryptes du Vatican; mais les custodes de Saint-Pierre passent le nomdes Borgia quand ils énumèrent les pontifes dont ils montrent les sépulcres; et l'effroyable récit de l'abandon dans lequel on laissa le cadavre du pontife le jour même de ses funérailles, autorise toutes les suppositions. Aux caveaux de San Francesco, à Ferrare, où reposent les restes des ducs d'Este, pas un nom, pas un écusson, pas un signe ne désigne au voyageur ou à l'historien anxieux de trouver la tombe de ses héros, celle de Lucrèce Borgia; comme si les ducs de AUTOUR DES BORGIA. 5 Ferrare, après sa mort, avaient eu honte d'avoir fait alliance avec l'Espagnol qui avait mis la main sur le Vatican et disposé de l'Église romaine, de ses domaines, de ses privilèges et de la curie tout entière comme d'un patrimoine de famille qu'il partageait avec tous ceux de sa race. Quant aux cendres de César, leur destinée est plus dramatique; il était mort en 1507, et leroi Don Juan de Navarre Vinnerer.SC.
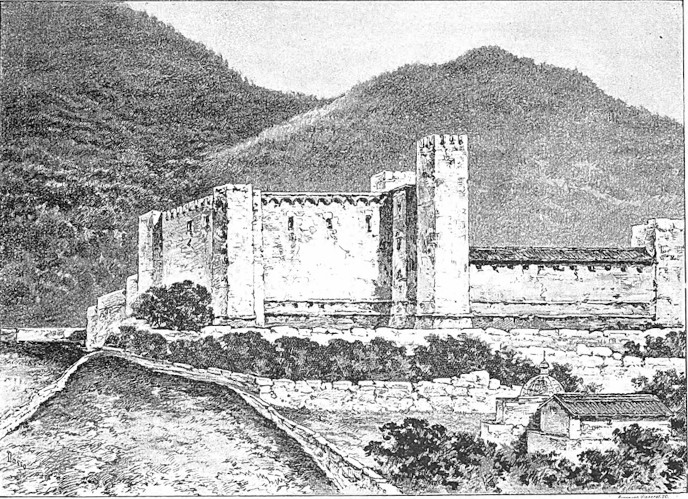
La Forteresse de Spoleto.
lui avait érigé un tombeau « remarquable par les ornements qui décoraient l'urne, sur laquelle on avait représenté en relief et demi-nature, les rois de la Sainte Écriture dans l'attitude de la douleur en face d'un tel trépas. » Don Antonio de Guevara, évêque de Mondenedo, revenant de France en 1523, avait visité sa tombe et l'avait décrite dans son journal de voyage, plus tard dans ses Lettres morales adressées à l'amiral Don Fabrique ; il avait même publié pour la première fois la pompeuse épitaphe gravée sur l'urne, épitaphe due au poète 6 LES MONUMENTS DES BORGIA. Soria et qui fait partie du Romancero espagnol. On savait donc tout de la fin du Valentinois et de sa tombe, le lieu, la forme, la matière du monument, jusqu'au nom de l'artiste qui avait taillé le marbre, le sculpteur Juan de Olozaga, qui, à la même époque, avait orné de quatorze statues le beau porche de la cathédrale de Huesca. Cependant, aux premières années du xvm° siècle, au moment où le Père Aleson, le continuateur des Annales de la Navarre de Moret, allait pour suivre l'œuvre importante que le contemporain de César avait laissée inachevée, il entra dans l'église de Viana et constata qu'il ne restait rien du monument, pas même la place qu'il avait occupée; place que l'évêque de Mondenedo avait dési gnée avec tant d'exactitude. Il ouvrit alors une enquête et apprit qu'à la fin du xvi° siècle, lors d'une restauration générale de l'église de Viana, un évêque de Calahorra, supérieur du diocèse de Viana, jugeant que les cendres de César Borgia étaient une profanation pour un temple chrétien, avait fait détruire le monument et rejeter les ossements hors de l'église. Quand nous arrivâmes á notre tour à Viana après avoir d'abord vainement cherché à Pampelune la tombe de César, où la Chronique de Moret la place, dans le but de voir son monument funéraire (dont nous ne connaissions encore ni la forme décrite par le journal de l'évêque de Mondenedo, ni la disparition constatée par le Père Ale son), nous en constatâmes l'absence à notre tour et nous interrogeâmes les docu ments imprimés et les manuscrits qui pouvaient nous donner la raison de ce fait étrange; l'ayant apprise, nous entrâmes dans l'église afin de voir si quelque fragment n'avait point échappé au fanatisme ou à l'ignorance : ce jour-là, nous pûmes recueillir à grand'peine quelques colonnes et quelques fragments informes. Mais rien n'est tenace comme une tradition, et celle qui subsistait encore à Viana, recueillie et transmise de père en fils depuis la restauration du temple aux premières années du xvm° siècle, nous indiqua trois marches de la terrasse de la Calle de la Rua, en face du porche même de Santa Maria de Viana, comme l'endroit secret où, n'osant pas jeter au vent les ossements d'une créature faite à l'image de Dieu, les iconoclastes du diocèse les avaient déposés. Ceux qui ontsuivi nos études sur César Borgia savent le reste' ; le sol fut fouillé, et, au point même désigné par la tradition, on constata la présence d'un squelette complet à deux mètres de profondeur, protégé sur les côtés par des briques Sa mort. 1.-Voir le chapitre La Tombe de César, pages 277 à 284 (CésarBorgia. Sa vie. Sa Captivité. Tome II. (Paris, J. Rothschild, éditeur, 1889). AUTOUR DES BORGIA. 7 placées verticalement et recouvert sur la face par d'autres briques à plat, non cimentées. Ces restes furent respectés par Don Victor Cereceda , l'alcade en charge qui prit l'initiative de la constatation; ils y sont encore. Nous ne reprendrons point ici le récit de nos investigations en Espagne; Pam pelune et ses archives nous ont donné les documents relatifs à César nommé à quinze ans évêque de ce diocèse; Valence nous afourni la preuve de la captivité de César à Chinchilla, fait ignoré jusqu'à ce jour, tandis que les archives des Basses-Pyrénées nous disaient tout de son mariage avec Charlotte d'Albret. Plus tard la bibliothèque de l'Académie d'histoire à Madrid, les archives des ducs d'Ossuna et les archives de Simancas, nous ont livré tout le procès fait au gou verneur de la prison de la Mota de Medina del Campo, près Valladolid, où Ferdinand le Catholique tint César enfermé depuis 1504 jusqu'à 1507. A Medina del Campo on montre bien encore la chambre ou Jeanne la Folle persistait à rester enfermée en pensant à son beau Philippe, mais il faut beaucoup d'imagi nation pour en restituer la forme, car la Mota n'offre qu'une ruine gigantesque dont nous donnons ici l'image. Du fond des fossés, nous avons pu mesurer la hauteur de cette tour de l'Homenajé, d'où César Borgia, pour s'enfuir, se laissa tomber en se brisant les os; les petits pâtres castillans y font brouter leurs chèvres, et le lieu est devenu un désert. Medina, si riche, si fière d'avoir été deux fois la résidence des rois catholiques et d'appeler à elle les changeurs de toute la Cas tille au temps de ses ferias, n'est plus qu'une ombre et qu'un souvenir. En Italie, partout où ils ont passé, les Della Rovere ont effacé la trace des Borgia ; il y a quelque chose de personnel dans la haine de Jules II pour Alexandre VI. Cependant la mémoire de ce pontife sera bénie, car, tout en jetant une malédiction qui a eu son retentissement jusqu'à nos jours, sur les appar tements Borgia, il a refusé de porter une main sacrilège sur les fresques du Pinturicchio. A peine sorti du Vatican, nous avons cherché Lucrèce à Spoleto où elle tint une année entière dans ses frêles mains les sceaux de l'État pour son père Alexandre, avec le titre de gouverneur. L'aspect général est grandiose; la Rocca s'élève fièrement, dominant la ville tout entière, surplombant d'un côté un pro fond ravin, et se détachant sur les fonds sombres d'une haute colline boisée. La partie basse, vers San Pietro, était la partie militaire, et la partie haute, celle de l'habitation du gouverneur; trois époques bien distinctes se lisent dans l'archi 8 LES MONUMENTS DES BORGIA. tecture : la période gothique, celle du xv° siècle avec les dispositions prises par les fameux ingénieurs militaires de ce temps, et celle du xvi , où çà et là une fresque du Spagna et quelque bel écusson monumental peints sur les murs relèvent un peu l'âpreté d'aspect du monument; mais ces décorations sont pos térieures à Lucrèce : elles furent ordonnées par son successeur, et c'est en vain qu'on chercherait les réduits élégants qu'elle avait fait approprier. La résidence d'ailleurs est transformée en bagne, et pas un entrelac, pas un emblème, pas un écusson ne rappelle la fille de Borgia aux lieux où elle représenta le pouvoir pontifical, au grand scandale de toute l'Italie. Pesaro, où Lucrèce fut reine, conserve encore et son palais seigneurial, et la rude forteresse où se réfugia son premier époux, Giovanni Sforza, fils naturel de Costanzo di Pesaro,comte de Cotignola et vicaire de l'Église pour la ville. Gio vanni, âgé de vingt-six ans, au lendemain de son mariage avec la fille d'Alexandre qui n'en avait pas encore treize, et au sor tir du palais de Santa Maria in Portico, où son union avait été consacrée en présence
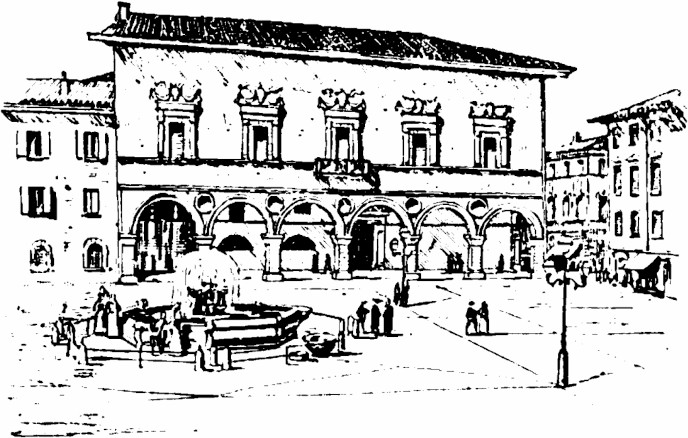
Palais de Pesaro.
mêmedupontife, avaitconduitlajeuneprin cesse dans le palais de Pesarooùil avait tout préparé pourla recevoir. Là encore nous devrons trouverla trace de Lucrèce; on a la description des fêtes célébrées dans la résidence; on sait dans quelle partie de ce beau palais, à façade simple et noble, dans le goût antique renou velé par les architectes du xv° siècle italien, se trouvaient les pièces que Gio vanni avait destinées à sa jeune épouse; nous y avons donc pénétré avec une sorte d'émotion, bien qu'elles aient été converties en offices de la Préfecture; mais en étudiant avec soin les emblèmes, l'esprit des compositions picturales encore bien conservées, nous avons éprouvé la même déception qu'à Spoleto. A Pesaro , tout parle des Montefeltre et des Della Rovere, les seigneurs d'Urbin, auxquels la justice ou la rancune de Jules II rendit le duché d'Urbino et la seigneurie de Pesaro enlevés aux Borgia. La grande salle des fêtes qui occupe toute la façade sur la grande place de la ville, avec son plafond aux mille compartiments criblés d'armes, d'écussons et d'Imprese, ne montre pas une fois le bœufdes Borgia ni les armoiries des Sforza. Partout on voit l'Hermine, AUTOUR DES BORGIA. 9 les Trois piles, la devise : Feretria Hic Terminus Hoeret, ou bien le Rouvre à glands, l'arbre des Della Rovere avec les Palmes. Dans la partiecontemporaine de Guidobaldo, duc d'Urbin , c'est le symbole de ses armes, la Bombe renversée, qu'on retrouve dans la cour intérieure sur les clés des voûtes et celles des grandes baies. Dans la belle salle, aujourd'hui de la Sicurezza Publica, où Bandani, sculp teur illustre de la région (Stucatore), a élevé des portes monumentales et une
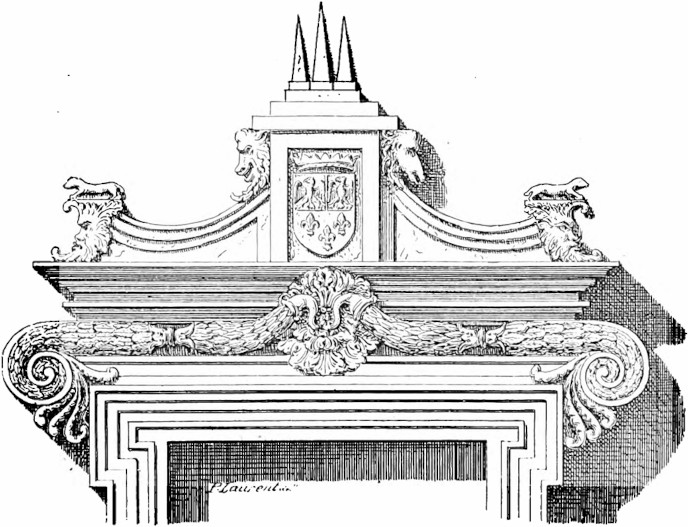
Porte dans la Salle de la Sécurité publique (Palais de Pesaro).
cheminée colossale pleines de caractère, c'est aussi l'Hermine et les Trois Bornes qui impriment à la construction le cachet des Montefeltre. Trois chambres cependant, désignées sous le nom : appartamento di Madama pourraient donner le change sur leur attribution, et on ne se fait point faute de les désigner comme celles où résida Lucrèce ; elles ne sont point les siennes, la lettre W, et la flamme renversée désignent la duchesse Victoria et le duc ; c'est Girolamo Genga et son fils Bartolomeo qui ont orné les appartements pour les successeurs de Giovanni Sforza, et les lettres G. V. D. V. X. sont celles du nom de Guidobaldo Dux. La forteresse cependant, l'une des plus renommées d'Italie, qui figure au revers d'une médaille célèbre, porte encore le nom de Joannes Sforza le mari de 2 r 10 LES MONUMENTS DES BORGIA. Lucrèce. César fut si fier de posséder cette Rocca contre laquelle ses efforts échouèrent d'abord, que le jour même où il y entra il la fit dessiner par un des peintres qui suivaient son camp et l'envoya à Alexandre VI. La forteresse, comme presque toutes celles de cette période, est aujourd'hui convertie en prison. Avant Pesaro j'avais visité Sinigallia ensanglantée par César, théâtre célèbre du Bellissimo Inganno. Encore aujourd'hui, quandon prononce le nom de Sinigallia , l'imagination évoque le nom de Borgia et l'associe au nom de Machiavel qui, en se faisant l'historien du guet-apens sublime, s'arrête en extase pour le juger en artiste et l'admirer comme le chef-d'œuvre du genre. Sinigallia cependant est aussi muette, et nous allons ainsi de ruine en ruine sans jamais trouver le nom des Borgia gravé sur la pierre, attestant leurprésence aux lieux où l'imagination les place parce qu'ils les ont marquésd'un sceau couleur de sang. J'ai parcouru Sinigallia sous les auspices du comte Marsi qui m'avait remis aux mains du chevalier Benedetti, président du comité de la bibliothèque de la ville. J'ai cherché d'abord le pont sur le Misa, à la porte même de la ville, où Micheletto Corella, le bourreau, l'âme damnée de César, passa le premier pour prendre possession des logements militaires laissés vides par l'un des capitaines de Borgia, Oliverotto, le plus important des conjurés avec Vitelli et Orsini. La tradition est morte et bien morte ; personne n'a pu me montrer ce qu'on appelait le palais de la Seigneurie, tout a changé dans cette ville qu'on aurait pu croire immuable, et la vie s'est retirée, depuis les jours fameux où de tous les points de la côte orientale accouraient les marchands de l'Orient, comme on y voyait affluer les banquiers de toute l'Italie. On lit encore au coin des rues les noms de Candie, de Zante, de Cephalonie ; l'Albanie et le Montenegro lui-même étaient représentés àla feria de Sinigallia; on comprend bien enparcourant laville qu'elle devait être alors un immense caravansérail où chaque nation avait ses fondaks, ses quartiers et ses rues, où la foule bariolée parlait les idiomes divers, où les types et les langages se confondaient, et où tous n'avaient qu'un espoir et qu'un but : le gain etl'échange. Le sol lui-même de la ville a changé comme dans toutes ces régions qui abou tissent à la mer par un port-canal; la fameuse citadelle de Sinigallia a triomphé du temps; masse rougeâtre de forme circulaire, elle semble avoir été construite dans un fossé très en contre-bas de la ville. C'est là qu'était le palais du Duc, et la place sur laquelle il s'élevait porte encore ce nom . Là, César laissa $ AUTOUR DES BORGIA. II entrer un à un ses chefs rebelles après leur avoir tendu joyeusement la main au delà du pont sur la Misa, les accueillant à pied, sans armes, afin de ne pas les mettre en défiance; là fut la prison, là s'accomplit le meurtre ; et quelques jours après, Vitellozo et Oliveretto, les instigateurs de la conspiration des condottieri, étaient étranglés sous les yeux de Michelotto, le bourreau de César, qui faisait porter les corps des suppliciés à l'église de l'Hôpital de la Miséricorde. Au cours de ces investigations nous sommes entré, sur la place du Duc, dans un petit palais de dimensions très restreintes, à un seul étage, entouré d'un petit Porticato qui a conservé tout son caractère, et mériterait à lui seul une mono graphie. Un bâtard d'un duc de Bavière, à une époquetrès reculée, au temps des Hohenstaufen, serait venu se fixer dans la région, à Urbino, et aurait fait souche ici . De tout Sinigallia c'est le lieu le plus orné, celui où on sent le mieux une préoccupation de l'art et du décor : l'entrée est très modeste, et du dehors rien ne fait pressentir une telle recherche ; on entre d'abord dans un vestibule qui, malgré ses proportions restreintes, affecte des airs de salle des gardes et sert d'antichambre à un appartement tout entier. L'esprit qui présida à la décoration de ce pied-à-terre d'un grand seigneur rappelle celui qui animait les artistes employés par les ducs d'Urbin, les Gonzague et les Este, portés à s'abstraire et à se reposer par l'étude dans de petits coins exquis où on prodiguait l'ornemen tation. Toutes les pièces sont ornées de compositions en stuc à haut-relief, tirées de l'histoire de la Grèce et de la Genèse avec des légendes en grec, dont le caractère sculptural, très ronflant, quoique les figures soient de petites dimen sions, rappelle Alessandro Vittoria; on les attribue, je crois, à Bandani, célèbre dans toute cette région. Les chambres communiquent par des portes basses, car rées, dans le caractère du xv° siècle, et sur le linteau, deux lettres, I. B. flanquent l'écusson du personnage qui a construit ce délicieux réduit à l'angle même de la place du Duc. Un érudit de la région devrait se vouer à la restitution de ce petit monument bieninattendu dans ce coin de Sinigallia. A la Bibliothèque communale, qui a peu d'importance, un aimable canonico me fait les honneurs de la collection et met sous mes yeux un volume du fils de Leopardi Giacomo, le poète qui a célébré le charme de la mort; Manaldo Leopardi a retracé la vie de Nicolo Bonafede évêque de Chiusi, une sorte de con dottiere tonsuré qui resta fidèle à César Borgia dans la mauvaise fortune. On trouve Bonafede au chevet de Borgia le jour où, frappé de la même affection qui venait 12 LES MONUMENTS DES BORGIA. d'emporter le pape son père, le Valentinois, grelottant la fièvre, se fit porter de son palais au Vatican pour saisir le trésor du Vatican et organiser sa propre défense contre tous ceux qui vont se lever contre lui à la nouvelle de la mort d'Alexandre VI. Bonafede fut encore l'agent énergique de César pendant le conclave où les cardinaux espagnols de son parti devaient faire avec lui une transaction pour éloigner le futur Jules II et nommer Piccolomini (Paul III) qui ne règna que vingt-sept jours. Le jour même de l'élection de ce nouveau pontife, César qui avait repris confiance et crédit par cette élection fit nommer son complice gouverneur de Rome. De la bibliothèque nous allons visiter le couvent des Pères de l'Observance, Santa Maria delle Grazie' ; en avant du chœur la première chose qui frappe nos yeux, c'est une inscription monumentale : le nom et le titre de Jean Maria della Rovere, neveu de Sixte, propre frère de Jules II, marié à la duchesse d'Urbin, fille de Frédéric de Montefeltre. A Sini gallia comme ailleurs, César n'est qu'un météore, mais sa trace reste dans l'histoire, et c'est une tache de sang. IMINI. A Rimini, nous sommes toujours dans le cercle d'action de César Borgia; éphémère y fut son pouvoir, mais ses actesy furent nom breux et ses tentatives immédiates. L'historien de Rimini, continuateur de l'œuvre considérable de son père, Tonini, nous montre à la Bibliothèque les documents originaux par lesquels César rend lajustice. Le Valentinois n'a point pris Rimini de vive force; lorsqu'il attendait l'occasion d'attaquer, un mouvement seproduisit en sa faveur et le conseil de la commune lui dépêcha un des siens, Simon Paci, pour lui demander ses intentions. Le temps des grands capitaines dans lesquels César eut trouvé sinon un maître au moins un rival, était passé depuis longtemps ; de toute cette lignée de condottieri fameux, les Carlo, les Pandolphe et les Sigismond Malatesta, il ne restait que leur petit-fils, Pandolphe, désigné par le peuple lui-même, sous un nom méprisant « Pandolfaccio » . Les Vénitiens, protecteurs de Rimini, parce que là était leurintérêt, avaient retiré leur I. Je signale en passant aux amateurs et aux historiens de l'art, dans ce sanctuaire, un Pérugin important, et un petit tableau circulaire sans grande valeur d'art, mais d'une certaine saveur, qu'on peut donner, non pas à Fra Carnovale, mais à son école. Ce sont là les modelés fins, le pli sec, les colorations gris ardoise qu'on retrouve dans le beau portrait de Frédéric d'Urbin du musée Brera, et dans la Vierge qui faisaient partie de la petite collection du marquis d'Azeglio à Turin. CAES BORGIE DEER AUTOUR DES BORGIA. 13 appui ; époux de Violante, fille du seigneur de Bologne Bentivoglio, Pandolphe ne pouvait guère compter sur son beau-père dont César menaçait aussi le trône : il était donc là, hésitant, se demandant à qui, de Venise ou de César, il vendrait le plus cher la seigneurie : il ne tenta même pas de la dé fendre, et ce fut assez de quelques heures pour régler les conditions de la prise de possession de la ville. Pandolphe était enfermé dans la Rocca de Rimini, les envoyés de la commune lui pré sentèrent l'acte de reddition de la ville, on y stipulait une indemnité personnelle de 2900 du cats d'or, en dehors du prix des munitions et de l'artillerie dont on prenait possession; le prince signa sans hésiter. Tel était l'avilissement

Sceau personnel de César.
de ce Pandolfaccio qu'à peine arrivé à Ravenne il écrivit au procurateur ducal, représentant de César à Rimini, pour lui redemander un chien qu'il avait oublié. César a organisé le pouvoir à Rimini, il y a régné, il y a légiféré, et le souvenir qu'on y garde de lui donne à réfléchir, surtout quand on tient dans la main les originaux des décisions judiciaires qui sont conservés à la bibliothèque de la ville; mais s'il organisa et fit bonne justice, il n'eut pas le temps d'édifier; et, quoiqu'il ait fait graver un sceau à ses armes, avec, en exergue, la constatation de la prise de possession du pouvoir, la ville aujourd'hui ne montre plus un monument auquel son nom puisse se rattacher. De Rimini à Cesena, il n'y a qu'un pas; la ville de Malatesta. Novello , grand constructeur étant donné l'exiguïté de ses États et de ses ressources, porte surtout le cachet de ce jeune frère de Pandolphe, qui y a laissé un palais , l'hôpital du Crucifix (dont la cons truction est rappelée par le revers d'une superbe mé daille de Pisanello), et une bibliothèque construite par Matteo Nuti , l'architecte qui représenta Leon Battista Alberti dans la cons truction et la direction des travaux du fameux temple de Rimini.

Sceau de César Borgia à Rimini.
ALENTINI CAES 14 LES MONUMENTS DES BORGIA. Cesena a été fécond pour nous en ce qui touche César, au point de vue des livres et documents écrits ; nous avons tenu là dans nos mains des manuscrits ayant appartenu au Valentinois; ces manuscrits sont pour la plupart des poésies et des panégyriques dus aux clients et familiers qui se groupèrent autour de lui dès qu'il assuma le pouvoir dans les villes de Romagnes; ils sont dus à Vincenzo Calmeta, à Pier Francesco Justolo, Francesco Sperulo, Battista Orfino et Fran cesco degli Uberti. Ce dernier manuscrit est le plus personnel de tous ceux que j'ai feuilletés : il porte le cachet et les armes de César et nombre d'épigrammes qui jettent un jour sur les faits et les ten dances du Valentinois.
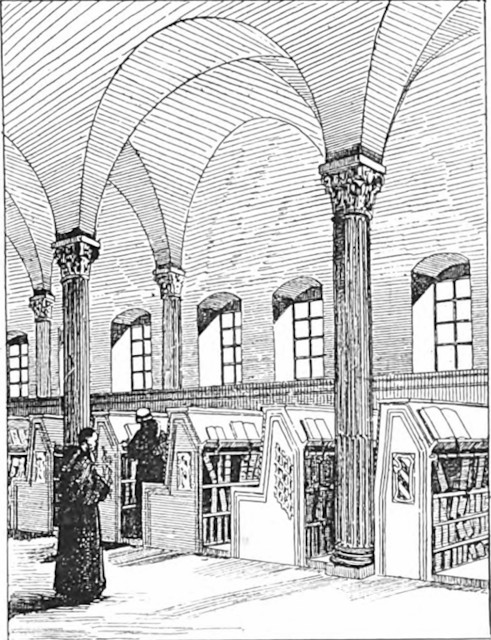
La Bibliothèque de Cesena.
Du palais que Matteo Nuti avait construit pour Novello, rien ne reste qu'une façade sévère, et la fameuse Rocca de Cesena, pro bablement contemporainedecelle de Rimini, masse énorme qui commandetoute la ville, où César enferma son illustre prisonnière, Catherine Sforza, après la prise de Forli ; elle reste intacte au point de vue de l'aspect extérieur, mais, convertie en prison, comme Spoleto , comme Rimini et la plupart des forteresses du même type en Italie; il n'y a point à chercher là de témoignages vivants des faits de l'histoire; on ne peut qu'en constater la dimension énorme, et la disposition conforme à celle adoptée dans ces régions et conçue par Roberto Valturio, l'auteur du Re Militari, collaborateur des princes du temps et des condottieri fameux. J'ai déjà décrit longuement la fameuse bibliothèque, la Malatestiana, dont la fondation suivit de près celle de la Laurentiana de Flo rence, et où les manuscrits magnifiques, tous sortis des mêmes mains et spécia lement commandés par Malatesta Novello, restent encore enchaînés aux pupitres sculptés aux armes du seigneur du lieu, avec ses Imprese, la grille et l'éléphant. C'est désormais un musée plus qu'une bibliothèque, mais en entrant dans cette grande salle solitaire d'une architecture sévère, on évoque facilement le temps où, avant la découverte de l'imprimerie, les studieux venaient occuper leur AUTOUR DES BORGIA, 15 place et lire les commentaires de César et le Dittamondo ou les Moraliæ de Plu tarque. On se demande par quel prodige de discipline ou par quel prodige de prévoyance, dans ces villes des Romagnes siardentes (sur les murs desquelles nous lisons en passant des exclamations vengeresses imprimées furtivement la nuit : « Ο Oberdank, ti vindicheremmo! »), sous la rude main d'Augereau qui tint la population frémissante au moment de l'invasion française, on a pu con server intact cet admirable souvenir, ce type d'une bibliothèque aux premiers temps de la Proto-Renaissance italienne. Ce n'est point ici le lieu de parcourir ces villes en voyageur et de les décrire comme le ferait un guide préoccupé des arts et des lettres ; notre but est spécial, nous cherchons les Borgia, sans en trouver jamais, hélas ! que des traces à peine visibles ! Mais ce pèlerinage aux lieux où ils ont passé n'est pas sans charmes malgré les déceptions de chaque jour. Se trouver au commencement d'un prin temps d'Italie, assis, solitaire, sur une place publique d'une petite ville his torique comme Cesena, au sortir de cette bibliothèque de Matteo Nuti, un vrai sanctuaire où, en compagnie d'un savant italien au nom plein de souvenirs, un Piccolomini, on vient de feuilleter les beaux manuscrits tracés par la main d'un Amanuense du couvent de San Marco ou de San Lorenzo de Florence par com mission d'un Médicis; voir passer les belles filles romagnoles, un peu fortes, ramassées, coiffées à l'antique, qui se rendent à la fontaine, monument tour menté aux formes ronflantes qui sedétache sur les fonds sévères dela rude forte resse de Malatesta Novello ; et là, tout plein des souvenirs de la Storia Patria, évoquer tour à tour les grandes figures qui peuplent l'histoire de la petite cité, celui de ce doux et fier Novello, un lettré, un artiste et un soldat valeureux, le Dux Equitum Prestans des médailles de Pisanello, et celui de César Borgia son successeur éphémère, violent et superbe, entouré de ses capitaines, entrant en vainqueur, salué sur la place de Cesena par Francesco degli Uberti dont on vient de lire le panégyrique enthousiaste; et voir enfin passer dans les brumes de sa pensée un livre qui va naître : c'est une des émotions les plus douces qu'on puisse éprouver : Salve Italiam O Splendor Dux Illustrissime Cesar, O Salve Cesar, Maxima fama Ducum! En une heure et demie nous passons de Cesena à Forli; un vieillard plein de respect pour les souvenirs de l'histoire, le marquis Merlini, nous reçoit au seuil MASELT FOR MO 16 LES MONUMENTS DES BORGIA. de son domaine et nous montre les archives qui ne sont point encore classées. La Bibliothèque cependant possède des mémoires et des chroniques manuscrites et un long Compendium qui relate toute l'histoire de Forli, d'après les chroniques locales conservées dans la région. Le Musée, bien installé, offre de l'intérêt au point de vuede l'école locale, qui compte unartiste admirable, Melozzo de Forli. Le catalogue indique un Portrait de César Borgia, par le Giorgione (N° 1100, om,33 haut. sur om, 40 larg ). Le directeur du Musée, M. Antonio Santarelli, ne

Catarina Riario-Sforza (Médicis).
connaît point l'origine de l'œuvre, donnée à la Ville par le Commandeur Pietro Guarini. Voilà bien une pièce pour le dossier des portraits de César, et nous en prenons acte pour la reproduction; mais il est impossible de se faire illusion au sujet de l'authenticité de ce portrait. Quand, dans une enquête comme celle que nous faisons ici, on lit dans un catalogue ce nom flamboyant de César, dans un catalogue d'un musée comme celui de Forli, où César a vécu et régné, on tres saille d'aise; mais on tombe de haut quand on examine, et on désespère quand on compare. On trouvera au chapitre spécial consacré aux portraits du Valentinois les raisonnements qui nous portent à repousserce document. La Chapelle de San Biaggio prend un intérêt considérable par une œuvre sculpturale pleine de saveur, la tombe d'une Ordelaffi, femme d'un Manfredi, AUTOUR DES BORGIA. 17 morte à vingt-deux ans. La figure couchée sur la tombe, les bras croisés, nous la montre dans sajeunesse et sa beauté, coiffée à l'Isotta; on pense en la voyant à l'œuvre magistrale de Jacopo Della Querciadela cathédraledeLucques.Marcus Palmegianinus a signé la coupole de la chapelle où les prophètes se détachent sur des fonds bleus lapis piqués çà et là de fleurettes et de guirlandes tenues par de délicieuxputti. Mais c'est aux portes de la ville même qu'il faut aller chercherles témoins de la grande lutte soutenue par Catherine Sforza contre CésarBorgia; dans cette forte resse de Forli que cette femme héroïque eut à défendre contre ses propres sujets d'abord et bientôt contre le Valentinois. Forli ne devait point résister, celle qui gouvernait la ville pour son fils, laveuve de Girolamo Riario, n'avait tenu aucun compte du décret du Vatican qui sommait les vicaires pontificaux ou représen tants du pouvoir suprême dans toutes les Romagnes de remettre à César les rênes du gouvernement; son armée étaittrop faible pour résister, sonpeuple, quidétes tait le joug des Sforza, était décidé à ouvrir les portes de laville; elle l'abandonna et se réfugia dans la forteresse; là quand elle apprit la reddition, elle ordonna de retourner sa propre artillerie contre ses sujets, la fitpointer surlepalais de la com mune et en détruisit la Tour. A partir de cejour ce fut un duel entre Catherine réfugiée derrière les murs et César qui l'assiégeait en personne. Catherine résista depuis le 28 décembre 1500 jusqu'au 12 janvier à tous les efforts de l'artillerie, elle était aux remparts encourageant les soldats, et quand la brèche eut donné passage à l'ennemi, elle s'enferma encore plus étroitement dans le Maschio, cette tour carrée intérieure, lisse, formidable défense qui n'offre pas une saillie à l'attaque. Catherine, bloquée, alla jusqu'à ordonner de faire sauter les murailles en mettant le feu aux munitions ; cette résolution la perdit; le capitaine de César, Yves d'Allègre put entrer sur les décombres ; César, l'ayant suivi, se trouva en présence de la sublime virago, qu'il affecta de traiter d'abord avec la plus grande courtoisie. Catherine sortit de la forteresse à cheval, avec tous les hon neurs de la guerre, entre le Valentinois et Yves d'Allègre, montée sur une jument blanche, la tête couverte d'un long voile, comme on la voit représentée dans une de ses médailles. Surla murailled'aujourd'hui, reconstruite par ordrede César par son directeur des fortifications, qui n'était rien moins que Léonard de Vinci, s'étale encore aujourd'hui le grand écussondes Borgia aveclacouronne ducale, les lys de France 3 18 LES MONUMENTS DES BORGIA. et les clés pontificales. En descendant dans le fossé on comprend comment, étant donnés les moyens del'attaque et ceux de ladéfense, les deux ennemis, l'un abrité derrière ses fascines au pied de la muraille, l'autre en haut sur le chemin couvert pourvu de merli ou créneaux, pouvaient s'interpeller mutuellement et répondre aux sommations, et on peut évoquer par l'imagination les acteurs de cette scène tragique. En lisant à la bibliothèque de Forli la chronique manuscrite d'Andrea Bernardi de Forli, on reconstitue sans peine le drame qui se passa là, le 26décembre 1500, avant l'attaque de l'artillerie, alors que César, voulant ménager le sang de ses soldats et s'éviter un as saut meurtrier, vint deux fois de suite, à cheval, aux pieds de la muraille et appela Catherine au rempart en l'avertissant du sort qui l'attendait, si elle le forçait à l'attaque de vive force. 2 BORGIA E FRANCIA VALLENROMANDIOLAE DVCISAC S-RE GONF ETCAP GENERALIS Toutes ces petites villes des Romagnes, si plei nes de souvenirs, qui constituaient autrefois des seigneuries taillées à coups d'épée dans le terri toire pontifical et échappaient presque toujours à l'investiture du Vatican ou à celle de l'empe reur, Rex Romanorum, passant de l'un à l'autre suivant leur intérêt personnel, selon qu'ils étaient aux Guelfes ou aux Gibelins, sont échelonnées

Armes de César encastrées dans la Muraille de la Forteresse de Forli.
ainsi le long de la rive Adratique, et on passe de l'une à l'autre en une heure à peine. Si elles ont toutes un air de famille, et si c'est bien la même race qui les habite, chacune a gardé son caractère; elles se recommandent toutes par une haute culture presque aussi avancée que celle des villes de la Toscane, phénomène rare, unique, dû certainement à la division des territoires et à la multiplicité des cours prin cières; nulle part on ne trouve la province. Entre Urbino et Bologne la chaîne de la civilisation nulle part ne se brise : Bologne est plus docte et plus ornée, Urbino offre quelque chose de plus rare, Rimini est plus concentrée, plus essen tiellement grecque et latine, mais la plus humble a eu sa célébrité d'un jour, compte ses illustrations dans toutes les branches, artiste, capitaine ou philo sophe ; et c'est souvent le prince lui-même qui conduit le chœur. AUTOUR DES BORGIA. 19 En trois quarts d'heure on passe de Forli à Faënza; là encore on trouve César, mais il n'y a guères que la forteresse qui y parle de lui. Si quelques autres villes de Romagne qu'il a soumises ou reçues à merci ont gardé de lui bonne mémoire parce qu'il y fit prompte justice, qu'il fut doux aux petits et im pitoyable pour les grands qui pressuraient le peuple, ici sa mémoire est exécrée; il fut traître à sa parole et implacable dans sa cruauté. Faënza eut la gloire de lui résister longtemps ; la cité vivait sous la domination des Manfredi, Astor III, le prince qui régnait au moment où César menaça la ville, avait dix-huit ans à peine ; on l'aimait pour sa grâce, sa jeunesse, sa bienveillance et sa beauté. Aux premiers jours de novembre 1500, un capitaine de César, Vitellezzo Vitelli, occupa Brisighella qui était la cléde Faënza, et le 10, César lui-même seprésenta, offrant la vie sauve aux assiégés. Les Faëntins refusaient; le 20 novembre, dans une lettre adressée au duc d'Urbin et datée « du camp pontifical devant Faënza » , Borgia raconte la dramatique défense faite par les citoyens qui le forcaient à se retirer dans ses quartiers d'hiver. Le 21 janvier il revint et essaya de s'emparer des bastions par surprise; il échoua encore. Les femmes de Faënza dans cette lutte, la plus longue que César ait eu à soutenir pendant toute la campagne des Romagnes, se couvrirent de gloire: elles avaient à leur tête la fille d'un soldat, Diamante Jovelli, qui avait organisé les ravitaillements en vivres, en matériaux et munitions et travaillait la nuit à réparer les brèches. Isabelle d'Este, toujours intelligente, brave, pleine de cœur et éprise d'honneur et de justice, écrivait à la date du 20avril 1501 à son mari, le marquis de Mantoue : « Les Faëntins ont sauvé l'honneur de l'Italie ; » César lui-même s'écriait: « Que n'ai-je une armée tout entière de Faëntins, j'entreprendrais la conquête de l'Italie. » Le 25 avril cependant, il fallut se rendre ; on nous a montré à la Bibliothèque communale de Faënza, au milieu de tous les livres manuscrits et documents relatifs au siège, à côté du recueil les Annales Faentines, la convention signée par Battista Orfino au nom de César. Le Valentinois fut hypocrite en face de ce beau Manfredi qui avait au front la double couronne de la vaillance et du malheur; il le félicita, lui ouvrit les rangs de son état-major et lui donna sa propre tente; plus tard il fut cruel, il l'envoya à Rome où le prince resta enfermé au château Saint-Ange près d'une année. Quand il le revit, comme César son modèle qui avait eu peur de Vercingétorix, Borgia eut peur de Manfredi; Astor était trop jeune, trop beau, trop aimé et regretté de ses sujets ; il craignait un soulèvement du peuple en sa 20 LES MONUMENTS DES BORGIA. faveur. Le 9 juin 1502 leTibre rejetait le cadavre du jeune seigneur de Faënza, il portait une baliste au cou : « Il était si beau de forme et de stature, dit le maître des cérémonies d'Alexandre VI, dans son journal, qu'on n'eûtpointtrouvé son pareil entre mille. ) A côté de ces souvenirs historiques rendus plus vi vants par la vue des lieux où ils se sont passés, Faënza offre de l'intérêt par ses églises etson musée; on peut dire qu'il y a là une école. Donatello est représenté par deux œuvres, l'une desho norée par la peinture dont elle est revêtue, l'autre un charmant Saint-Jean d'une maigreur ascétique qui a ap partenu à ce collectionneur du xv° siècle, chevalier de Malte, correspondant d'Isa belle d'Este , Saba de Cas tiglione, dont MM. Bonnaffé et Alexandro Luzio ont pu blié les lettres. Faënza d'ail leurs est riche en sculpture : dans sacathédrale Benedetto da Maiano a élevé un su
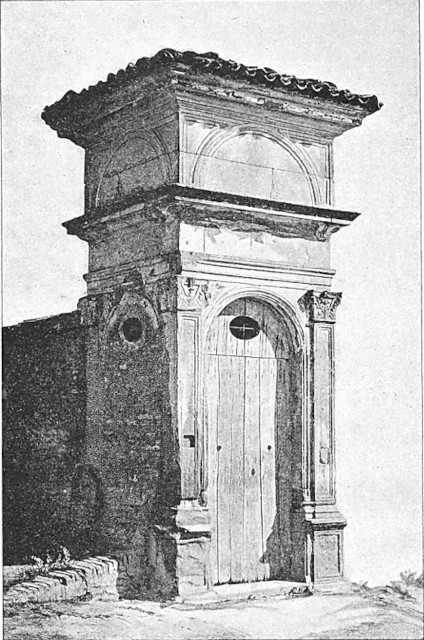
Édicule faisant partie de la Valentine (Fondation de César Borgia à Imola).
perbe monument à un des évêques, et un artiste peu connu et qui suit les erre ments de Sansovino, Bitolto, a taillé au Campo Santo une énorme machine qui rappelle les grandes compositions de marbre de Santa Maria del Popolo. Je passe ici Ravenne, mais je n'évite point la ville : je l'ai déjà décrite et je l'ai illustrée dans le volume LesBordsde l'Adriatique, maisj'ai hâte d'arriver à Imola, AUTOUR DES BORGIA. 21 mon objectif spécial. Je m'y suis rendu cette fois par une voie nouvelle que je recommande aux voyageurs, par le tramway qui, en une heure et demie, mène à la ville de Théodoric par des plaines fertiles, en suivant le cours du Ronco. Je revois au passage le champ de bataille de Ravenne, où Gaston de Foix tomba enseveli dans son triomphe, et cette belle colonne des Français élevée par les Vénitiens et digne du Léopardi ou des Lombardi par la forme exquise de ses ornements. En deux heures et demie de chemin de fer, on va de Ravenne à Imola ; c'est au comte Codronghi et à sonfrère M. Alessandretti, alors syndic de la ville, que je dois la bonne fortune qui devait m'échoir dans cette ville. En ces sortes d'enquêtes l'archivio et la bibliothèque sont l'objet du premier pèlerinage; la bibliothèque d'Imola a son prix, j'y feuillette de beaux manus crits : un Dante mutilé duplus hautprix, des documents duTasse, et au Commune où sont les archives, je trouve déjà préparé tout ce qui regarde César et qui me peut intéresser. Les documents sont nombreux, voici d'abord les chapitres de la capitulation d'Imola, les brefs d'Alexandre VI présentant son fils aux populations comme son représentant, des recommandations sévères de César Borgia à ses commissaires des Romagnes, des lois, des arrêtés signés de sa main, des ordres sévères de faire « bonne et promptejustice », toute une série de papiers d'État qui révèlent un administrateur équitable et un prince à la main ferme. Je passe sous silence huit lettres importantes du grand condottiere de Padoue, le Gattamelata, d'autres des Ordelaffi et des Manfredi ; tout cela bien tenu et bien présenté pour l'étude prompte et sûre. Mais j'ai hâte d'entrer dans la forteresse, encore qu'il faille de l'imagination pour se représenter le héros en action dans ces monuments abandonnés ou restaurés. Imola s'est rendue à César le 24 novembre 1499; la capitulation fut signée le 26, César y entra le 27. Mais il faut remarquer que la forteresse était indé pendante de la cité; c'est là, comme toujours que devait se concentrer la défense ; elle avait été confiée par Catherine Sforza,qui avait reçu Imola en dot et régnait à Forli comme veuve de Riario Sforza, à Dionigi di Naldo; celui-ci accomplit sa tâche et fut forcé de se rendre le 13 décembre. La forteresse d'Imola est identique pour la forme à celle de Forli, c'est un quadrilatère avec quatre tours aux angles, et des remparts au sommet pour la défense. Au centre s'élèvent les casernes et réduits, et le Maschio, la haute tour où se réfugient endernier ressort celui qu'on protège et celui qui commande. Les seuls 22 LES MONUMENTS DES BORGIA. écussons encastrés dans les dures murailles sont ceux de Jules II et des Sforza; ils sont par conséquentpostérieurs àCésar et je ne vois guères dans toute les villes où je cherche les Borgia, qu'une seule où on ait négligé d'effacer son nom et ses armes, c'est Forliqui, du côté de la campagne, présente encore un écusson des Borgia plein de caractère avec son nom et la date. César a détruit l'une des tours de la forteresse d'Imola en 1499; l'aspect estlemêmequ'à Cesena et qu'à Forli ; mais ici on est en plaine et partout les fossés sont comblés, ce qui enlève au monument son caractère défensif. De la forteresse nous al
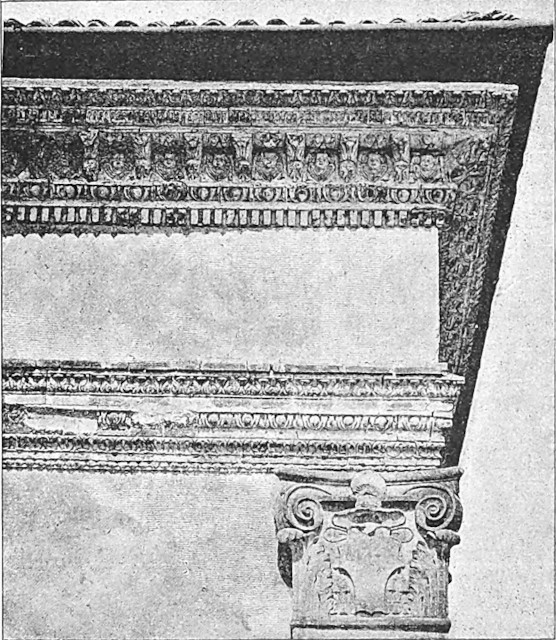
Entablement et chapiteau de l'église du Piratello (fondée par César Borgia à Imola).
lons un peu loin dans lacam pagnechercherlesrestesd'une fondation de César, qui nous est attestée par un document du 4 janvier 1500 signé de Porto-Cesenatico.Onditqu'il y avait là une madone célè bre à laquelle le duc des Ro magnes avait voulu rendre hommage; il y fonda une ins titution pieuse qui a gardé son nom : La Valentine. Elle s'élève au bord de la route et si on étudie avec soin l'extérieur défiguré par des restaurations on reconnaît bien le caractère du Quattrocento, exprimé avec les ressources qu'offrentles matériaux du pays, la Terra Cotta qui a permis l'exécution de ces superbes chapiteaux grecs, de formes amples comme s'ils avaient été dessinés par l'Alberti. Les lignes générales de l'édifice sont belles, mais c'est à peu près tout ce qui reste, avec un petit Santo au bord de la route, défiguré aussi, mais où on reconnaît pourtant l'esprit de l'époque. César avait doté le chapelain, on nous montre le champ qui appartient encore à la fondation, et nous montons jusque dans le petit couvent AUTOUR DES BORGIA. 23 admirer quelques vestiges de vitraux qui ont toute la saveur du temps. Quand nous franchissons le seuil de la chapelle elle-même, le Piratello, un sanctuaire important par sa dimension, la désillusion s'achève. Tout est luisant d'or et battant neuf, ce ne sont que festons, guirlandes, ornements massifs, rayons aveu glants ; une restauration complète, impitoyable, a converti le sanctuaire construit par César et qui aurait dû porter le beau cachet du quinzième siècle italien, en un édifice d'un plan d'une proportion noble encore, mais d'un style qui n'a de nom dans aucune langue. C'en est fait, nous ren trons à temps pour visiter et la ville et la place, avec ses belles constructions à arca desquifontpenser à Bologne, les portes exquises ornées de frises de terre cuite peu vent, par le goût et l'exécu tion, lutter avec les frises grecques ; on nous montre enfindeuxportraitsdu temps du seigneurde Forli, Riario Sforza et celui de Catherine, portraits de facture sans va 00000
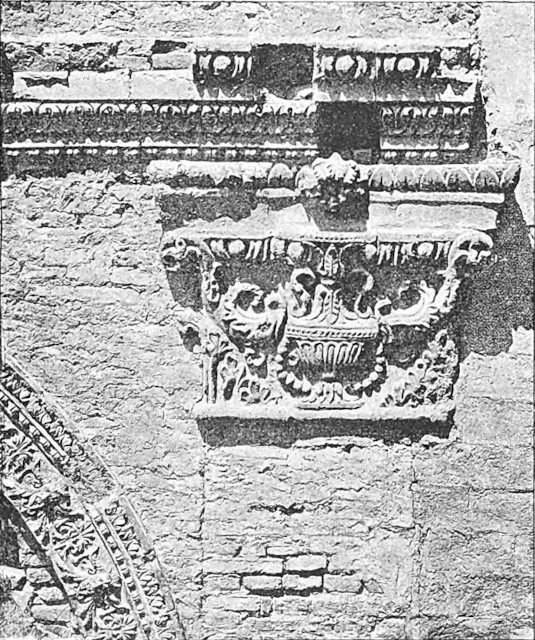
Château du Piratello (Fondation de César Borgia à Imola).
leur d'art, mais qui ont du prix pour l'iconographie, parce qu'ils sont des reproductions d'originaux incontestables. La journée du lendemain est consacrée à une visite à la petite résidence for tifiée de Dozza, à huit kilomètres de Forli ; le château domine la petite ville concédée aux Malvezzi dont on voit les portraits encore pendus aux murailles. Les inscriptions qui consacrent la concession sont du temps de Clément VII. Enfin, après avoir réuni bien des notions nouvelles sur le Valentinois, M. Ales sandretti nous met en face d'unetoile rongée par le temps, un portraitde profil, 24 LES MONUMENTS DES BORGIA. conservé de temps immémorial dans safamille, originaire d'Imola, très ancienne et qui yrésidadetout temps. Ce portrait, de dimension nature, représente César Borgia à mi-corps avec le Beretto de capitaine général de l'Église et le pourpoint de drap d'or, il porte au haut de la toile une belle et sérieuse inscription : CÆ. BORGIA. VALENTINVS. C'est unedes pièces les plus importantes du dossier des portraits de César Borgia. L'honorable syndic aura plus tard la bienveillance de le faire reproduire et de nous l'adresser. Bologne après Imola est l'étape indiquée; en deux heures on passe de l'une à l'autre ville ; mais César n'est jamais entré ici en vainqueur, il n'a fait que trahir les Bentivoglio, les amuser et menacer leur ville ; je n'ai pointày chercher sa trace. J'ai dit ailleurs l'histoire de ces duplicités; Bologne cependant a été fécond pour les recherches au point de vue du document, c'est là que j'ai rencontré la précieuse liste des objets contenus dans les caisses sauvées du désastre de 1503, lorsque Alexandre VI mort, le Valentinois, atteint du même coup, etqui semblait aussi voué au trépas, trouva assez de force pour charger le cardinal Remolino de sauver toutes les richesses qui ornaient son palais de Rome et de les adresser au cardinal Hippolythe de Ferrare. Florence, au passage, fit main-basse sur ce pré cieux envoi, mais en août 1504, ManfredoManfredi, ambassadeur du duc d'Este, réclama ces biens comme propriété du cardinal son fils; Bentivoglio (Jean), le seigneur de Bologne, tenta de se les approprier, carle 10 juin 1504, une lettre de Jules II conservée aux archives de Bologne les luiréclama. César, outre ses biens personnels,étoffes, bronzes, tapisseries, joyaux,objets d'art de toute nature, avait fait main-basse sur les objets du culte en matière d'or ou enrichis de pierreries. C'est en définitive à la maison d'Este, c'est-à-direàl'épouxde Lucrèce Borgia, que tout fut remis. La chronique manuscrite de Martin Fileno conservée à la biblio thèque de Bologne est explicite sur tous ces points ; ilestcertain que c'est à Bolo gne même que Jean Bentivoglio fit l'inventaire de ces fameuses caisses et il les a fait inscrire avec cette mention « Dérobés à l'Église ». De Bologne nous passons à Ferrare. Là régna Lucrèce Borgia, elle avait eu trois époux: leseigneur de Pesaro, Giovanni Sforza, dont sonpropre père et César Borgia l'avaient séparée par la violence en faisant prononcer, par une commission de cardinaux, non seulement la dissolution, mais la nullité de l'union ; après lui le 20juin 1498,onl'avaitunieàDonAlphonse deBisceglie,fils natureld'Alphonse II d'Aragon, et ce second mari qu'elle aimait et qu'elle pleura fut assassiné le AUTOUR DES BORGIA. 25 18 août 1500; enfin, l'année suivante, son père après bien des refus et des discus sions contraignit les Este, seigneurs de Ferrare, à lui donner la main de leur héritier Alphonse. Devenue duchesse après la mort d'Hercule, Lucrèce vécut dix-huit ans à Ferrare, objet de la faveur et de l'estime detous, elle sut désarmer les haines, les jalousies et la méfiance des vertueuses princesses de la maison mariées aux princes de Gonzague et d'Urbino. Deuxmonumentsde Ferrare, tout au moins, pourraient garder des souvenirs de Lucrèce, le palais ducal où elle a certainement vécu, et Schifanoia, lapetite ré sidenceprivée àl'extré mité de la ville, enfin le temple de San Fran cesco où on a déposé ses restes. Le palais de Ferrare masse énorme, forteresse plutôt que palais, qui surgit, rouge etcouronnédecréneaux de défense , entouré d'eau de toute part, présentant aux quatre angles des tours ro bustes faites pour sou

Personnages de la Cour de Ferrare. (Fresques du Palais de Schifanoia )
tenir un siège, avait été précisément modifié en 1500, au momentmêmedumariage deLucrèce, par son beau-père Hercule : aussi lapartie quelajeune princesse allait habiter porte-t-elle encore dans les vieux documents le nom d'AddizioneErculea. On montre avec insistance dans cette même partie des petits cabinets ornés avec beaucoup de soin, d'une dimension exiguë, et qui rappellent le fameux Paradiso d'Isabelle d'Este à Mantoue, en en attribuant la décoration, sinon à la jeune 4 26 LES MONUMENTS DES BORGIA. duchesse de Ferrare du moins à son époux; mais le caractère de l'ornementa tion dément cette assertion. Les historiens, tour à tour ont cherché ici Lucrèce et nul ne l'a trouvée, ni Napoléon Cittadella, le Ferrarais qui a le mieux vu les choses de sa patrie, ni Grégororius le plus italien de tous les allemands et le plus consciencieux des historiens de la fille des Borgia. Une des qua tre tours maîtresses tombée en 1554 a déterminé une restauration, et qui pis est Π
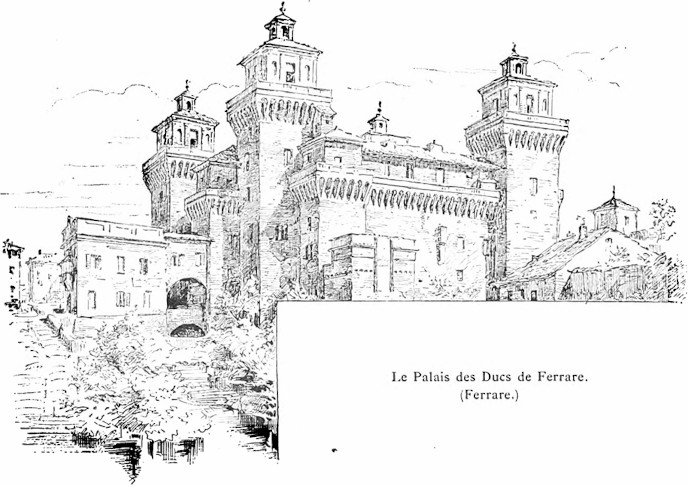
Le Palais des Ducsde Ferrare. (Ferrare)
une modification du château, fort remanié déjà à la fin du xv° siècle par Hercule d'Este. « C'est en vain, dit Cittadella, qu'on chercherait ici l'emplacement précis des chambres de Parisina, celles deladuchesse LucrèceBorgia, ou celle deRenée de France » cette dernière, fille de Louis XI, duchesse de Ferrare, convertie au protestantisme et qui, au commencement dela Réforme, en 1536, eut lahardiesse de donner un asile à Calvin. A Schifanoia (Sans-Souci), lieu de délices élevé par Albert d'Este en 1391, transformé par Borso en 1469, où il avait ses jardins, ses ménageries, ses jeux, etoù on venait du Palais de Ferrare même se reposer quelques heures des soucis AUTOUR DES BORGIA. 27 de la politique; où l'on célébrait les mariages, on fêtait les naissances, et parfois on donnait asile aux princes de passage et aux ambassadeurs extraordinaires, tout parle des Este du xv° siècle; mais ni Alphonse, ni Lucrèce n'y ont laissé leurs traces. Les peintures à fresque retrouvées sous les badigeons des iconoclastes, qui donnent de si précieux documents sur la vie de plaisirs des Borso et des ancêtres d'Hercule, sont de beaucoup antérieures à Alphonse et à Lucrèce, et si ces derniers ont passé là, s'ils y ont vécu comme leurs prédéces seurs, rien ne parle d'eux. Schifanoia d'ailleurs était naguère encore un asile de sourds et muets, mais ce lieu reste néanmoins un des endroits les plus intéres sants de l'Italie par ses fresques uniques, le document le plus précis et le plus rare sur les costumes, les usages et les types d'une cour italienne à la fin du xv° siècle. Un dernier pèlerinage au Temple de San Francesco, au souterrain obscur, noir Panthéon des premiers princes de la maison d'Este, où selon les chroniques les plus respectables, devraient reposer les restes de Lucrèce, ne nous permet même point de retrouver une pierre tombale anonyme contemporaine; tout a été changé, bouleversé, pas une sculpture, pas un nom, un écusson, une date, un vestige enfin ni un symbole qui ait une forme et qu'on puisse déchiffrer ou inter préter. Si les restes de la fille des Borgia, qui certainement fut aimée de ses derniers sujets et respectée par tous sur le trône de Ferrare, n'ont pas eu le sort de ceux de son frère César Borgia, ils reposent alors en quelque fosse obscure, où nul ne pourrajamais les flétrir ou les honorer une dernière fois. C'est ainsi que, cherchant partout ce qui parle des Borgia, nous ne trouvons d'eux que de rares vestiges, et s'il ne restait au Vatican les fameux Appartements Borgia, dérobés depuis des siècles au public avec un soin jaloux, et dont la libéralité et la largeur de vue du pontife Léon XIII, malgré tant de promesses et des actes réels, n'a point encore permis l'accès, et par conséquent l'étude : on pourrait dire qu'il ne reste de ce grand nom maudit que des ruines. Nous avons pu franchir le seuil des appartements du Vatican, et nous y conduirons le lecteur ; nous rassemblerons aussi toutes les images qui ont la prétention de représenter un Borgia, pour les soumettre tour àtour à la critique, et arriver à faire naître chez le lecteur la conviction qu'il a bien sous les yeux le portrait authentique d'Alexandre, celui de César Borgia et celui de Lucrèce. Avec les portraits viendront les monuments de la numismatique, assez imper 28 LES MONUMENTS DES BORGIA. sonnels pour Alexandre comme pour Lucrèce, mais qui cependant sont très précieux parce qu'ils ont une authenticité indéniable, et peuvent servir de types et de point de comparaison auquel on devra soumettre toute image qui aura la prétention de représenter un des héros. Quant à César, la numismatique est muette; il n'existe même pas de lui une de ces restitutions faites, dans le siècle même où il a vécu, d'après quelque document contemporain.Aprèslesportraits, quoi de plus personnel que l'épée de Borgia, monument incomparable, le plus digne d'étude, et celui qui parle le plus à l'imagination par les inscriptions et les compositions gravées sur la lame? L'arme de César venue aux mains d'un Gaetani, duc de Sermoneta, a été pour nous le point de départ d'une étude qui a pris de grandes proportions parce que tout ce qui touche à l'art du xv° siècle italien est au plus haut point suggestif, et que dans cet ordre d'idées on peut dire hardiment que tout est dans tout. PREMIÈRE PARTIE LES APPARTEMENTS BORGIA
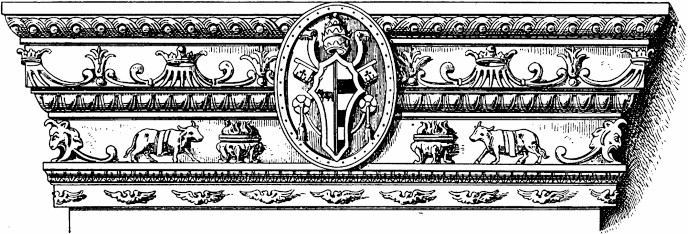
Chapiteau aux Armes et aux Emblèmes du Pontife Alexandre VI. (Salle de la Vie des Saints.)
PREMIÈRE PARTIE LES APPARTEMENTS BORGIA Les appartements avant Alexandre VI.- Part prise par le pontife aux embellissements de Rome et à ceux du Vatican. La Tour Borgia. Les appartements sont-ils lieu d'apparat ou habitation privée? Preuves à l'appui tirées des dépèches des ambassadeurs et des diarii. La salle des Pontifes avant LéonX. Etatactuel. Le Pinturicchio et les Borgia. pute de sainte Catherine. Le portrait d'Alexandre VI. La salle de laVie des Saints. La Dis Examen successif des diverses salles. La fresque de sainte Catherine contient-elle des portraits historiques?- Sort des appartements Borgia État actuel. depuis Sixte V jusqu'à nos jours. Léon XIII. Projet de restauration dû à l'initiative du pontife Au milieu de tant de ruines, les Appartements Borgia du Vatican, le monu ment le plus important des Borgia, le souvenir le plus direct d'Alexandre VI, est resté presque intact. Chaque pontife qui ceignait la tiare, alors comme aujour d'hui, mais dans de moindres proportions puisque le Vatican depuis plusieurs siècles est pourvu de tous ses organes commetemple chrétien et comme résidence d'un souverain spirituel et temporel, a eu l'ambition de rappeler son passage et de marquer sa trace : c'est ainsi que le sanctuaire primitif, d'abord humble basi lique est devenu peu à peu le temple le plus vaste de la chrétienté. Autour du sanctuaire, à l'abri de la prodigieuse coupole deMichel-Ange, sur l'emplacement 32 LES MONUMENTS DES BORGIA. même des jardins de Néron et du cirque où les premiers chrétiens ont subi le martyre, depuis Constantin jusqu'à Nicolas V, à Paul V et à Alexandre VII; chaque pontife a accompli son œuvre, et souvent au détriment de son prédé cesseur. Aujourd'hui les autels, les musées, les jardins, les villas, les forteresses, jusqu'aux fonderies de canons, aux ateliers d'artistes et aux écoles publiques, se sont soudés les uns aux autres; aussi dans cet immense ensemble qui forme la ville pontificale, est-ce une œuvre ingrate pour l'archéologue et pour l'his torien de démêler avec certitude la part de chaque pontife. Au xv° siècle, un pape ami des arts, Nicolas V, avait conçu le vaste projet de grouper tous les services autour de la Sixtine et de Saint-Pierre et, dans ce but, il avait appeléà lui Bernardo Rossellino et Leon Battista Alberti ; la mort le surprit, Innocent VIII tenta de continuer son œuvre, qu'il laissa à son tour inachevée et Alexandre VI Borgia, le successeur d'Innocent, au lieu de continuer la belle ordonnance des grands artistes de la Proto-Renaissance, l'interrompit, et s'appro priant la partie achevée, résolut de la relier à la basilique par un superbe portique à trois ordres de marbres multicolores d'où les pontifes, dominant la cité leonine donneraient la bénédiction les jours de fête. La Tour Borgia etles Appartements Borgia ne sont qu'un corollaire de ce projet, qui fut réalisé, mais dont il ne reste aujourd'hui qu'untronçon. PaulV(Borghèse) a détruit sans pitié le portique pour donner une façade nouvelle à Saint-Pierre de Rome, et c'est par l'examen seul des plans originaux et des dessins des architectes conservés dans la bibliothèque vaticane, qu'on peutse rendre compte de ce qu'était l'œuvre d'Alexandre VI. Ce ne sont pas d'ailleurs les seuls travaux entrepris par Borgia au Vatican; on lui doit le fameux souterrain qui fait communiquer le palais pontifical avec le fort Saint-Ange. En janvier 1495, Borgia dut se féliciter de s'être ménagé cette retraite presque inaccessible, lorsqu'ils'y réfugia pour échapper à Charles VIII qui, un instant, voulut faire de lui son otage; plus tard César, le fils du pontife, échappa aussi par la même voie aux Orsini et aux barons romains ligués contre lui à la mort de son père. C'est aussi à Alexandre VI qu'est due la grande com munication qui relie le Vatican à la cité par l'élargissement des voies tortueuses qui formaient le bourg Leonin; l'histoire contemporaine est pleine du récit de l'inauguration de cette voie nouvelle faite avec la plus grande pompe; célébrés par les poètes, ces embellissements sont une date dans l'histoire de la Rome moderne, une médaille en a consacré le souvenir.
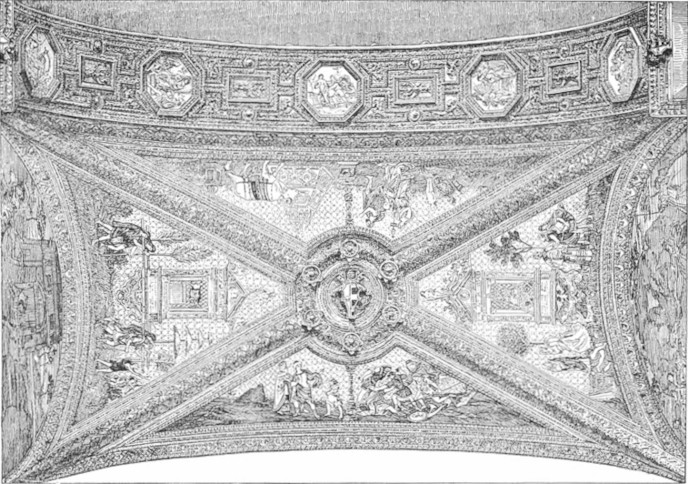
ANAL C ان LA DES L'UNE VOUTE TRAVÉES PROJECTION . DES SAINTS SALLE . d'Isis d'Osiris Histoire LA et DE
LES APPARTEMENTS BORGIA. 33 L'ensemble des constructions du Vatican dues à Alexandre a pris le nom d'Oedes Borgiæ : la partie personnelle au pontife est toujours désignée dans les Diarii et dans les dépêches contemporaines sous le nom de Palazzo Vaticano; c'était la demeure habituelle d'Alexandre VI, et, ce qu'on sait moins, mais ce que nous démontrerons, c'était aussi la résidence privée de César quand il Manuscrits Bibliothèque des Pontificaux Appartements Π Π T Cour de la Sentinelle Chapelle Sixtine Inscriptions Cour du Belvédère VI V des lerie Π Ga IV Cour du 11 III 1
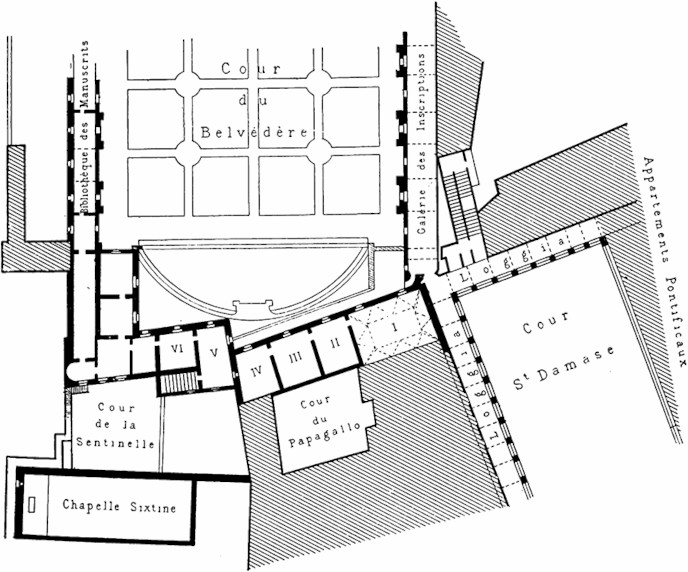
Les Appartements Borgia avec un Fragment du Plan du Vatican (I, II, III, IV, V, VI).
Papagallo a Loggia Cour habitait le Vatican. Ces Oedes Borgiæ occupent dans le plan général de l'édifice l'espace compris entre les Loges dites de Raphaël et la cour de la Sentinella, la cour du Belvédère et la cour du Papagallo. L'appartement se trouve donc précisément au-dessous des Stanze de Raphaël ; l'ensemble se compose de six salles : les quatre premières, auxquelles on accède par une porte à l'angle des Loges et de la longue galerie des inscriptions(la Lapidaria) offrent de l'unité dans leur plan, et leur construction primitive date de Nicolas V; les deux autres, qui les complètent, font saillie dans la cour du Belvédère et n'ont point permis de Π 5 。 1 St Damase 34 LES MONUMENTS DES BORGIA. faire du carré un rectangle parfait; elles font partie de la Tour Borgia, construite par Alexandre VI, qui vient buter fortement le Palazzo Vaticano du xv° siècle. Ces six pièces qui constituent encore aujourd'hui un ensemble habituel lement désigné sous le nom d'Appartements Borgia prennent toutes leur jour sur la cour du Belvédère ; au temps d'Alexandre, des portes pratiquées dans l'une des salles permettaient de sortir sur une vaste Ringhiera, large galerie découverte, régnant tout du long de la construction, d'où le pontife et le Sacré Collège tout entier pouvaient assister aux cérémonies, aux fonctions et aux diver tissements dont ce vaste emplacement était le théâtre. L'appartement occupe tout le premier étage, les Stanze occupent le second. Les salles se commandent, comme celles des Stanze elles-mêmes, aussi Léon X a-t-il fait projeter sur la cour du Belvédère une galerie fermée portée sur des consoles. L'examen attentif des murailles, leur caractère architectural qui manque d'unité, l'arc aigu se com binant avec les lignes droites de la Renaissance, les écussons de Nicolas V encore visibles à l'extérieur à grande hauteur, d'autres, et les plus nombreux, aux armes d'Alexandre VI, quelques-uns aussi de Pie II, enfin ceux de Léon X apposés par lui lors de sa prise de possession de la partie des Stanze, joints àcertains profils d'une ampleur superbe, à des moulures magnifiques, aux lourdes consoles aux grands gestes qui portent les balcons : tout nous parle à la fois du Rossellino, de l'Alberti et du Bramante, et nous dit à n'en point douter qu'Alexandre VI n'a fait que s'approprier, de 1492 à 1494, l'œuvre de Nicolas V et de ses successeurs. Le pontife est venu, il a modifié à son gré ces diverses salles, il en a décoré les intérieurs, et les a marqués de son sceau comme plus tard Léon X allait le faire pour les Stanze. Si, des Oedes Borgiæ, il ne restait que le fameux TorrioneBorgia, dont le nom revient si souvent dans les écrits du temps, la Sala dei Papi, et les murs de l'appartement Borgia, ce serait assez pour appeler sur cette partie de l'édifice l'intérêt de l'historien et de l'archéologue; mais Alexandre VI, qui eutpeude loisirs et ne fut certainement ni un Mécène comme Pie II, ni un enthousiaste de l'art comme Jules II etLéon X, a appelé à lui pourorner sa demeure Bernardino Betti, le dernier des quattrocentisti, et les appartements Borgia sont devenus un sanc tuaire d'art, le plus réservé, le moins connu, le moins visité et le plus digne de l'être. Cet ensemble d'œuvres du Pinturicchio a moins d'unité qu'on ne le croit à première vue; mais il est digne à la fois d'un peintre, d'un poète, d'un scul LES APPARTEMENTS BORGIA. 35 pteur et d'un décorateur chez qui domine le sentiment de l'harmonie générale, et en face de ses compositions tout imprégnées de l'atmosphère d'idolâtrie qui se dégage des poètes latins, panégyristes d'Alexandre et de César, les Porcari, Michele Ferno, Francesco Uberti, qui ont créé le culte du bœuf de l'écusson des Borgia , on se demande s'il n'y avait pas à côté de l'artiste un de ces poètes lau réats, thuriféraires à gages, auxquels les princes italiens du xv° siècle demandaient l'Invenzione à laquelle l'artiste allait donner la forme et la vie. Le jour oùJules II entra pour la première fois dans les appartements Borgia, après la mort d'Alexandre, il lança contre ces voûtes une imprécation terrible dont l'histoire a gardé le souvenir, et ordonna d'en sceller les portes ; après Della Rovere quelques pontifes ont voulu ignorer cette demeure et n'en ont jamais franchi le seuil, d'autres en firent un musée ou les vouèrent à un usage utilitaire en en défendant l'entrée : aujourd'hui Léon XIII vient d'en ordonner l'appro priation en demandant un projet de restauration, prélude probable de la décision libérale qui les ouvrira à l'étude. Le jour où ce sera un fait accompli, on verra s'évanouir la légende créée par Vasari ; l'auteur des Vite n'a jamais dû franchir le seuil des appartements Borgia puisqu'il nous a décrit, dans les compositions, le pontife Alexandre agenouillé aux pieds de la Vierge sous les traits de l'impudique Julie Farnèse, alors que la superbe effigie du Pinturicchio nous représente Borgia les mains jointes, la mitre à ses pieds, prosterné devant le Sauveur qui sort du tombeau dans sa gloire. Avant d'entrer dans les appartements, recherchons si les salles qui les com posent, auxquelles les fresques qui en font le principal ornement enlèvent le caractère utilitaire que comportent la vie quotidienne et lavie privée, étaient sim plement des appartements d'apparat, ou s'ils furent réellement témoins des faits tragiques qui se rattachent à la vie d'Alexandre VI, de son existence intime et des scènes licencieuses dont il est impossible aujourd'hui de contester l'authenticité. Dans le plan général du Vatican, la chapelle Sixtine est le centre autour duquel tout gravite; tout à fait au nord sont les Musées, le jardin della Pigna, le Braccio Nuovo, les Bibliothèques, les Galeries, la Cour du Belvédère, c'est-à dire le Vatican ouvert à la foule, consacré à l'étude, le Vatican moderne enfin. Au midi, là où s'élevait l'ancienne Basilique, soudées à Saint-Pierre de Rome, se trouvent la chapelle Sixtine, les chapelles particulières, la Pauline, San Lorenzo, 36 LES MONUMENTS DES BORGIA. les chambres du Papagallo, tout un ensemble témoin des cérémonies, des fonc tions, des offices quotidiens du rite, des conclaves, des consécrations, des réceptions de prélats et des ambassadeurs. C'est là qu'au xv° siècle les pontifes successifs avaient choisi leurs appar tements privés. Sixte V devait abandonner cette partie de l'édifice trop basse et privée d'air, et, se portant franchement au midi, achevant d'abord Les Loges, œuvre de Jules II, élever dans la cour San Damaso le palais massif qui écrase la façade de Saint-Pierre. Alexandre VI à son avènement avait donc construitle Torrione, mis en com munication avec les murs de Nicolas V, et relié le tout à la Sixtine et à Saint Pierre. Entre la Sixtine et sa propre résidence, s'étendait la partie du Papagallo où, tous les jours, à toute heure il était appelé; on y consacrait les évêques, on y recevait les prélats, on y ouvrait la bouche aux cardinaux. Les souverains, les princes, les grands capitaines, les visiteurs illustres y étaient admis au baise ment des pieds; la salle du Paramentum était à portée, on y recevait et on y dépouillait les vêtements pontificaux. Si nul historien n'a pu nous montrer Alexandre et César agissant dans le cadre du Vatican, on peut du moins, en sui vant jour par jour les fameux Diarium de Burckardt (auquel il faudra toujours revenir pour cette période), et en le corroborant par les dépêches parallèles et simultanées envoyées aux divers princes par leurs résidents à Rome, voir le souverain pontife vaquer à ses offices dans cette partie de l'édifice. On acquerra ainsi, par des désignations nettes, fréquentes, qui, restées les mêmes s'appliquent aux mêmes lieux, la conviction que les Appartements Borgia étaient bien le théâtre de la vie quotidienne d'Alexandre VI. Le 29 juin 1500, le bruit de la mort d'Alexandre VI, tué par l'écroulement d'un plafond dans le Palazzo Vaticano, courut dans toute la ville de Rome et y causa une incroyable rumeur qui fut bientôt apaisée par des proclamations dans les divers quartiers de la ville. Nous avons trois récits de l'accident qui se complètent mutuellement et se corroborent : le récit du maître des cérémonies d'Alexandre d'abord (à sa date dans son Diarium); la chronique de Jean d'Auton, chronique contemporaine du plus haut prix pourtout ce qui concerne l'époque; une dépêche de Francesco Cappello secrétaire de la seigneurie de Florence, résident à la courpontificale et adressée le jour même aux Magnifiques du conseil de la Balia ; enfin un bref du pape lui-même à son ambassadeur à Venise.
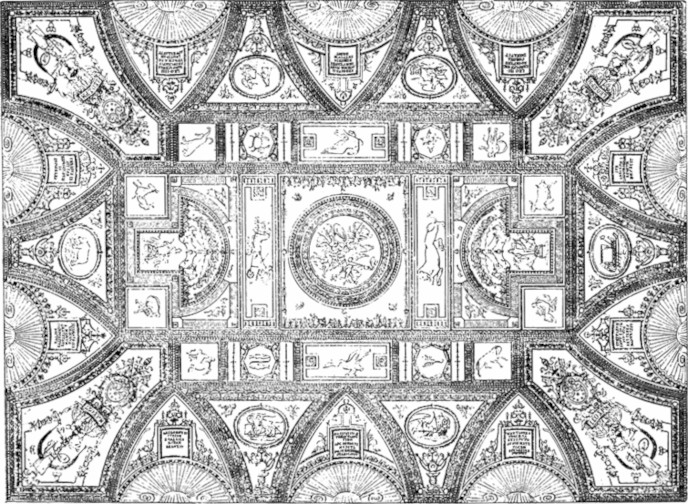
XPME LEOXPIR SA VIT 1111 IN INPIDELZ DICTVS PLUTION ANTTOR COMPOSITYS BANIFICA AMORVM CRAVITATE TRBANTS NICOLATS-11 DEDIT VIKIMON INITIVM IMMUTANDI PONT SVINIS SERGIVSI 24 জজজজজ MAG LEOXP DONAVIT CORONA RO UMPERI CAR LEOI 3 SAR RONIPATITS TOMACELLEN ARC ALIRIANI MYNITA REL LEOXPM 1 BOULESTAR TIL LA DES SALLE du de de del Jean Véga Plafond d'Udine POKIUT Projection Pierino Décoration ADRIANO-1 HAS LONGOBARDOR STEPMANTE RESPEDES FONTLOVE MANURELIT DRPECIT ATABILIVIT PONTIFES .
LES APPARTEMENTS BORGIA. 37 Un orage terrible avait éclaté sur la ville, le pape était dans ses appartements du Palais du Vatican, dans La salle des Pontifes : il s'apprêtait à donner audience à Antonio Pallavicini, cardinal de Sainte-Praxède. Onvenaitde sonner les vêpres ; Alexandre n'avait encore auprès de lui que le cardinal de Capoue et Gaspar Poto son camérier secret; sentant unfroid vif et un ventviolentqui entraient par les fenêtres, le pape donna l'ordre de les fermer.A peine le cardinal et Poto arri vaient-ils au pied de la muraille, un effroyable tumulte se produisit et une pous sière épaisse qui les aveugla leur cacha tout autour d'eux. Ils s'élancèrent vers les portes en criant àceux qui les gardaient : « Le pape est mort! » et rentrés dans la salle nevirentqueruines etdécombres ; deux poutres du plafond,encore scellées au mur par un côté, leur cachait le pontife qu'ils avaient laissé assis sur son trône au-dessus duquel s'élevait le dais. Ils allèrent à lui, et le trouvèrent encore assis mais disparaissant sous les étoffes et recouvert d'un pan d'une tapisserie encore attachée à la muraille.Alexandre essayait faiblement de sedégager; le sang coulait de deux blessures qu'il avait reçues au crâne, un grand clou déchirait le bras droit, deux doigts de la main droite étaient ensanglantés. Le pape atterré ne pouvait proférer une parole : il semblait avoir perdu connaissance; le cardinal et Poto eurent toutes les peines du monde à le faire sortir de cette espèce de niche formée par les poutres dont la position oblique l'avaient préservé de la mort; enfin onle dressa sur sespieds et ilputsetraîner jusqu'à la chambre voisine, qui était la sienne. Pendant ce temps-là on prévenait les cardinaux et on annon çait au peuple que le Saint Père venait d'échapper à lamort. Après avoir examiné l'état réel du pontife, on constata que les clous de la charpente avaient déchiré les chairs, mais qu'il n'était pointgravement atteint; on se borna à le saigner, et, dès le lendemain soir, il pouvait dicter un Bref adressé à Angelo Leonini à Venise, en lui donnant tous les détails de l'accident. Cependant on s'était rendu compte de ce qui s'étaitpassé; latempête avait renversé une cheminée monumentale qui for mait au-dessus des appartements une sorte de campanile, et la masse énorme, en tombant sur la toiture de l'appartement supérieur (La Stanza même où plus tard Raphaël peignit Le triomphe de Constantin) l'avait brisée, projetant les maté riaux sur le plancher qui cédait et tombait à son tour dans la salle des Pontifes. Lorenzo Chigi, cardinal de Sienne, qui se trouvait à l'étage supérieur, avait été frappé à mort avec trois autres personnes : Giovanni Chelli, un florentin, et quelques autres, parmi lesquels plusieurs espagnols « de peu d'importance > 38 LES MONUMENTS DES BORGIA. avaient été blessés. Le lendemain même, furent célébrées à Saint-Pierre les funérailles du cardinal défunt et on ensevelit ses restes dans les caveaux du Vatican¹ . La dépêche de l'envoyé de Florence, qui est très renseigné parce qu'il y a des florentins parmi les victimes, et qui écrit lejour même, a pour nous cette impor tance, qu'en désignant très nettement le théâtre de l'accident, elle nous révèle du même coup que l'étage au-dessus de l'appartement Borgia était la demeure pri vée du duc deValentinois en 1500. Déjà entré dans le siècle et prince français, César était donc installé dans le « Palazzo Vaticano » près de son père le pontife, précisément dans les Stanze dites aujourd'hui « de Raphaël ». C'est un fait nou veau acquis à l'histoire; nous ver rons plus tard comment Alexan dreVI, les jours où César recevait, passait du premier étage au se cond. Capello désigne le lieu de l'accident sous le nom de « La
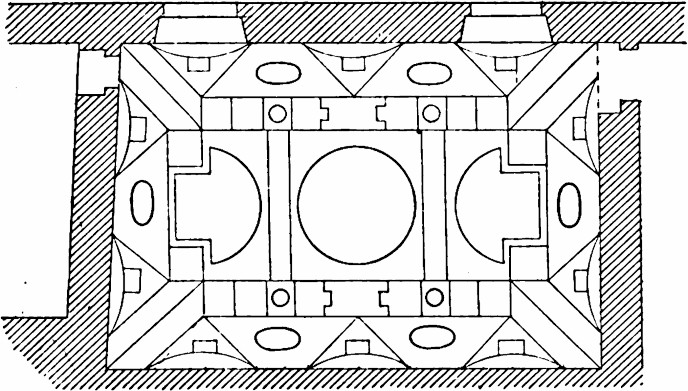
Plan de la Salle des Pontifes, avec Projection du Plafond.
Sala dei Papi, dans le « Palazzo Vaticano »; lenom n'a pas changé; dans la description la plus ré cente des appartements, due à l'abbé Salvatore Volpini, qui l'a minutieusement inventoriée en nous donnant une description de toute cette partie de l'édifice, la salle est désignée comme lapremière des six qui composent l'appartement Borgia : « La Sala dei Pontefici ». Tous ceux qui l'ont décrite attribuent cette dénomination à cette circonstance que le Pinturicchio avait peint dans les lunettes les portraits des pontifes les plus célèbres. Cette salle se trouve juste à l'angle des Loges, au-dessous de la grande salle de Constantin, elle ne mesure pas moinsde vingt mètres de long sur douze de large : c'était l' « Anteca mara » de l'appartement, la salle des audiences, où s'élevait le trône surmonté 1.-- « De ceux qui se trouvaient dans la salle supérieure,celle duValentinois, quelques-uns sont morts, parmi lesquels Lorenzo Chigi, frère d'Agostino, qui est de Sienne ; parmi les blessés Giovanni Chelli, un autre compatriote, qui a reçu nombre de contusions dont on ne connaît pas encore la gravité... Les autres sont espagnols, homini da poco conto. » « (Dépêche de l'ambassadeur Capello à la Seigneurie de Florence). » LES APPARTEMENTS BORGIA. 39 du dais, bien à portée du souverain, qui n'avait qu'à sortir de son privé pour accomplir ses offices. Quandaprèsl'accidentontransportele pape dans sa chambre « in Camera » dit l'ambassadeur, Burckardt précise et dit : « Cameram proxi miorem ». Chaque fois qu'Alexandre VI, les jours de grande cérémonie dans la chapelle Sixtine ou dans la salle du Papagallo, vient se reposer dans ses appar tements, il passe d'abord du Papagallo dans la salle dite « dei Parament », où il dépouille ses vêtements pontificaux, et de là rentre directement dans son privé. En février 1496, le jour où le pape vient de faire une promotion de cardinaux espagnols parmi lesquels figure son cousin Giovanni Borgia, César, au sortir de la cérémonie d'investiture dans la salle du Papagallo, reçoit à son tour ses com patriotes dans la chambre au-dessus de la salle des Pontifes; en décembre 1494, lors de la conspiration d'Ascanio, de San Severino, de Luna, de Prosper Colonna et de l'évêque de Cesena, c'est encore « in cameras superiores dicti Palatii Vaticani supra Papam » (c'est-à-dire l'appartement de César,bien des fois vouéàsemblable office, et où Michelotto, l'âme damnée, veille sur son maître), qu'Alexandre VI fait garder à vue les conspirateurs : enfin, l'année suivante, en janvier 1495, quand Charles VIII ayant consenti à venir à l'obédience, et s'étant prosterné devant le pontife dans la salle du Papagallo pour rendre hommage au souverain, veut l'accompagnerjusqu'à sa chambre, il vient jusqu'au seuil de la Tour Borgia, au delà de la chambre du Papagallo « usque ad cameram secretam ultra cameram Papagalli » . Ajoutons encore qu'en lisant attentivement le Diarium et les dépêches paral lèles et simultanées qui en sontle contrôle irréfutable, que ce n'est pas dans le premier étagedes appartements Borgia, sous ces voûtes peintes par le Pinturicchio où, au milieu des représentations des Mythes païens et des scènes mythologiques, domine pourtant la pensée religieuse, qu'eut lieu le 30 octobre 1501 , la veille de la Toussaint, l'effroyable orgie connue sous le nom de « Banquet des courtisanes » , orgie enregistrée avec son flegme habituel par le maître des cérémonies, attestée aussi par la chronique de Matarazzo, par Francesco Pepi, l'orateur florentin près du pontife, et par les Diarii de Sanuto. Il n'y a pas à revenir sur le fait même, qui est hors de notre sujet; mais il résulte de l'étude des documents de première main une atténuation qui a son prix : l'ambassadeur de Florence, quatre jours après la fête donnée par César, instruit la Seigneurie sans préciser l'endroit où eut lieu l'orgie : « Ces jours-ci, jour des Saints et des Morts, le Pape 40 2 LES MONUMENTS DES BORGIA. n'est venu ni à Saint-Pierre ni à la chapelle pour les offices, mais cela ne l'a pas empêché, pendant la nuit du dimanche, veille de la Toussaint, de veiller jusqu'à minuit avec le duc qui avait de nouveau fait venir au Palais des coureuses de rempart et des courtisanes, et de passer toute la soirée en jeux, en bals et en rires » .-Le maître des cérémonies est plus précis,non seulement c'est César qui ordonne lafête, préside aux évolutions et les choisit, mais c'est chez lui qu'elle se passe, dans sa propre chambre, dans le palais apostolique¹. Le Pape est convié, il y assiste, mais il n'a pas donné ce scandale dans la salle même où il s'est fait représenter les mains jointes, pieusement prosterné aux pieds du Sauveur, au milieu des scènes de la vie des saints, sous les images des pontifes qui furent la gloire et restent l'exemple du trône de Saint-Pierre. C'en est assez pour prouver que nous ne sommes point ici dans un lieu banal où les Borgia n'ont fait que passer; c'est ici qu'est mort Alexandre, c'est de là que César, prêt à expirer, s'est fait porter sur les épaules de ses partisans dans le souterrain qui conduit au fort Saint-Ange. Avant d'entrer dans les appartements Borgia, nous devons dire encore quel fut le sort de cette partie de l'édifice depuis la mort d'Alexandre VI jusqu'au jourd'hui. L'ensemble des appartements Borgia, où nous pénétrons par les portes situées à l'angle des Loges et de la galerie Lapidaire, se compose de six salles, les quatre premières, nous l'avons dit, sont régulières de plan, de larges dimensions, et les deux autres plus restreintes, engagées dans la tour Borgia et à un plan assez inférieur pour qu'on n'y puisse accéder que par sept marches de marbre, indi quent le raccord de la construction d'Alexandre VI avec celle de Nicolas V. Lapremière salle, dite SalledesPontifes, le théâtredel'accident dontAlexandre fut victime en juin 1500, est la plus vaste et la plus monumentale ; nous avons vu qu'elle servait aux audiences pontificales, le trône était adossé au mur de refend mitoyen avec le portique actuel des Loges. Nous venons de donner le plan qui montre les vastes proportions et indique les surfaces ornées et les pénétrations des voûtes àdécorer parles artistes. Detouteévidence, au temps d'Alexandre,lesvoûtes de cette salle étaient déjà revêtues de peintures qui devaient représenter, ou des portraits des plus grandes personnalités du pontificat, ou des compositions faisant 1 .-- << In sero fecerunt cenamcumDuceValentinense in camera sua, in Palatio Apostolico quinquaginta meretrices ... » — Tome III, p. 167.-Diarium, Édition Thuasne, manuscrit de la bibliothèque Chigi. Bibliothèque Magliabecchiana.-- Idem, Bibliothèque nationale de Paris. LES APPARTEMENTS BORGIA. 41 allusion aux grands actes de leur règne; c'est de là que venait le nom de Sala dei Papi. Il n'est point prouvé que ces compositions, qui n'existent plus, aient été de la main du Pinturicchio, la tradition le désigne et l'his torien autorisé du Vatican, Erasmo Pistolesi les lui at tribue. Aujourd'hui nous sommes en face d'un en semble complet, bien con servé, qui n'a aucun des caractères des décorations antérieures au xvi° siècle, etnousn'avonspoint àdou ter de l'époque à laquelle on a procédé à la restau ration ou à la décoration

Jupiter, Salle des Pontifes.
complète de cette salle, puisqu'aux quatre angles duplafond, au milieu de grands trophées qui suivent la courbure de la voussure, nouslisons, au-dessus des Palle l'écusson des Médicis,le nom de Léon X « Pontifex Maxi mus. » Sans parler de la res taurationindispensableaprès l'accident du 26 juin 1500, qui avait sûrement été l'oc casion de la destruction des peintures du Pinturicchio

Apollon.
ou des médaillons des pon tifes dus à un de ses prédé cesseurs, le pontife Léon X a donc repris l'œuvre de fond en comble,la confiant à Jean d'Udine et à Pierino del Vega; et comme nous savons que l'étage correspondant desLoges est dû auxmêmes artistes, il y a lieu de croire que la décoration actuelle de la salle des Pontifes est justement contemporaine de ces dernières. 6 42 LES MONUMENTS DES BORGIA. Il n'y a point à douter non plus que Médicis, enprésidantàce travail, aitdonné l'ordre aux artistes de rappeler, au moins par des légendes, les compositions qui avaient représenté les faits de la vie des grands papes, et de continuer par là une tradition qui consacrait cette salle à leur glorification; de là, sans nul doute, à défaut deportraits ou decompositions allusives, ces inscriptions en caractères lapi daires tout autour du plafond central. Quand nous voyons qu'en 1500 le maître des cérémonies, chaque fois qu'il veut désigner cette première salle des apparte ments Borgia, la désigne sous le nom de Sala dei Papi, et quenous lisons sur les voussures du plafond décoré sous Léon X la mention des faits glorieux qui ont signalé le pontificat de Léon III, de Serge II, de Léon IV, d'Ur bain II, de Nicolas III, de Grégoire XI, de Boniface IX et de Martin V, nous ne pou vons nous empêcher de pen

Diane.
ser qu'il y a une corrélation très étroite entre ces légendes et l'esprit de la décoration antérieure. Commentpour rions-nous admettrequ'iln'y ait pas corrélation, et comment douter qu'en décorant à nouveau une salle qui avait une telle destination, Léon X ait pu ne pas rappeler, au moins par des légendes, une attribution aussi pieuse au siège même du pontificat. Il est singulier toutefois qu'à côté de ces légendes-qui rappellent parexemple le couronnement de Charlemagne par Léon III, le 25 décembre 800, dans la cha pelle vaticane;- la première croisade prêchée par Urbain II contre les Turcs en 1095,- et, quatre années plus tard, la conquête de Jérusalem par Godefroy de Bouillon, etc., Pierino del Vega et Jean d'Udine, fidèles à leurs penchants et à leur tempérament, aient semé sur les voûtes, au milieu des stucs et des grotteschi touchés d'une main habile, les représentations de Jupiter, de Mars, de Vénus, de Mercure, de Phœbé, de Saturneetd'Apollon,les signes duzodiaqueetles allégories des quarante constellations connues aux poètes de la Mythologie : singulière ano : LES APPARTEMENTS BORGIA. 43 malie qui oppose les mythes du paganisme à la glorification des plus hauts faits des successeurs de saint Pierre. Sans faire fi de Jean d'Udine et de Pie rino del Vega, on ne s'at tarde pas longtemps sous les voûtes qu'ils décorent, quand elles ne sont que l'antichambre des salles peintes par le Peinturic chio. On sait l'aspect qu'of frent ces délicates orne mentations, ces grotteschi renouvelés del'antique, qui furent inspirés par la dé couverte des Thermes de Titus, mais cette fois on croit pouvoirdire que Jean d'Udine et Pierino ont travaillé sur des cartons de Raphaël, la salle des Pontifes
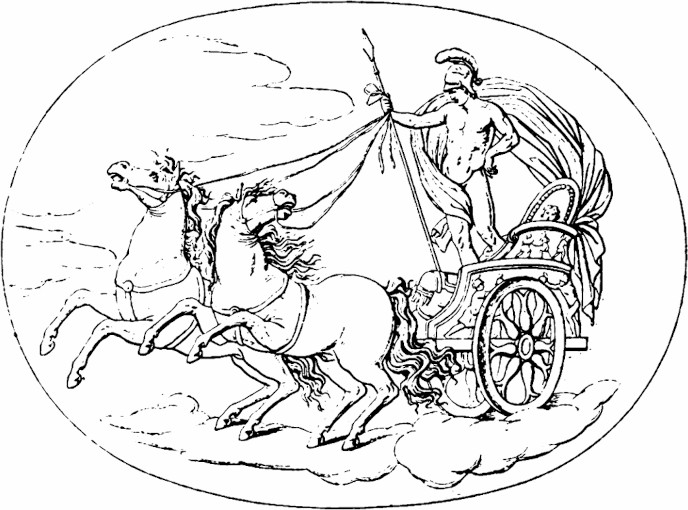
Mars.

Mercure.
étant de plain-pied avec le premier ordre des Loges, et n'étant pour ainsi dire que leur continuation. Les Arazzi du temps d'Alexandre VI ont faitplace à des séries de vues du châ teau Saint-Ange, du Palais de Saint-Marc surlaplacede Venise à Rome, de la porte Nomentana et de l'ancienne Basilique vaticane, mal effa cées sous un badigeon verdâ tre. Au milieu de l'un des murs derefend,au temps deLéonX,onarapporté une cheminéemonumentalequi mesure près de trois mètres sur trois, à entablement fortement saillant. Ce serait dit-on l'œuvre de Simon Mosca qui auraittraduitundessin du Sansovino. Pisto 44 LES MONUMENTS DES BORGIA. lesi assure que cette cheminée se trouvait dans l'une des salles du château Saint Ange; il y a là une réminiscence des frises des sarcophages antiques, des attributs guerriers mêlés auxemblèmes de Sémélé, de Bacchus, de Mars et de Pomone. Les grands jambagesde lacheminée, couverts deconsoles rattachées pardesguirlandes et ornés à la base de chimères aux ailes déployées, offrent cette particularité qu'ils sont évidés et ajourés. Tout l'ensemble de cet intérieur présente l'aspect de ceux du xvı siècle, et quoique nous soyons ici dans la première salle des appar tements Borgia, rien n'y rappelle le pontife Alexandre VI, si nous n'avions pas,
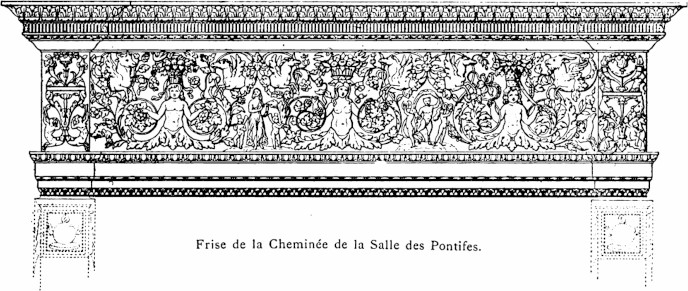
Frise de la Cheminée de la Salle des Pontifes.
pour y attester sa présence, les récits du maître des cérémonies et ceux des ambassadeurs ; aucun signe extérieur, aucun emblème ne nous la dénoncerait. On se rendra compte despetites compositions élégantes semées çà et là, et on remarquera qu'elles semblent des traductions des camées antiques. Le Pinturicchio fut le peintre attitré des Borgia, quoiqu'à l'époque où Alexandre VI l'a connu il fut déjà l'un des artistes les plus occupés de son temps, désigné pour de grands travaux décoratifs ; le pontife fit tout pour le retenir. Malgré bien des réticences, l'artiste devint le familier du Vatican. César aussi le protégea, on en a des preuves pardes ordres donnés à son trésorier, etpardes dons de terrain qu'il lui fit sur le territoire de Pérouse ; Betti fut même son pension naire jusqu'en 1503. L'artiste avait été appelé àRome par InnocentVIII qui créait le Belvédère, ces premiers travaux l'avaient désigné au choix de son succes seur qui continuait son œuvre. Alexandre lui confia d'abord la décoration de ses LES APPARTEMENTS BORGIA. 45 appartements privés, œuvre importante par la multiplicité des compositions , difficile par la nature même et les conditions architectoniques de cette partie du palais pontifical. Pinturicchio commença son travail en 1492; il ne l'acheva qu'en 1495. En 1493, comme il s'était éloigné momentanément de Rome pour remplir certains engagements qu'il avait pris un peu à la légère avec le conseil de la fabrique de la cathédrale d'Orvieto, Alexandre VI, qui ne le voyaitpoint revenir, se fâcha : dans un bref aux anciens d'Orvieto, les rappela à la déférence qui lui était due. Betti revint,mais il se déroba encore et mérita de nouveaux reproches d'Alexandre qui, en 1494, le somma d'avoir à revenir sous les peines les plus sévères. C'était le temps où Lucrèce Borgia et Isabelle d'Este enfermaient les peintres réfractaires et les orfèvres indolents dans le battiponte des châteaux de Ferrare et de Mantoue; Alexandre avait mieux à offrir au Pinturicchio : il le menaça du fort Saint-Ange. En 1495 l'artiste avait achevé son travail ; la der nière date qu'on lit sur les voûtes est même celle de 1494. Nous ne pouvons douter cependant que l'artiste ne soit revenu au Vatican pour exécuter dans le château Saint-Ange, dans la Torrione da basso, une série. de fresques commandées spécialement par Alexandre VI pour consacrer le sou venir de toute une série d'épisodes postérieurs dont Rome fut le théâtre lors de l'invasion du Napolitain par Charles VIII. Laurent de Behaim a vu ces fresques, il en a même copié les légendes ; au nombre de six, elles étaient toutes à la gloire d'Alexandre et, naturellement, quelques-unes d'entre elles étaient à la con fusion de Charles VIII, on en jugera : Le roi de France s'agenouille devant le pontife dans les jardins du château Saint-Ange. Obedience au consistoire. Le roi Charles VIII sert le pontife à la messe de Saint-Pierre. Philippe de Sens et Guillaume de Saint-Malo reçoivent la pourpre. Procession à Saint Paul-hors-les-Murs, le roi tient l'étole du pontife. Départ de Charles VIII pour Naples accompagné de César Borgia et de Djem, frère du sultan' . Pas une de ces scènes n'a échappé à la vigilance de Burckardt ; il les a décrites une à une à leur date chronologique. Nous voyons dans son récit agir les person nages ; nous assistons aux discussions que soulève chacune d'elles au point de vue de lapréséance. C'est en effet le château Saint-Ange qui fut témoin des premières 1.-Voir la série des « Codici Hartmann Schedel» de la Bibliothèque nationale de Munich, où Laurent de Behaim, qui faisait partie de la colonie allemande du Vatican, a copié nombre d'inscriptions, témoi gnages précieux pour l'histoire et l'art. 46 LES MONUMENTS DES BORGIA. scènes, AlexandreVI s'y étant retirépour échapper au roi ;-c'est CharlesVIII lui même qui avait demandé au pontifel'élévation de Guillaume Briconnet, évêque de Saint-Malo, au cardinalat, élévation consacrée dès le surlendemain dans la salleduPapagallo; c'est le 19 janvier 1495enfin, qu'eut lieu lacérémonie d'obé dience dans la première des salles des appartements Borgia, la salle des Pon tifes, où le roi prononça en français les paroles suivantes : « Sainct Père, je suis venu pourfaire obédience et révérence à votre sainctetéde la façonqu'ontfait mes prédécesseurs Roys de France » paroles que le premier président du Parlement de Paris traduisit en latin en les commentant. Les faits concordent donc parfaite ment avec les légendes et les représentations, mais, malheur irréparable, rien ne reste de cet ensemble qui serait sans prix pour notre histoire nationale et celle de l'Italie. Vasari n'est guère à citer lorsqu'il s'agit du Pinturicchio; en face de ce qu'il décrit on sent trop qu'il n'a pas vu le monument; comment aurait-il pu d'ailleurs embrasser l'Italie tout entière; mais son œuvre n'en reste pas moins une source inépuisable. Or, l'auteur des Vite constate qu'il y avait dans ces Istorie di papa Alessandro (qu'il place lui aussi dans le Torrione da basso), des portraits d'Isabelle, de Niccolo Orsini, de Giangiacomo Trivulzio, de César Borgia, de Lucrèce Borgia et beaucoup d'autres personnages « molti virtuosi » de ce temps-là. Il n'en pouvait être autrement dans des scènes historiques et des compositions destinées à les rappeler. La destruction complète de ces fresques du château Saint-Ange est, je le répète, une perte irréparable pour l'art, pour l'histoire, pour l'iconographie; mais il faut avouer qu'en admettant qu'elles aient échappé aux ennemis des Borgia après sa mort, et bientôt après aux lansquenets du cardinal de Bourbon logés dans le château lors du sac de Rome, les sujets qu'elles représentaient n'était point faits pour leur assurer une longue durée. Il faut retirer une conclusion du fait de l'exécution et de la date, c'est que le Pinturicchio dut rester plus longtemps à Rome qu'on ne l'a supposé ou qu'il dut y revenir pour exécuter ces travaux auxquels le pape devait attacher la plus grande importance. Mais revenons aux appartements Borgia. Sans parler de la première salle des Pontifes, partie officielle de l'appartement, qui ne présente plus trace du passage d'Alexandre, le Pinturicchio allait entreprendre là une œuvre considérable par ses dimensions. Sans doute elle n'a pas l'ampleur de l'entreprise de la Sixtine et des Loges, mais elle est plus rassemblée, dans un espace relativement restreint, LES APPARTEMENTS BORGIA. 47 et, offrant des sujets plus multiples, elle exigeait par conséquent plus de disper sion, des combinaisons nombreuses, beaucoup d'ingéniosité et un don suprême de l'arrangement. Nous ne sommes plus là enface de parois régulières, d'un ensemble architec tural auquel a présidé un grand architecte qui prévoit l'arrivée d'un artiste à sa taille et lui prépare un champ : les compositions ne présenteront pas d'unité, et ne seront pas encadrées par des pendentifs ou des médaillons, des specchi, enfin des partis pris architecturaux qui se balancent. Ce n'est plus l'époque gothique et ce n'est pas encore la Renaissance; les dispositions architecturales et la cons truction sont antérieures à l'époque de la décoration, les murs de refend sont obliques, deux salles sur cinq ne sont même pas sur le même plan : donc il ne peut y avoir rien de solennel dans les dispositions. L'artiste, en face d'arcs aigus, de pénétrations nombreuses qui lui présentent des formes plus qu'irrégu lières, devra en tirer parti; les éléments décoratifs de l'architecture aussi feront défaut, les murs étant lisses et le plan naïf; il n'y a ni avant-corps, ni pilastres, ni saillies. Ajoutons que la lumière est très mesurée, et qu'il fallait lais ser à l'appartement l'intimité de la vie quotidienne, le côté bien clos, discret, propice à la résidence permanente. Le Pinturicchio n'est certainement pas entré seul dans les appartements Borgia, quoi qu'à un certain degré il fut architecte et décorateur : il était accom pagné de jeunes élèves de son atelier, dont quelques-uns seraient un jour des maîtres, élégants éphèbes qu'il a peints en pourpoints et en maillots mi-partie colorés dans la plupart de ses compositions, et qui devaient l'aider à réaliser son invenzione et lui faciliter sa tâche. Libre comme l'air, n'ayant probablement qu'une ligne générale pour programme, qu'une condition imposée, celle d'affir mer le pontificat d'Alexandre en multipliant ses emblèmes, il allait inventer un genre, créer un art personnel, et réaliser un ensemble décoratif unique en Italie peut-être, un ensemble où la sculpture, la peinture et les éléments d'ornemen tation architecturaux se tiennent si bien, marchent tellement d'accord qu'il semble au premier abord qu'un seul artiste ait présidé à toute la conception; et, depuis la grande composition jusqu'aux frises, aux voûtes, aux clés, aux détails des oves, des tresses, des acanthes , il n'ait fourni le dessin, étudié la forme, le ton, le relief, descendant des hauteurs de la composition au détail le plus intime du cadre et s'y attachant parce que tout doit être harmonie et que 48 touty concourt. Et pourtant, si on étudie une à une les compositions, on hési tera à les attribuer toutes au même maître. LES MONUMENTS Nous sommes ici en face d'un ensemble où chaque élément concourt à l'effet général, mais où toutes les parties n'ont pas la même valeur, et il n'y a pas de DES BORGIA.
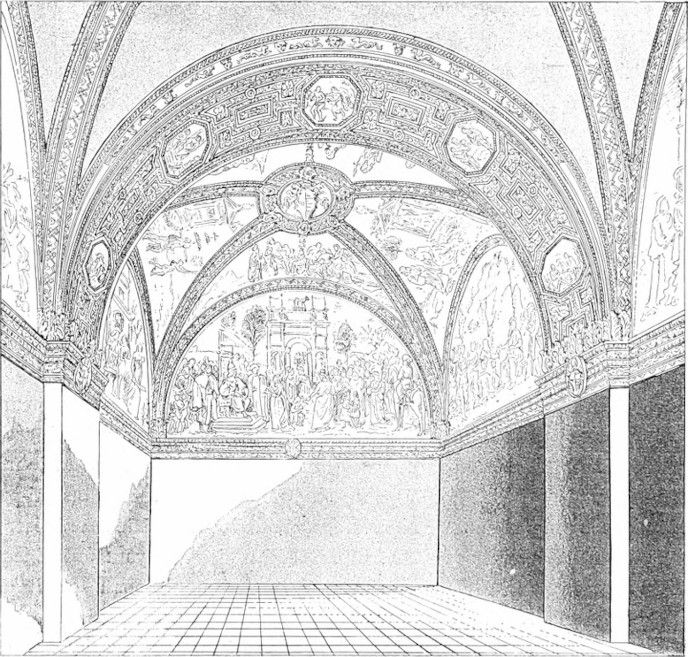
Vue perspective d'une travée de la Salle de la Vie des Saints.
place pour la critique pédante, qui voudrait s'attacher à telle ou telle figure, et discuter telle ou telle d'entre elles. On ne peut pas détacher une composition pour lajuger dans sa valeurintrinsèque; le Pinturicchio a cherché son effet géné ral, le cadre tient au tableau, le tableau appelle le cadre ; les compositions sont évidemment le chant dans cette grande symphoniepicturale, mais la décoration

زبان PACIS SAINTE DEVANT MAXIMIN L'EMPEREUR la des Salle Saints CVLTO . CATHERINE
LES APPARTEMENTS BORGIA. 49 qui l'entoure a la valeur d'une orchestration savante qui, non seulement la fait valoir et la complète, mais qui en fait partie, et qu'on n'en saurait détacher. D'ordinaire la peinture se flatte de tout rendre sensible aux yeux par le seul effort de sa science, par l'observation juste des jeux de la lumière sur un corps et la connaissance accomplie des lois de la perspective; ici, atmosphère, faune, flore, relief des choses de la nature et de l'art, scintillement des étoffes ou miroitement de la matière frappée par le soleil, toutes les formes, tous les plans, tous les replis cachés visibles ou invisibles, Pinturicchio les a rendus sensibles à l'œil et à l'esprit par un relief réel ou simulé. Frappé sans doute des effets obtenus par certains peintres du nord de l'Italie, artistes naïfs qui avaient appelé à eux l'art du sculpteur pour rendre les objets plus sensibles, pour mieux relier leurs œuvres elles- mêmes dans le milieu d'où on l'envisage, et impressionner les yeux par un spectacle plus vivant (sans pour cela renoncer à captiver les cœurs par le charme qu'ils mettent au front de leurs madones et le sourire qu'ils font naître sur leurs lèvres), le Pinturicchio avait déjà eu recours à ce procédé hautement blâmé par quelques contemporains; il allait, dans ces appartements Borgia du Vatican, user de ces moyens et de ces artifices avec une pleine mesure, une science accomplie de l'effet, s'arrêtant juste au point où l'emploi du relief enlèverait à la composition ce caractère surnaturel qui permet à la pensée de quitter la terre pour planer dans les régions de l'idéal. Pour la plus importante de ses compositions, par exemple, dans latroisième salle, celle de la Vie des Saints (la seconde après la salle des Pontifes) où il a représenté sur la paroi la plus large Sainte Catherine et les docteurs devant l'Em pereur Maximinà Alexandrie, lePinturicchio a placé la scène dans un site agreste absolumentOmbrien; etau secondplan, auplein centres'élève un arc de triomphe rappelant l'arc de Constantin, qu'il a dédié au protecteur de la paix en le couron nant du bœuf de l'écusson des Borgia. L'arc se profile sur le ciel; de chaque côté deux arbres grèles se détachent sur l'horizon ; dans le vaste champ du premier plan sont rassemblés les personnages foulant aux pieds une prairie diaprée de fleurs. Tout à fait à gauche se dresse le tròne de Maximin pourvu d'un dais et drapé de riches étoffes d'Orient; auprès de lui setiennent les personnages de sa cour. Devant les marches se tient la Sainte, sous les traits d'une belle jeune fille entourée des docteurs convoqués pour la confondre. Toute la partie droite de la composition est réservée à la foule, aux Hébreux et à la suite; elle est fermée, 7 50 LES MONUMENTS DES BORGIA. tout au bord du cadre, par un cavalier turc monté sur un cheval blanc, coiffé d'un turban à aigrette, le cimeterre au côté. Le ciel est pur, le soleil dont on voit le disque enflammé est presque au cou chant, la scène est fastueuse, les costumes sont éclatants, riches les étoffes et les accessoires ; la nature est en fête, c'est leprintemps dans la prairie, dans le ciel les oiseaux passent et se livrent à l'amour. Nous ne décrivons cependant cette scène, dont on peut embrasser l'ensemble dans notre gravure et qui a sonimpor tance par le côté historique et certains personnages qui y sont représentés, que pour la prendre comme type duparti pris par le Pinturicchio, en faire com prendre l'effet et donner l'impression qu'elle produit sur le spectateur. Le Pinturicchio, pour donner plus de relief à l'arc triomphal qui s'élève au centre de sa composition, a employé le stuc peint, doré dans ses parties essen tielles ; les quatre statues sur l'entablement correspondant aux quatre colonnes d'avant-corps, sont aussi en bas-relief, comme les candélabres qui les surmontent, les guirlandes de perles qui les retient, et le Bœuf dressé sur le piédestal qui couronne l'édifice. Vasari qui n'est que le reflet de l'opinion des artistes de son temps a condamné ce parti pris. L'artiste ne s'est pas borné là, donnant pour assises à son trône trois marches réelles, en perspective, dont le reliefestingénieu sement combiné et gradué; il en a fait un meuble précieux, orné à l'antique, déjà réel par sa saillie, mais encore rehaussé d'or et de tons vifs; et tout à côté du trône, par un parti extrêmement singulier, mais qui est une conséquence du reste, il a revêtu le personnage qui ferme la composition du côté gauche, un turc de la suite de l'empereur, d'une large gandourah à grands plis qui le cou vre de latète aux pieds, etdont le riche tissu de soie broché d'or etde couleurs variées, a un grain réel, une chaîne et une trame, une consistance enfin et une épaisseur figurées par une couche de stuc finement modelée, dans laquelle l'ou til du sculpteur a cherché les détails de la broderie et les contours du pli. Les fleurs qui diaprent la prairie sont autant de légers reliefs, émaux vivants qui font saillie sur le plan des gazons verts, et comme dans la nature; jusqu'au fond de la perspective bordée par l'arc de Constantin, les fleurs se dégradent, les tons s'adoucissent, et les couleurs s'éteignentjusqu'à se perdre dans la demi teinte générale du fonds. Le cavalier oriental qui ferme la scène à droite, par l'intensité du ton de ses fourrures, le riche harnachement de son cheval, sa robe éclatante, son turban, ses LES APPARTEMENTS BORGIA. 51 armes, son reliefenfin, rejetteloinderrière luiles figuresdudernierplanet procède du même parti pris dans l'exécution. Sa selle et ses armes sont de stuc pour ainsi dire émaillé, car c'est bien à l'effet des émaux qu'on peut comparer celui que nous essayons de rendre ici par la plume. Le disque du soleil enfin a aussi son épaisseur, comme les oiseaux qui traversent le ciel doivent encore au relief l'impression de lavie. N'oublionspasquec'est lesiècledesAurefici; lejourviendradesgrandspeintres, des penseurs, des philosophes qui élèvent l'âme, qui charment lesyeux par l'har monie des lignes, la suavité des contours, ou qui terrifient par le geste grandiose comme à la Sixtine et aux Stanze ; ici, à côté du peintre ingénu qui amalgame tous les éléments, qui copie ce qu'il voitet habilledes vêtements des personnages de la vie réelle, de sa vie quotidienne à lui, les figures historiques consacrées, il y a le décorateur et l'orfèvre qui sertit ses compositions dans un cadre comme un émail précieux, qui fait d'une salle à décorer un riche coffret àmille compar timents , un bijou à mille facettes; enfermant dans des tondi et des specchi les épisodes de sa compositionprincipale qui gravitent ainsi autour d'elle comme des astres mineurs, tous reliés entre eux, tous encadrés par des nervures d'un léger relief, où les oves, les acanthes,les fleurs d'eau, l'ache et les tresses, les chimères, les hydres et les diverses imprese des Borgia sont semés çà et là sur des fonds d'unbleu unique, un bleu charmant qui n'appartient qu'à lui et qu'il sait allier aux couleurs les plus vives et les plus harmonieuses. Il suffit de jeter les yeux sur la planche qui montre, rabattu, le plafond tout entier de la sallede la Viedessaints, avecses nervures partant du centre où s'étale enpleinrelief, exécuté enboissculpté, doréetpeintdebrillants émaux,l'écusson des Borgia, et de suivre des yeuxles entrelacs, les mille détails,tous caractéristiques, et qu'il faut savoir lire : pour comprendre la richessede l'effet cherché et obtenu, et constater sa puissance en même temps que sonharmonie. Si on prodigue dans cet ensemble les tons brillants savamment tempérés et obtenus, si on y encadre par la pensée les compositions que nous sommes forcés de détacher une par une, dans leur bordure à la fois simple et riche qui n'empiète pas sur les compo sitions elles-mêmes ; si on le soutient par un soubassement d'une belle propor tion, un entablement, avec tous ses éléments classiques, à moulures saillantes dont chaque champ a son ornement, ici un oiseau léger les ailes ouvertes, là une frise de caractère antique où le Bœuf Borgia alterne avec les réchauds pleins 52 LES MONUMENTS DES BORGIA. de l'encens des sacrifices, au-dessus enfin les oves, et plus haut, des rinceaux élégants se rattachant de distance en distance à la couronne des imprese de César ; si, pourtout décrire, on attache enfin au centre même de la voûte, comme un titre et comme une prisedepossession, enfermés dans une mandorle, la tiare, les clés et les armes du pontife on arrivera à un ensemble tel qu'on ne voudra pas trop en analyser les parties, les comparer, discuter, creuser les sujets souvent exprimés de la façon laplusfantaisiste et la plus inattendue; et on reconnaîtra que si le Pinturicchio fut plus grand à Sienne et s'il y accomplit une œuvre plus solennelle celle qu'on a devant les yeux au Vatican a quelque chose de plus ori ginal et de plus piquant. Le temps lui aussi a fait son œuvre dans cet ensemble où tout n'a pas absolument échappé à ses atteintes, à l'incurie des hommes et à la bestialité des mercenaires du sac de Rome; mais quand on évoque le souvenir de cette admirable harmonie des tons, de l'élégance de la décoration peinte sur ces voûtes lisses, stuquées çà et là et offrant de légères saillies où se fixent des points lumineux scintillant dans la demi-teinte comme des étoiles, et qui ont acquis , grâce au temps, un velouté et une puissance d'effet des plus impression nants, on reste fidèle à cette pensée que le peintre fut bien le maître de l'œuvre et que ceux qui ontpatiemment couché, rechampi, dessiné, sculptéet brodé les mille ornements qui dans leur variété et leur multiplicité se complètent et s'opposent n'étaient que des élèves habiles aux ordres d'un grand maître de la décoration. Un architecte et un écrivain distingué qui est entré aprèsnous dans les appar tements Borgia et qui a eu la bonne fortune de dessiner, de mesurer, et le loisir de longtemps observer, réfléchir et subir l'impression produite par cet ensemble, M. Woodhouse, a évoqué le souvenir des Maures, de leur génie décoratif, de leur tendance comme coloristes; il estimpossibleen effet de nepas penser àeux dans les appartements Borgia. Ajoutons qu'au lieu des riches azulezos qui revêtent d'ordi naire les parois des Alhambras et des Alcazars, et préparent l'effet extraordinaire des voûtes à stalactites le Pinturicchio, au Vatican, avait accroché aux murs, depuis le sol jusqu'à la corniche qui soutient ses compositions et reçoit les ner vures des voûtes, des tapisseries à plis légers, ou peut-être même des draperies feintes, complément attendu des décorations picturales, et revêtu d'émaux l'élé gant pavimento, majoliques précieuses dont il reste à peine quelques spécimens' . I. On lira avec le plus grandprofitla description des appartements Borgia publiée enjanvier 1887 par M. Woodhouse, dans le journal spécial d'architecture, The Builder. M. Woodhouse a publié ses LES APPARTEMENTS BORGIA. 53 C'est une tâche ingrate de décrire des compositions nombreuses sans les appuyer d'une représentation; nous avons préféré donnerune idéegénérale de l'effet , nous caractérisons rapi dement chacune des salles en nous ar rêtant sur les points saillants au point de vue de l'histoire ou de l'art. La première salle après la salle des Pontifes , la Salle de la Madone et de Jésus-Christ, se trouve, dans le plan, au-dessous de la salle d'Héliodore des Stanze de Raphaël, elle mesure huit mètres cinquante-cinq sur dix trente cinq, et ne reçoit le jour que d'une seule fenêtre sur la cour du Belvé

La Naissance du Sauveur.
dère.La salle est voûtée, divisée en deuxpar un arc d'une légère saillie qui vient reposer sur une corniche, offrant ainsi au peintre six grandes surfaces propres à recevoir des compositions; sur les voûtes qui se pénètrent il allait trou ver un champ propice à la décora tion épisodique. Chaque composition sur l'un des tympans encadré par l'arc représente l'un des mystères de la vie de Jésus Christ et de la Vierge:- l'Annon ciation de Marie, la Naissance du Sauveur, l'Adoration des Mages, la Résurrection de Jésus-Christ, l'As cension, la Venue de l'Esprit saint, et l'Assomption de la Vierge. Sur les faces diverses des voûtes limitées par les nervures qui convergent à la clé, dans l'axe même des parois où

L'Adoration des Mages.
croquis d'album, des détails d'architecture, et pris note des tons et des détails, annotant ces croquis à l'appui d'une description minutieuse accompagnée de plans qui permettent de la suivre avec profit. 54 LES MONUMENTS DES BORGIA. se déploie chacune des compositions principales, l'artiste, dans un riche cadre circulaire, une ornementation sans saillie, a peint une figure de prophète tenant àla main une banderole où on lit un verset correspondant au sujet représenté. Immédiatement au-dessous, et tout autour,leschamps qui restent libres,triangles aigus qui viennent mourir au point de départ des nervures, sont littéralement criblés des Imprese des Borgia; les bœufs accotés, séparés par le lampadaire des sacrifices deviennent des motifs de frise, se répètant à l'infini, tournant autour des médaillons, ou marchant parallèlement aux tresses qui lesdécorent. Pas un espace ne reste vide, le plus aigu, au point de départ des nervures, reçoit encorela couronne auxlanguesdefeu. Ce double baldaquin splendide est sé paré par la largeurd'un arc très am ple, très riche, divisé lui-même en compartiments d'un fond rouge écar late où s'encadrent, entableaux alter nés, le bœuf rouge sur fond d'or et les couronnes d'or sur fond vert; enfin, régnant tout autourde la salle, le riche entablement en corniche avec sa frise

Les Apôtreset la Vierge.
de fruits en stuc peint, et son larmier enrichi d'oves polychromes, font aux sujets principaux un cadre d'une richesse extraordinaire; et, tout en laissant la placenobleàla glorification des mystères de la vie du Christ et de la Vierge, chan tent la gloire des Borgia, proclament son nom et célèbrent par toutes leurs allu sions la gloire d'Alexandre VI. C'est dans cette salle que le Pinturicchio a prosterné le pontife Alexandre aux pieds du Sauveur; il enfaitl'un des personnages du sujet LaRésurrection deJésus Christ. Tout à fait appuyé sur le soubassement, au centre même de la composi tion, l'artiste a figuré le sépulcre qui tout à l'heure renfermait la dépouille mortelle du Sauveur ;le couvercle est brisé, un des soldatsveille encore commis à sa garde, un peu en arrière on voit un groupe de gens armés, à gauche du sépulcre, entre celui-ci et la nervure qui ferme lacomposition, se tient Alexandre VI,agenouillé, tête nue, les mains jointes gantées de blanc avec l'anneau du pêcheur, et revêtu LES APPARTEMENTS BORGIA. 55 des vêtements pontificaux; la tiare ou Triregne est à ses pieds. Au centre, au dessus du sépulcre,s'élève le Sauveur, entouré de rayons célestes,portant un écu surlequelestpeinteune croix rouge,emblème du sangrépandu; àdroite,brûle une flamme, symbole de charité. Le flanc du Christ saigne encore, et le sang coule goutte à goutte; son corps est tout entier recouvert d'un voile transparent; en haut, les Séraphins l'accompagnent. Derrière le pape le paysage est sombre, un rocher et un cyprès se découpent sur le ciel ; du côté opposé fleuritun olivier. Cette représentation d'Alexan dre VI est de 1493, date de l'exécu tion irréfutable, à une année près ce 1 pendant, selon que le Pinturicchia commencéparcettesalle ou qu'aucon traire il a terminé parelle. Nous avons donc ici l'aspect exact et la physiono mie du pontife Alexandre VI à l'âge de soixante-trois ans, de la main d'un grand artiste qui a pu le voirfréquem ment, peut-être même chaque jour. Il faut avouer que l'impression n'est pas celle que nous ont laissé les contempo rains qui nous décrivent le pontife comme « rajeunissant à mesure qu'il avance enâge ». Mais il y a là un mo nument important dont nous ne con E H 2 3 C 4 G D B 6 F A 5
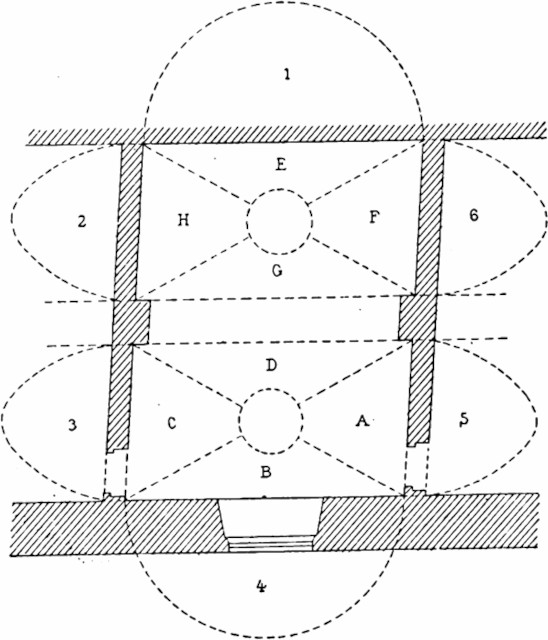
Plan de la Salle de la Vie des Saints.
naissons pas d'autre reproduction que celle que nous donnons ici ; nous la devons à un grand artiste, M. Hebert, directeur de l'académie de France à Rome, qui a bien voulu la faire exécuter par un des plus habiles pension naires de la villa Médicis, M. Pinta, aujourd'hui dans la voie du succès. Il est à remarquer que dans toutes ces compositions et dans l'ensemble de la décoration, le Pinturicchio a été extrêmement sobre de relief; il n'y a apparencede l'emploi du stuc que dans l'Assomption dans le sarcophage d'où sort la Vierge pourprendre sonvolvers lescieux;dans les vêtementspontificaux d'Alexandre VI agenouillé devantle Christ, et quelques autres parties accessoires. Les murailles de soubassement, si on les regarde de près, conservent des traces de détériora 56 LES MONUMENTS DES BORGIA. tions, des dessins en creux, des noms tracés par des visiteurs, desdates, etdit-on, les noms, allemands, des lansquenets de Charles de Bourbon auxquels ces salles auraient servi de corps de garde lors du sac de Rome. Lasalle qui suit, celle de la Vie des saints, la troisième du plan, placée direc tement sous celle des Stanze, dite Della Signatura, mesure à peu près la même dimension que la précédente, 8m,43 sur 10,39; elle estéclairée aussiparcimonieu sement, par une seule fenêtre sur la cour du Belvédère. La disposition des voûtes est la même, avec cette différence que le grand arc en relief qui les partage en deux dans sa largeur repose sur un pilastre présentant un peu plus de saillie, et prenant plus d'importance dans le plan. Notrepetitevueperspectivede la salle, son plan, et la représentation d'une tra vée des voûtes duplafond avec lesprojections des voussures etdes fresques feront mieux comprendre au lecteur l'aspect qu'elle présente. Les reproductions, mo ' dernesettrès récentesdesintérieurs des appartementsBorgiasontunegranderareté, tant le sujet est réservé et si bien les appartements sont clos etinterdits au public; et les images directes fournies par les moyens que lascience photographique et les progrès qu'elle fait chaque jour mettent à notre disposition sont plus rares encore; les épreuves que nous avons traduites ici en photogravures, dues au prince Ruffo, nous ont été communiquées avec une bienveillance parfaite par le comte Lemmo Rossi Scotti, qui a exécuté pour le Musée du South-Kensington un charmant modèle réduit decetimportant ensemble entrepris parl'initiative de l'actifDirector ofscience and art, M. Armstrong. Si on veut suivre la description ou plutôtl'énu mération des sujets sur le plan par les numéros et chiffres des renvois en les rap prochant de la vue perspective, on se rendra compte de l'effet de l'ensemble et on pourra même juger du détail. Sur la face I, opposée à la fenêtre, l'artiste a déroulé la composition que nous avons prisepourtype : Ladisputedesainte Catherine et des docteurs devant l'empe reur Maximin : nous nereviendronspassurl'ensemble;ilétaittrèsnaturel de cher cher dans les représentations peintes par le Pinturicchio des portraits contem porains, et ceux que la raison et les circonstances commandaient d'y découvrir d'abord, sontceux d'Alexandre VI, de CésarBorgia etde Lucrèce. Personne que je sache, parmi les critiques autorisés,j'entends ceux qui ont mené de front l'étude de l'art italien et celle de l'histoire de cette période au Vatican, n'a affirmé et prouvé que certains personnages qui figurent dans la fresque de la sainte Catherine sont LES APPARTEMENTS BORGIA. 57 bienles représentations d'Alexandre ou de ses enfants. Le Pontife ayant été repré senté, grandeur nature, dans la salle précédente, nous n'avons pas à le chercher ici ; aucune des figures d'ailleurs ne le rappelle; mais trois des personnages qui prennentpart à l'actionpourraient, sinous avions des documents irréfutables aux quels nouspuissionsles compareret nouspermettraientde conclureavec certitude, nous offrir des portraits authentiques de personnalités de la cour d'Alexandre VI. Sans développeroutre mesure cette discussion ou plutôt sans poursuivre cette PACIS CVLTO RI
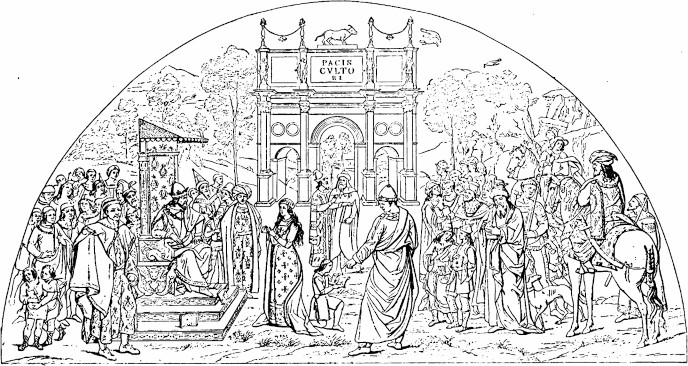
Sainte Catherine d'Alexandrie devant l'Empereur.
recherche qui intéresse l'iconographie, etfera d'ailleurs le sujet d'un autre chapitre important(les portraits de César Borgia), toujours fidèles à nos tendances, nous opposerons les textes et les documents aux conjectures qu'on peut soulever ici. Il y a plus qu'une opinion publique et une tradition au sujet de la possibilité de rencontrer ici des portraits; des hommes dont l'avis mérited'être pris en consi dération croient fermement voir, dans leMaximin assis sur le trône, César Borgia lui-même, comme il faudrait reconnaître Lucrèce, sa sœur, dans la belle figure de sainte Catherine; c'est l'avis du comte Lemmo Rossi Scotti, qui a vécu dans l'intimité de cette fresque en la copiant. Voyons donc quel âge avaitCésar en 1493; le fils d'Alexandre a dix-sept ans, il vient de recevoir la tonsure; cardinal de la veille, cardinal diacre s'entend, il a 8 1 58 LES MONUMENTS DES BORGIA. rang à la cour, et reçoit déjà les ambassadeurs : entre autres Gian Andrea Boc cacio, celui de Ferrare, qui écrit au duc d'Este : « il faut voir en lui un person nage d'un grand esprit, très supérieur, et d'un caractère exquis ». Si précoce qu'il soit cependant, je ne verrai jamais César dans le personnage à longue barbe et à longs cheveux, encore jeune d'ailleurs, qui porte la couronne et tient le sceptre ; il y a là une impossibilité matérielle. Serait-ce Don Giovanni, duc de Gandia, sonfrère aîné, fait capitaine général des troupes pontificales, duc de Cessa, prince de Teano, le favori d'Alexandre avant César, qui devait, le 9 juin 1497, tomber sous le poignard des assassins, probablement apostés par son frère? Si on consent à voir dans cet empereur d'Orient aux longs cheveux, à la barbe folle qui laisse voir la peau, un homme de vingt ans (Gandia est né en 1474 et nous ne sommes ici qu'en 1494), ce pourrait être le fils aîné d'Alexandre; mais comme je cherche des arguments contre moi-même pour ne pas tomber du côté où je penche, je ne puis m'empêcher d'observer que dans les fresques du Pinturic chio à Sienne faites par ordre de Pie III, le même personnage représente l'em pereur Frédéric III ; et à Sienne, une représentation d'un Borgia n'a pas de raison d'être. Je ne saurais conclure, etje ne conclus pas. Quel seramaintenant le personnage qui occupe la première place à côté du trône et fixe le spectateur? Il porte le turban blanc, une ample gandourah jetée sur ses épaules couvre sa robe à grands ramages; c'estunprince, ou tout au moins un grand personnage, et, à coup sûr, un oriental. Si on connaît les circonstances et l'histoire anecdotique de la cour on pourra dire au premier abord : c'est Djem, l'infortuné Djem, le frère du sultan Bajazet, qui a conspiré contre lui et est venu échouer au Vatican. Otage et prisonnier d'Alexandre VI, Djem, après avoir été l'otage de Charles VIII et avoir échangé sa prison de Loches contre celle du Vatican, éternelle terreur de Bajazet qui craint son retour à latête d'un parti, voit sa vie menacée detoute part. Le sultan, dans une lettre adressée à Alexandre VI le 15 septembre 1494, le priera de bien vouloir faire sortir son frère « des angoisses de cette vie et transporter son âme dans l'autre monde où elle aura un repos meil leur » : s'il le fait, le sultan paiera au pape 300000 ducats d'or avec lesquels le Saint Père « pourra acheter des domaines pour sesfils. » Bajazet est bien renseigné ; il connaît le faible du pape, qui ne pense jour et nuit qu'à enrichir les siens ; aussi, cinq mois après, le 29 février 1495 , Djem, enfermé à Naples dans le château de Capoue, sortira-t-il de ce monde après avoir LES APPARTEMENTS BORGIA. 59 pris, dit le chroniqueur, « une nourriture ou un breuvage qui ne convenait pas à son tempérament. » Si on suit attentivement le Diarium du maître des cérémonies d'Alexandre VI depuis l'exaltation jusqu'à 1495, on constatera que Djem estun ornementdes fêtes du Vatican; comme un prince aime à voir des princes étrangers figurer dans son état-major, le pontife se plaît à montrer le frère du sultan dans son cortège, avec ses officiers et sa garde de Circassie. Le fils aîné d'Alexandre aussi, le duc de Gandia, a le goût des costumes étrangers ; et à maintes reprises, côte à côte avec Djem lui-même, il chevauche, revêtu du caftan et ceint du turban; nous en avons des preuves directes dans le Diarium ' . Le 6mars 1493(ondevra remarquercette date parce qu'elle correspond abso lument au moment où le Pinturicchio décore les appartements Borgia) , le pape, à cheval, sort du Vatican par la porte du Saint-Esprit ou de la Tour; un peu en avant, à sadroite,chevauchelegrand turc (c'est Djem) et Giovanni, ducdeGandia, habillé en turc, marche à sa gauche; devant eux quelques Maures conduisent des chevaux de rechange et portent les manteaux . Le 5 mai de la même année, la 1.- L'histoire de Djem, ou Zizim, fils puîné de Mahomet II,est un des plus curieux épisodesde l'his toire de ce temps; il avait voulu déposséder son frère et fut vaincu; ayant cherché un refuge à Rhodes, le grand maître d'alors, Pierre d'Aubusson, le fit passer en France où Charles VIII le garda prison nier. Tous les princes d'Europe le réclamaient, Mathias de Hongrie surtout, afin de tenir Bajazet en échec; Innocent VIII le demanda à son tour, l'obtint, et lui donna le Vatican pour asile. Alexandre VI l'y trouva et l'y garda à vue, il recevait une pension du sultan pour défrayer le prisonnier. La com plicité d'Alexandre avec Bajazet amena le dénouement, Djem sortit des angoisses de cette vie... M. de Bougy a consacré à Zizim une étude pleine d'intérêt. Guillaume Caoursin, vice-chancelier de Rhodes, contemporain de Zizim, lui a consacré une relation. Nous attendons avec impatience le travail définitif de M. Léon Thuasne, l'éditeur du Diarium du maître des cérémonies, qui a rassemblé sur ce personnage les plus précieux documents. 2.-Il n'y a rien de plus piquant, selon nous, que d'illustrer pour ainsi dire l'histoire anecdotique des Borgia par le rapprochement de ces peintures avec le Diarium ; ce grimoire latin, si fastidieux par moment, s'illumine, et les scènes du récit s'animent. On voit, juste au moment où l'artiste les reproduit, passer les acteurs dans le même costume. Voicile sultan Djem et le duc de Gandie : « Eademdie, post prandium S. S. D. M. equitavit ad solatium extra portam sancti spiritus, sive Turrionis, cum suis Domes ticis cardinalibus, prelatis et familiaribus ejus sanctitatis... Immediate ante crucem quam portavit D. B. Gambara subdiaconus, precesserunt magnus Turcus a dextris et Johannes Borgia, dux Candie, filius Pape, a Sinestris, ante se habens plures mauretos, mantellos suos diversos ante ac equi ferentes. » Mars 1493. Page 49. vol. II. Diarium. Et plus loin : « Dominica, 5 maii 1493. Hora Vesperorum SS. D. N. cum capucino rubeo suprarochetum et capello de Cremesino, precedente cruce quam por tavit D. Bernardinus Gambara precesserunt Gem sultan frater magni Turci apud SS. D. N. detentus, a dextris, et Johannes Borgia dux Candie, Valentinus, SS. D. N. pape In habitu Turcorum a sinis tris ..... » Page 69, vol. II. 60 HOTHOMAN VS TVR CORVA SVITANVS MOHA LES MONUMENTS DES BORGIA. mêmescène se reproduit; etil n'y a pas de fète, de procession,de déploiement et d'apparat où Djem ne joue sonrôle. Or,si on jette les yeux à gauche dela compo sitiondu Pinturicchio, surcetorientaldupremierplan, qui, têtenue,gardele trône, etàdroitelui faisant pendant, sur ce cavalier circassien, au blanc coursier, aucime terre recourbé, admirable sujet pour un peintre quiprend son bien où il letrouve et transporte les personnages qu'il a habituellement sous les yeux dans le milieu ambiant de ses compositions historiques, on verra combien le Pinturicchio tient de près à l'histoire de son temps, à son milieu, etcomment il les reflète ; ce qui, je l'avoue, me sembleoffrir un grand intérêt en donnant du reliefaux scènes de cetemps-là. Ennemi de toute affirmation hautaine, j'hésite à conclure; comme je suis sûr de connaître Lucrèce, César et Alexandre (et je le prouverai), je puis affirmer-surtout une fois établies les différences d'âge et les incom

Médaille du Sultan Mahomet II, père de Djem, communiquée par M. Aloïs Heiss.
patibilités- qu'il n'y a dans cette fresque aucundes portraits decestrois personnages ; mais ilya bien desprobabilités pour qu'ony puissereconnaîtrele ducde Gandia, et Zizim ou Djem, le frère du sultan Bajazet. S'il n'existe, au dire de M. Léon Thuasne, l'his torien de Zizim, aucun portrait authentique du frère de Bajazet ; on a le témoignage de Matteo Bosso, abbé de Fiesole, qui était à Rome le 12 mai 1489; après avoir assisté à l'entrée de ce royal otage, il écrit (dans ses lettres [XXX] publiées à Mantoue en 1498) que le fils de Maho met II ressemblait à son père «jusqu'aux ongles, si on s'en rapporte à la médaille de cet empereur si souvent représentée en bronze¹ ». Matteo Bosso ajoute que, quoiqu'il n'eût alors que trente ans, Djem en paraissait quarante, usé qu'il était par la maladie et les souffrances d'une longue captivité. Or Pinturicchio peint en 1493 ou 1494, et Djem a trente-quatre ans (il en paraît quarante-quatre; et I. « Patrem cujus cælatam ære sæpius imaginem vidi ad unguem referens. » Il y a trois mé dailles de Mahomet II: celle de Gentile Bellini, celle de Bertoldo di Giovanni, celle de Costanzo; toutes trois se rapprochent beaucoup du portrait de profil du cavalier de la fresque. Cette médaille nous est communiquée par M. Alois Heiss. RATOR

FUITE ET MARTYRE DE SANTA BARBARA
Salle de la Vie des Saints.
LES APPARTEMENTS BORGIA. 61 il ressemble d'une façon étrange à son père. — Voici la médaille de Mahomet; on la comparera au profil du cavalier du Pinturicchio avant de conclure, et quant à moi, j'incline à voir Djem dans ce personnage. Quant au personnage en turban blanc, en caftan clair, tout près du trône, la place même qu'il occupe à côté de l'empereur, le regard qu'il fixe sur le specta teur je ne sais quoi d'européen dans l'attitude, qui sent le costume emprunté, l'âge enfin du personnage, tout me porte à croire qu'il faut voir là, non pas César, mais son frère aîné qu'il va faire assassiner, le duc de Gandia, qui aimait à revêtir le costume oriental. Les compositions qui ornent les tympans formés par les arcs aigus 2, 3, 4, 5 et 6, représentent : La capture de sainte Julienne. La Fuite et le Mar tyre de Santa Barbara.- Le Martyre de saint Sébastien. La Visitation de la Vierge et la Visite de saint Antoine, abbé, à saint Paul, premier hermite. Nous reproduisons ici la Fuite de Santa Barbara et la Visite de saint Antoine à saint Paul, en faisant observer que dans la première de ces compositions la fi gure du soldat semble sortir d'une

La Visite de saint Antoine, abbé, à saint Paul.
toile du Pérugin, tandis que la figure de la sainte, et, dans la Visite, le groupe des trois Esprits pervers envoyés par le démon pour tenter le cénobite, sont influencés par le souvenir de Botticelli. Dans la fuite de Santa Barbara, la prison de la sainte est bizarrement figurée en relief par une application de stuc, et la perspective est réelle. Il y a là quelque chose de naïf qui donne une singulière vie à la scène; on entre volontiers dans le sujet, qui se déroule dans un paysage décidément Ombrien, avec des collines,desvallées, des montagnes, un lac, et, au premier plan, un gazon diapré de fleurs. Le Martyre de saint Sébastien occupe l'espace vide au-dessus et autour de la fenêtre. Il est bon de remarquer que la plupart des compositions du Pintu ricchio, même les plus avancées et les plus étranges par les éléments qu'il y fait entrer, ne sont point affranchies de la loi des pendants. Ici le saint Sébastien est 1 62 LES MONUMENTS DES BORGIA. au centre déjà percé de flèches et attaché à une colonne. De chaque côté de la
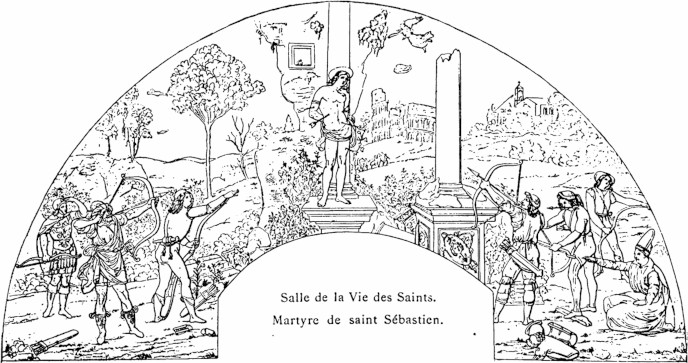
Salle de la Vie des Saints.
Martyre de saint Sébastien.
fenêtre se tiennent trois archers, celui-ci prépare son arc, l'autre tire, le troisième vient de lancer sa flèche. Un messager de Dioclétien, vêtu à l'orientale, avec le turban, assis à terre à la droite, assiste au supplice; la scène se passe dans un paysage qui, comme dans toutes les autres compositions, joue un rôle considérable. Çà et là sont CD

La Visitation de la Vierge.
semées des ruines; le Colysée se dresse à droite, et plus loin un tem ple. Ainsi que dans la Sainte Cathe rine, le sol est jonché de fleurs en re lief émaillées par les couleurs, les oiseaux traversent l'air; au plus haut des cieux plane un ange qui ap porte au saint la palme du martyr. On doit insister sur la liberté avec laquelle toutes les parties sont traitées, architecture, figure ou paysage; malgré la part de convention, rien n'est plus moderne. LES APPARTEMENTS BORGIA. 63 La visite à sainte Élisabeth est curieuse par le parti pris de la composition, l'architecture y joue un grand rôle : le Pinturicchio, sans se rappeler que sainte Élisabeth est de la tribu de Juda et habite Hébron, a transporté la scène en Italie, installant au milieu de sa composition un portique très orné à grands arcs, qui rappellent ceux des Palais del Commune. Sur un des arcs du milieu on lit le nom d'Alexandre VI, dans le tympan des retombées des arcs, un médaillon en relief renferme un sujet guerrier traité à l'antique; sur l'entablement en terrasse deux femmes accoudées assistent à la scène. Les fonds de paysage sont traités libre ment, avec des perspectives profondes, des vallées, un torrent, un fleuve et des barques. L'esprit dans lequel est conçu le su jet a quelque chose de familier qui constitue son originalité ; au lieu de la spiritualiser et de l'élever, le Pinturicchio l'a mise dans la na ture, en contact avec la vie. Sous l'une des ar cades, huit figures de jeunes filles occupées au soin de la maison de sainte Élisabeth, agissent sous les yeux de Zaccharias grand prêtre et mari de la sainte, vieillard à longue barbe blanche, vêtu selon la mode d'Orient,et tenant un livre à la main. Legroupe est remarquable par la vie qui l'anime, mais la peinture a un peu souffert ou plutôt elle semble voilée et retrouverait probablement son bril lant si elle était légèrement dépouillée de la poussière qui la couvre et de la fumée

La Vierge et les Anges.
qui l'altère. Le détail du plan nous a montré la salle coupée en deux par un arc d'une certaine saillie et assez large pour avoir reçu, encadrés dans des octogones, cinq sujets épisodiques de l'histoire d'Iris et d'Osiris, épisodes du sujet que le Pintu ricchio a réservé pour les voûtes. Le dessin de la projection d'une partie de la voûte elle-même avec celle de l'arc qui la décore, en dira plus aux yeux des lecteurs qu'une ingrate description. Il y a une incohérence évidente entre les sujets de la Vie des saints et cette évocation du mythe d'Isis et d'Osiris; mais ce n'est pas au hasard que le Pinturicchio, au milieu des affabulations de la mytho logie toute entière, a choisi la vie du fils de Jupiter et de Niobé. Osiris ayant enseigné aux hommes l'art de cultiver la terre, les prêtres de son culte pour 64 LES MONUMENTS DES BORGIA. rappeler ce prince dont ils avaient fait un dieu, choisirent le bœuf, patient et lourd, lent et ferme, qui symbolise l'agriculture; et l'animal ainsi divinisé con serva dans le culte le nom de bœufApis, nom quelefils deJupiteravait abandonné après sa conquête de l'Égypte, pour prendre celui d'Osiris. Il faut voir là une allusionpermanente au Bœufdel'écusson des Borgia qu'on a divinisé aussi,l'asso ciant d'abord au bœuf Apis, pour le confondre bientôt avec lui. Quand dans un des triangles de la voûte, les prêtres font fumer devant l'autel aux pieds du Bœuf Apis, quandils portent en processionl'idole sacrée, l'encens, en réalité,brûle pour le Bœuf Borgia, et on reconnaît là une allusion familière, qui n'est que la tra duction de certaines poésies faites en l'honneur de la famille par des panégyristes à gages qui, groupés autour du pontife Alexandre, de son fils César, et même de Lucrèce, reçoivent leurs faveurs et les paient en encens. Autour d'eux gra vite toute une pléiade de poètes latins et de poètes en langue vulgaire au pre mier rang desquels on compte Hieronymus Portius (le Porcari), Fileno, Fran cesco Uberti, et le protonotaire Agnello. Poètes lauréats ou pourvus de bénéfices par la curie romaine, tous célèbrent chaque fait de la vie du pontife, un mariage, une conquête, une fondation, un jubilé. Le premier qui a exalté Alexandre et, du premier coup lui a dressé un autel et fait fumer à ses pieds l'encens comme devant une divinité, c'est Agnello le protonotaire : « Rome était grande sous César, elle est plus grande encore aujourd'hui... Sextus ... Regnat Alexander : ille vir iste Deus. Tous sont prompts à l'adoration; le jour même du couronnement l'adulation est arrivée à son paroxysme, mais il faut dire que l'élévation d'Alexandre ne fait qu'exalter aussi ceux qui adulaient déjà en lui le chancelier de l'Église et avaient escompté et prédit son avènement. Alexandre est « sanctissimus , » ces deux mots « Pacis Pater » que Bernardino Corio', qui nous a transmis le récit de la cérémonie du couronnement, lit ce jour-là sur un arc de triomphe, qu'est-il I. La relation de Bernardino Corio sur le couronnement d'Alexandre VI est imprimée à Milan en 1503. Elle est pleine d'intérêt en ce qu'elle peint la transformation de Rome ce jour-là, décrit les fêtes, les décorations, donne les inscriptions, les vers, les manifestations plastiques, etc. Le livre étant rare, on la trouvera à la page 620(documents)du deuxième volume du Diarium de Burckardt, édition Léon Thuasne. Leroux, édit. Paris.

VISITE DE SAINT ANΤΟΙΝΕ ABBÉ A SAINT PAUL
Salle de la Vie des Saints.
LES APPARTEMENTS BORGIA. 65 autre chose qu'une variante du PACIS CULTOR que le Pinturicchio écrit sur le piédestal de la statue du Bœuf des Borgia, couronnement de l'arc de triomphe au centre de la composition de sa sainte Catherine? Déchiffrons les chroniques du temps, feuilletons ces plaquettes, rarissimes au premier chef, qu'on peut com parer à des « Nozze » qui contiennent des poésies de circonstance, poésies qu'Eu carius Silber (Alias Franck Allemanus) imprima à Rome en 1493 , et nous ver rons peu à peu la transformation s'opérer. « Un nouvel ordre divin de choses est né, dit le poète, un héros a revêtu la tiare... Invicto que Iovi estprimus cura Honor. » Voilà Alexandre comparé à Jupiter, il est Dieu, et il apporte avec lui la Paix d'or, la Liberté des choses, laPieusejustice; la richesse est son œuvre : « Tous ces

Mariage d'Isis et d'Osiris.
Salle de la Vie des Saints.
biens, c'est un nouveau dieu qui te les apporte, ô Rome ! » s'écrie le panégyriste dans son exaltation. On a peine à comprendre une telle ivresse et un tel délire; quand on a vécu dans l'intimité de ces œuvres et quand,pénétré de ces lectures, on entre dans les appartements Borgia, quand on en scrute les allusions secrètes, et dans la main, gravées en filigrane d'or sur les lames superbes, par les aurefici au service du Vatican, les compositions allégoriques où le Bœuf Borgia revient sans cesse, on comprend combien les peintres et les artistes du temps sont imprégnés de cette atmosphère d'idolâtrie créée par les écrivains contemporains. Le poète a créé ce monde imaginaire et substitué la fiction à la réalité ; il chante, il répand les idées, le peintre vient qui les traduit, les reflète, ou s'en 9 66 LES MONUMENTS DES BORGIA. inspire. Pinturicchio ne précisera pas, il voilera l'idée, mêlant aux formes anti ques des pensées, des accents et des types de son temps, mais la fumée des sacri fices sacrilèges monte à son cerveau et tout en peignant les divins mystères, tout en célébrant la gloire des saints protecteurs d'Alexandre, de ceux auxquels il avait dit- on le plus souvent recours, il ne pourra s'empêcher, aux voûtes de l'édifice, de célèbrer le pontife sous les traits d'Osiris

Mercure tue Argus.
et d'Apis. Il divinise à son tour le Bœuf de l'écusson, il fait des emblèmes et des imprese des Borgia des constellations qui gravitent dans l'azur de ses ciels , et il répète avec Francesco Uberti de Cesena, l'un des plus ardents panégyristes des Borgia : S Vive Diu Bos. Vive Diu Bos. Borgia Vive' . ALLE DES ARTS LIBÉRAUX ET DES SCIENCES. Le plan de cette salle qui correspond à celle des Stanze où est peint l'Incendie du Bourg a la simplicité de celle qui la précède, et le même arc la partage dans son axe perpendiculaire au mur de refend. Elle offre six panneaux principaux de la cimaise aux voûtes, et cinq champs octogones réservés sur l'arc même. Il faut observer toutefois qu'alors que dans la salle des Saints, l'arc en saillie est décoré de moulures en stuc peintes et dorées, ici le décor n'est que figuré. On suppose que les stucs se sont détériorés sous l'action du temps, et alors que les peintures dans les octogones étaient préservées on aura voulu simplifier la restauration en simulant le relief de l'ornementation par la peinture. Tous les sujets sont em pruntés aux arts et aux sciences du Trivium et du Quadrivium; la traditionveut qu'Alexandre VI, qui, tout en laissant partout une liberté grande au décorateur, lui avait indiqué les saints de sa dévotion et les mystères qu'il devait célébrer I. Le manuscrit est à la Bibliothèque La Malatestiana de Cesena, il comprend une série de pièces, toutes relatives aux Borgia, et porte les armes de César Borgia avec des figures de l'école de Parmegianino. LES APPARTEMENTS BORGIA. 67 dans la salle précédente, lui avait aussi donné pour programme la glorification des vertus du prince et l'ornement de son esprit : c'est-à-dire la Justice, la Rhétorique, la Géométrie, l'Arithmé tique, la Musique, l'Astronomie, la Grammaire,la Dialectique. Quoi qu'il en soit, le Pinturicchio symbolise cha cun des arts par une réunion de figu res symboliques et chacune des vertus par un épisode qui la montre en ac tion. La Rhétorique, comme chacun des arts, occupe un des grands pan neaux circonscrits par les nervures de la voûte : elle est représentée sous les traits d'une femme assise sur untrône
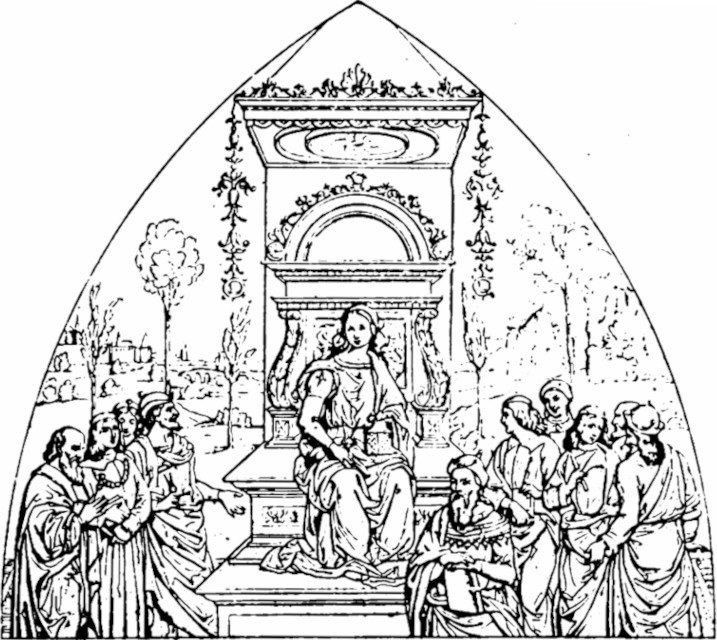
La Grammaire.
en forme d'édicule, surélevé de quelques marches, dominant une assemblée de personnages répartis régulièrement de chaque côté du monument : des rhéteurs, des littérateurs , des orateurs et des poètes. Deux Génies se tiennent de chaque côté du trône, deux autres, au couronnement, soulèvent le baldaquin qui le décore, et relèvent d'une main les guirlandes qui retombent sur les pilastres. On lit le mot rhétorique sur la première marche, et un peu plus loin sur la gauche, lenom de Pentori chio. Ce trône à palmettes au centre MVSICA
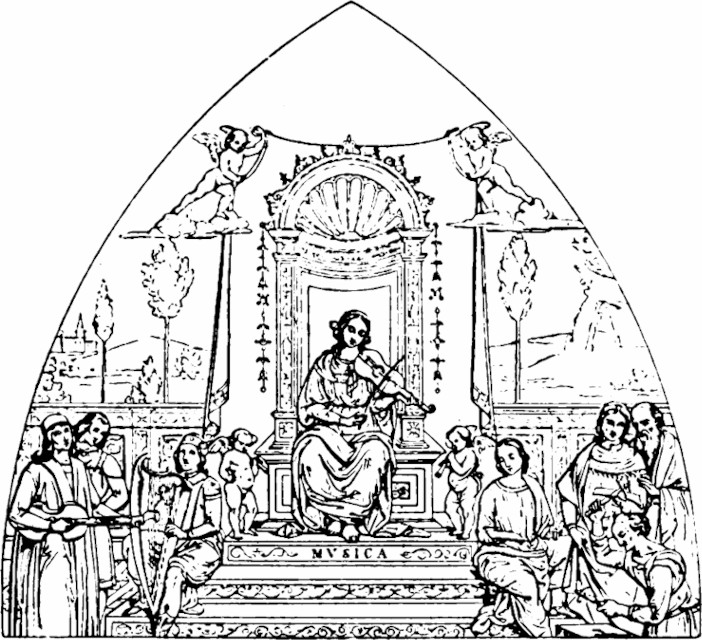
La Musique.
avec ses personnages cadencés et, en nombre égal àla droite et à la gauche, les quatrePutti ailés et le fond du pay. sage, sont la parfaite image des Pla quettes des sculpteurs du Nord de l'Italie au xvº siècle. Toutes les autressciences sont conçues et traitées dans le même esprit et la même forme. On est tenté de se dire que si le Pinturicchio n'avait pas écrit son nom sur ces fresques, 68 LES MONUMENTS DES BORGIA. on chercherait autour de lui un esprit moins libre, mais beaucoup plus élevé que celui qui a peint le Martyre de Santa Barbara et la Fuite de Santa Juliania dans la salle qui précède. En général le Pinturicchio a été très sobre de relief dans cette salle; CODE RETTORICA

La Rhétorique.
S c'est de la peinture plus architectu rale, la ligne est plus sévère et il n'y a point de place pour l'épisode fa milier et la fantaisie, l'ensemble ac cuse un parti pris de régularité dans la répartition des personnages, il se ressent des influences vénitiennes, notamment de celle des Bellini. Les voûtes de cette salle n'offrent point de champ à la composition, elles sont divisées en compartiments irréguliers dont la forme est donnée par les plans qu'offrent les retombées. Il faudrait un échafaudage pourétudier de près les nombreux symboles et les em blèmes, et dire les intentions du déco rateur. Tous les éléments des frises sont allusifs aux Borgia, depuis ceux qui or nent lespendentifs, oùdeuxanges portent dans un Tondo un colossal écusson des Borgia qu'un troisième ange supporte à sa base, jusqu'aux angles aigus au point où se rejoignent les voussures, où s'étale la couronne des Imprese. L'effet général est des plus harmonieux, la conception est plus d'un architecte que d'un peintre; la construction des voûtes, plus compli quée de plans, et qui se rapproche des
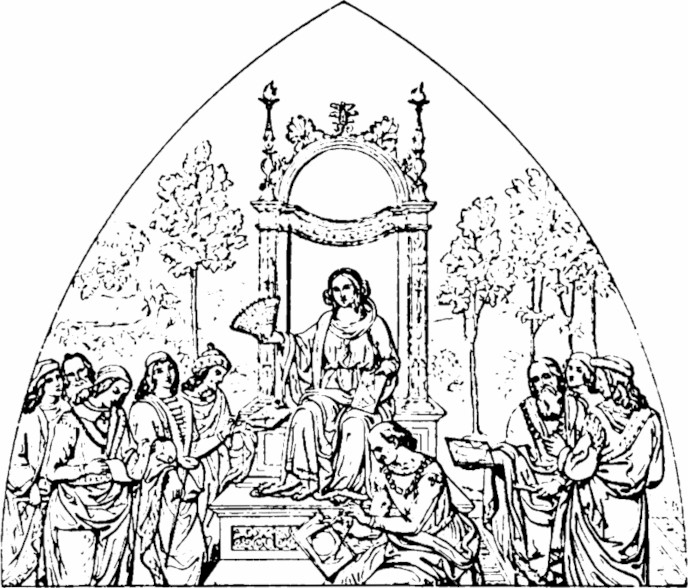
La Géométrie.
combinaisonsde l'artoriental, donneun caractèrespécial à cette partie des appar tements dont on peut dire qu'elle a plus d'ensemble que le reste, qu'elle se tient mieux, qu'elle est plus sage et mieux ordonnée, mais moins libre et personnelle. LES APPARTEMENTS BORGIA. 69 La salle qui suit, dite du Credo, est engagée dans la tour Borgia, par consé quent, en retraite dans le plan général de l'appartement et à un autre niveau, qu'on regagne par sept marches; on sent ainsi le rattachement de la tour, comme construction postérieure, à la partie construite par Nicolas V. Les peintures sont attribuées à Benedetto Bonfigli, de Pérouse, qui certainement a aidé le Pin turicchio dans l'ensemble de son travail, comme nombre d'autres de ses élèves dont les documents ne donnent point le nom. L'aspect de ladécoration est confus, le nombre des sujets, qui sont des demi-figures, n'est pas en propor tion avec l'espace à décorer; et si l'impres sion laisse à désirer commedécor, l'absence d'un sujet rend aussi l'étude de la salle elle-même moins intéressante à la première vue. Construite à une époque postérieure, cette partien'aplusl'aspectdes autres cham bres ; la disposition des voûtes n'était plus à l'ordre du jour, on revenait aux formes carrées, à l'antiquité, aux grands partis pris droits, à la décoration géométrique. Il y a bien des raisons de croire que c'est le Pinturicchio qui acomposé les cartons mais il n'y a plus là trace de ces reliefs, de ces stucs, de ces émauxqui, combinés avec l'ensemble pictural, donnent un aspect si nouveau, si piquant aux trois salles qui précèdent. Salvatore Volpini désigne cette cinquième chambre sous le nom de salle du Credo ; elle est en effet con * sacrée aux apôtres, mais aussi aux prophètes et la tradition lui conserve son pre mier nom; l'œuvre est datée MCCCCLXXXXIIII, au milieu du plafond divisé

La Dialectique.
en compartiments où s'étale l'écusson du pontife en relief, encadré dans un feston d'où s'échappent des rayons : on lit l'inscription : ALEXANDER BORGIA PP. VI. FUNDAVIT. Les autres emblèmes d'Alexandre VI alternent avec la cou ronne et les flammes. La dernière salle est celle des Sibylles, dans la pratique de la vie c'est par celle-ci qu'on accède aux appartements dont le plan va se rétrécissant encore pour donner place àl'escalier qui rachète le niveau; nous nous trouvonsici dans une pièce presque carrée, mesurant 7,20 sur 8,32, à voûte plate comme la pré 70 LES MONUMENTS DES BORGIA. cédente. L'artiste, quel qu'il soit, n'a pas appliqué non plus ici le système des décorations en relief relevées d'or et de couleurs, qui reliaient les fresques à l'architecture, la complétaient et faisaient corps avec elle. A part, au centre du plafond, un cadre octogone en relief recevant les armes de Borgia, armes très saillantes ; tous les autres ornements sont peints. Le parti adopté est celui qui prévaudra bientôt pendant toute une période de la Renaissance, la division par caissons de formes plus ou moins variées, ayant au centre des rosaces, des enroulement et des mascarons, alternant ici avec les emblèmes des Borgia qui se détachent en or sur des fonds rouges. Dans la frise, les peintures sont reparties sur trois lunettes sur chaque face,chacune d'elles montrant deux demi-figures accouplées sur fond bleu, une sibylle et un prophète. Les lunettes étant séparées l'une de l'autre par un espace assez large, l'artiste a ménagé entre elles, sur les quatre faces, huit octogones dans lesquels il a sym bolisé les planètes, au nombre de sept, réservant le dernier espace à l'Astrologie. Là encore on pourra trouver l'accouplement singulier, et le contraste dénonce sinon la main, au moins les habitudes de pensée du Pinturicchio. Si le plafond, avec sa belle division, en caissons richement ornés, présente une disposition pleine d'harmonie, l'effet de la partie où le peintre a alterné ses sujets est moins satisfaisant; les figures ne sont pas à l'échelle de l'édifice. C'est bien encore à Buonfigli qu'on attribue cette dernière décoration; il est bien difficile cependant, étant donnée la date de l'année 1494, à laquelle Pinturicchio était cer tainement au Vatican, et, dans le Vatican même, occupé aux appartements Bor gia; qu'il n'ait pas eu la responsabilité de la décoration. Le Pinturicchio, à un moment de sa carrière, a subi des influences; sa manière ne s'impose pas tou jours, et pour peu qu'un interprète qui, lui aussi, a son caractère et son tempé rament, ait reçu la mission de peindre d'après des cartons et, en le faisant, ait exprimé sa personnalité dans l'exécution : ceux qui essaient faute de documents certains d'attribuer l'œuvre d'après le caractère qui s'y reflète, se trouvent dans un grand embarras. La peinture est certainement ombrienne. Schmarsow et Cavalcaselle ont pensé à Baldassar Peruzzi ; à Rome même quelques maîtres de la critique ont vu là l'influence de Fiorenzo di Lorenzo ; c'est dire qu'il n'y a là ni affirmation ni précision dans l'expression picturale. Pour dire toute notre pensée, même dans les parties les plus intéressantes des appartements il y a des contrastes évidents, des différences de caractère, de style et de tempérament qui rendront LES APPARTEMENTS BORGIA. 71 2 l'étude de ces décorations extrêmement périlleuse pour ceux qui l'entreprendront au point de vue spécial des attributions. Il faut attendre quelque document irré futable ; et qui nous dit que, selon la mode du temps, il n'y a pas derrière Pintu ricchio qui reçoit le prix de l'œuvre, toute une légion d'élèves déjà mûrs qui n'abdiquent pas et qui interprètent certaines parties sur des dessins, des cartons peu précis, alors qu'Alexandre VI, impatienté des retards de Betti, gourmande les habitants d'Orvieto qui le retiennent. Si l'on passe rapidement dans ces deux premières salles comme ne révélant pas d'une façon irréfutable l'intervention du Pinturicchio , il faut avouer qu'elles se relient cependant à celles qui précèdent par les allusions, les emblèmes, les inscriptions et une certaine préoccupation de former un ensemble. Si on en scru tait les compositions en les soumettant à un examen sérieux et s'appliquant à les particulariser, on pourrait aussi montrer bien des pensées allusives qui échappent au visiteur. C'est ainsi que dans l'un des octogones qui regardent laported'entrée, là où, à côté du cadre où il a peint Vénus, l'artiste a voulu caractériserApollon, il a groupé autour du pontife Alexandre, revêtu du pluvial, coiffé de la mitre et donnant la bénédiction, un groupe de personnages,une reine, un souverain, dia dèmes en tête, et au milieu d'eux un cardinal de l'Église romaine. Il est à remarquer que toutes ces salles, depuis la plus vaste jusqu'à ces deux dernières, étaient, au temps de Borgia, pourvues de cheminéesdegrandeurs appro priées. Il y a làune indication, une preuve de l'usage quotidien, de la vie intime, et si, dans ces salles aujourd'hui vides,les communications avec l'extérieur ont été modifiées, quelquesportes etfenêtres ont étéagrandies,etd'autres toutàfait murées pour les approprier à des usages divers, il n'en est pas moins vrai qu'elles furent, comme nous l'avons prouvé, les témoins de la vie quotidienne du pontife Alexandre, sa demeure, son home, puisque le mot caractérise plus chaudement la vie. Selon la tradition acceptée par M. Barbier de Montaut, si autorisé quand il parle du Vatican, dans son dernier volume, et selon la tradition confirmée par le maître des cérémonies d'Alexandre, c'est dans la salle dite des Arts libéraux que le pontife est mort, et c'est dans lasalle des Saints, où le Pinturicchio a peint la sainte Catherine devant l'empereur, que son corps fut exposé; c'est là aussi qu'il fut abandonné par ceux qui, ayant la mission de lui rendre les derniers honneurs, laissèrent ce soin à des subalternes pris de pudeur et de pitié. 72 LES MONUMENTS DES BORGIA. ES APPARTEMENTS DEPUIS LES BORGIA JUSQU'A NOS JOURS. Si nous pre nons les appartements Borgia à leurorigine comme résidence privée du pontife Alexandre, c'est-à-dire dès 1492, pour dire quel fut leur sort dans la succession des temps, on verra que le lieu n'a pas toujours été aussi réservé et mystérieux qu'il l'est devenu depuis 1840. En réalité les appartements furent mis à l'index par le pape Jules II ; mais s'il a affirmé, avec sa violence habituelle, sa résolution de n'yjamais mettre les pieds, il les a respectés etla gloire lui revient d'avoir résisté à ceux qui lui proposaient d'y effacer le souvenir de son prédé cesseur. « Le 26 novembre (dit Paride de Grassis, le maître des cérémonies du pontife), le pape a établi sa résidence à l'étage supérieur du palais, car, m'a t-il dit, il ne voulait pas voir, à toute heure, la figure de son prédécesseur Alexandre, son ennemi, qu'il appelait un Marane, un Juifet un Circoncis. A ces mots, comme ceux qui l'entouraient et moi-même nous nous étions mis à rire, le pontife se tourna vers moi, presque avec aigreur, et me reprocha de ne pas le croire lorsqu'il disait du pape Alexandre qu'il était circoncis. Et comme j'ajoutai que si tout cela lui déplaisait si fort on pourrait faire disparaître cette figure de la muraille, avec tous ses attributs, il me répondit qu'il s'y opposait parce que cela ne serait point décent « quia hoc non deceret » mais qu'il se refusait d'habiter les appartements pontificaux qui lui rappelaient cette mémoire odieuse et scélérate¹. » Après Jules II, Vasari a calomnié à la fois, et Borgia et le Pinturicchio, en accusant le pontife de s'être laissé représenter agenouillé devant la Vierge sous les traits de Julia Farnèse. Il n'y a rien de tel dans aucune des parties des fresques, et Vasari est pour beaucoup dans lalégende qui s'est formée. On a dû rendre les appartements au service banal vers 1583, les appropriations à partir 1.- Paride de Grassis a été en faitle successeurde Burckardtcomme maître des cérémonies; nommé clerc surnuméraire le 17 mai 1504, le 25 il est entré en fonctions, et le 28, le pape a confirmé sa nomi nation; il était désigné d'avance comme un coadjuteur, car sur la liste des conclavistes qui assistèrent à l'élection de Jules II (9 novembre 1503) on lit : « de Paride de Grassis, futurus magister ceremo niarum »,Grassis a laissé un Diarium qui sue la haine contre son prédécesseur Burckardt; celui-ci lui survécut, mais il se retira et fut nommé référendaire des grâces, évèque d'Orta et de Civita-Castellana. En décembre 1504, Burckardt arrivait même à l'apogée de sa situation : il recevait le sceau pontifical et allait tenir la signature au château Saint-Ange. En vérité Grassis est un ennemi et il est suspect en ce qui touche Alexandre VI, mais la scène à laquelle il affirme avoir assisté en plein Vatican ne saurait être inventée de toute pièce; ou alors il n'y a plus de témoin oculaire auquel on puisse croire. A

ALEXANDRE VI
Fresque du Pinturicchio
LES APPARTEMENTS BORGIA. 73 de ce moment furent nombreuses, et toutes n'étaient pas faites pour assurer la conservation des chefs-d'œuvre du Pinturicchio. Il est tout à fait avéré d'abord qu'en 1527, après l'assaut du 6 mai, qui pré céda le sac de Rome, événement dont on n'exagérera jamais les résultats au point de vue de la destruction des objets d'art, les appartements furent occupés par les lansquenets du cardinal de Bourbon. L'occupation dura neuf mois ; les lettres écrites à Charles-Quint par l'abbé de Najera et Francisco de Salazar, témoins oculaires, font foi des exactions commises au Vatican : « Le palais pontifical est à sac, quelques appartements sont incendiés, et à l'heure oùje vous écris, les chambres précieuses sont devenues des écuries pleines des chevaux de la cava lerie et des cavaliers quiy loge... L'église de Saint-Pierre est à sac; la pièce qui recélait les saintes reliques est au pillage, elles jonchent le sol, la chapelle près de l'autel de Saint-Pierre ruisselle de sang et on y voit jusqu'à des chevaux morts... Il est probable pourtant qu'une restauration des appartements mis à nu pen dant l'occupation, mais qui ne furent pas sérieusement endommagés au point de vue de la décoration des parties supérieures et des fresques mêmes, fut effectuée dèsle second quart du xvi° siècle,puisque ce n'est qu'après 1585 queSixte-Quintles abandonna pourfixer sa résidence dans le palais de San-Damaso,restéjusqu'au jourd'hui palaispontifical. Les appartements vides servirent alors à divers usages, au moment où les offices exigent un déploiement considérable et un personnel plus nombreux que d'habitude. On sait par exemple qu'à la semaine sainte on y dressait lestables pour les Bussolanti, les aides des cérémonies, les huissiers, les écuyers, les chanteurs et les acolytes de la chapelle pontificale, les camériers des cardinaux de service, les officiers de la garde suisse et les sacristains. On pourrait aussi indiquer dans quelles circonstances elles ont servi aux conclaves ; les salles furent alors divisées par des cloisons provisoires, afin de trouver un nombre suffisant de celle pour tous les membres du Sacré-Collège. Cependant les appartements se prêtaient mal à cette appropriation à cause du manque de lumière, et ces diverses affectations successives menaçaient évidemment la con servation des fresques et un ensemble de décorations qui peut aller de pair I.-Les originaux de ces lettres sont dans la collection dite Salazar, à la bibliothèque de l'Académie de Madrid. Voir à ce sujet : « Memorias para la historia del asalto y saqueo de Roma ». Antonio Rodriguez Villa. Madrid, 1875 . 10 Don 74. LES MONUMENTS DES BORGIA. avec les plus beaux de l'Italie, et qui avait heureusement échappé à la bar barie des lansquenets. Au commencement de notre siècle, Pie VII imagina de constituer là toute la collection des peintures du Vatican, et d'y joindre quel ques beaux morceaux de sculpture antique épars dans les édifices. Cette des tination nouvelle ne devait pas être définitive; faite dans le but le plus louable, elle était peu raisonnée, puisque la décoration des salles elles-mêmes devait absorber l'attention des visiteurs et nuire singulièrement à l'intérêt des peintures exposées. En 1840 enfin, on transporta dans une autre partie de l'édifice toutes les toiles qu'ony avait rassemblées, et on fit des appartements une sorte de dépôt ou de succursale de la Bibliothèque Vaticane. M. Salvatore Volpini, qui est le guide le plus récent qu'on puisse prendre lorsqu'on visite cette partie du Vatican, veutqu'onyait disposéune grandepartiedes imprimés,auxquels est venu s'ajouter la bibliothèque célèbre provenant d'Angelo Mai, celle du pape Grégoire XVI et celle de Pie IX. Le pape Léon XIII aurait joint à son tour deux précieuses col lections de livres de médecine et de chirurgie, enfin nous y avons vu naguère les vitrines des manuscrits précieux, et, en vrac, le long des murs, des milliers de volumes qui méritaient un meilleur sort et avaient le tort grave de servir de prétexte à l'interdiction de visiter les appartements. Depuis cette affectation, ces chambres ont été fermées au public : ce n'estpoint à dire qu'elles aient été inaccessibles (elles n'avaient d'ailleurs jamais figuré sur l'itinéraire du Vatican, et, pour tout dire, Sthendal, si familier de Rome,de Saint Pierre, de la Sixtine et des Stanze, ne les a pas vues) ; mais si on n'avait point la ressource de relations précieuses, ou si l'occasion ne vous avait point mis en con tact avec quelque personne bienveillante qui tînt de près au Vatican, c'était une entreprise difficile de franchir le seuil des appartements, et une tâche presque impossible d'y stationner et d'étudier de près les œuvres du Pinturicchio. C'est ce qui fait qu'une étude comme celle qui précède n'est et ne peut être à l'heure présente qu'un essai. La situation esttelle encore que nous n'avons pu nous livrer à une étude prolongée, que nous avons dû nous borner à regarder jusqu'à l'hypnotisme, et qu'enfin, sans les éléments qui nous ont été fournis par le prince Ruffo, par le comte Lemmo Rossi Scotti, par M. Armstrong, et aussi par M. Woodhouse nous n'aurions pu présenter au public aucune reproduction à l'appui de nos observations, de nos notes et de nos souvenirs personnels. D'autres ont été plus heureux que nous, des influences intimes, le souvenir LES APPARTEMENTS BORGIA. 75 de Pérouse, toujours cher au souverain pontife, les a protégés ; c'est à une cir constance de cette nature que le Directeur du Department ofscience and art de l'Angleterre, M. Armstrong, a obtenu de pouvoir faire exécuter un petit modèle en relief au dixièmede l'original d'une partie de l'une des salles les plus intéres santes ' . On pouvait être plus ambitieux, mais ceux qui ont entrepris cette œuvre savent le temps et la « santa patienza » qu'ils ont dépensés avant de pouvoir agir. Tel qu'il est, le résultat de ce travail, exposé d'une façon permanente au Musée du South-Kensington,estun véritable bienfaitpour l'art. On saura désormais au Vati can tout le désintéressement qu'apportent à ce genre d'études ceux qui, comme nous, y consacrent leur vie et leurs ressources personnelles, et le jour est proche sans doute où les appartements Borgia seront accessibles comme les Stanze de Raphaël et la chapelle Sixtine. Cette preuve de l'intérêt que le Department of science and art attachait aux appartements, et l'écho des vœux constants exprimés par les historiens,les artistes et les curieux du monde entier, doivent être le pré lude d'une décision qui aura un grand retentissement : le pontife a demandé à M. Zeit, auquel on doit de beaux travaux dans lagalerie des candélabres du Vati can, un projet, sinon de restauration, au moins d'appropriation des appartements Borgia, dans le but de les rendre à l'étude et à l'admiration du public. Procédant avec prudence, l'artiste a demandé d'abord l'enlèvement de tous les livres et manuscrits déposés dans les salles, la restauration complète du Pavimento, d'après les carreaux qui existent ça et là (surtout dans la partie dela Tour Borgia), la réfection des vitraux dans leur ancienne forme, enfin un simple et prudent nettoyage des fresques elles-mêmes. On suppose que le pontife a l'intention de réunir dans ces salles ainsi restaurées, les orfèvreries sacrées, les parements, les broderies qui ont un caractère d'art et d'archéologie, tout un monde de curio sités relatives au culte, depuis les premiers temps de l'Église jusqu'aujourd'hui; formant ainsi un musée chrétien à la source même, au lieu de pèlerinage de la I. C'est à M. Consolari de Rome, auquel revenait déjà l'honneur d'avoir mené à bien l'exécution du modèle du grand monument à Victor-Emmanuel, qu'est dû le modèle du South-Kensington. Le comte Lemmo Rossi Scotti a exécuté la réduction des fresques ; nous lui sommes redevables de la communi cation des photographies directes obtenues par le prince Ruffo, photographies qui, faute d'une collection d'ensemble qui n'aura plus désormais aucune raison de ne pas exister, donne un certain prix à cet essai. M. le comte Joseph Primoli a bien voulu aussi nous aider dans la tâche de rassembler quelques docu ments. Nos neveux seront plus heureux que nous, nous savons ce qu'on perd à être un précurseur, et nous appelons de tous nos vœux un travail critique digne du sujet. 76 LES MONUMENTS DES BORGIA. chrétienté. Le projet est sérieux et la pensée dupontife prend une forme, le nom de M. Zeit restera attaché à ce travail. L'exposition du concours ouvert pour l'exécution des Maiolicheformant le pavimento a eu lieu avec beaucoup de succès, et on a préparé de nouveaux locaux pour y déposer les livres et manuscrits qui encombrent les salles. Puisse le pontife apporter à cette œuvre pacifique, qui ne peut, qui ne doit en tout cas rencontrer nul contradicteur puisqu'elle sera certainement unbienfait pour l'art, l'énergie, la résolution et le haut esprit qu'il a montrés déjà dans tant de circonstances DEUXIÈME PARTIE LES PORTRAITS DES BORGIA LI VS PP II En-tête de la Bulle deJules II rendant aux Gaetani les Biens enlevés parAlexandre VI. Archives des gaetani. DEUXIÈME PARTIE LES PORTRAITS D'ALEXANDRE VI Les médailles d'Alexandre VI. La fresque du Pinturicchio. Le portrait du musée de Valence (Espagne).- Le bustede Paul II au musée de Berlin. Un portrait d'Alexandre VI parle Titien au musée d'Anvers. Le frontispice de l'ouvrage de A. Gordon sur Alexandre VI. C'est un instinct de l'homme de rechercher les images des héros et de tous ceux qui ont marqué dans l'histoire par le génie, l'éclat de leur puissance ou la supériorité de leurs vertus; les Étres en dehors de l'humanité par leurs désordres et par leurs crimes n'échappent même point à sa préoccupation; tout en lui inspirant la terreur oule mépris, leurpersonnalité attire. Dans les traits des premiers, nous voulons voir les reflets de la noblesse, le sceau du génie, laflamme qui jaillit pour ainsi dire desgrandes âmes et brille dans leurs yeux; chez les autres nous aimons à constater les stigmates du vice, ceux de la cruauté, et les ins tincts pervers qui les ont dominés. Ces imagesdes devanciers, les hommes les demandentau bronze, au marbre et à la peinture; s'ils n'existent point, il la leur faut àtout prix; ils sauront l'inventer, et ils la restitueront : vient alors un artiste qui, d'une main adroite, modèle leurs traits d'après leur caractère et les met en harmonie avec la tradition; peu à peu le temps s'écoule, lalégende se forme,la fictiondevientvérité; et, aprèscinq siècles 80 LES MONUMENTS DES BORGIA. écoulés, c'est une rude tâche pour ceux qui ne veulent point être la dupe de ces faussaires parfois sublimes, de démêler la vérité du mensonge et de les con fondre. Des représentations de ces trois personnages, Alexandre, Lucrèce, et César, une seule, celle du pontife Alexandre VI est indiscutable; le Pinturicchio nous ayant laissé de lui une image superbe , nous n'avons que deux médailles de Lucrèce; et quant à César, ni le bronze, ni le marbre ne l'ont reproduit, et l'authenticité des images qui le représentent sont toutes contestées. Vingt musées ou collections d'Europe cependant nous offrent des portraits du Valentinois et de la duchesse de Ferrare; nous allons essayer de combler cette lacune et faire comparaître toutes ces représentations pour les soumettre à l'épreuve d'une critique qui s'armera pour conclure avec quelque autorité, de tous les renseigne ments contemporains des héros. ES MÉDAILLES D'ALEXANDRE VI. L'origine des représentations d'Alexandre VI qui lui sont contemporaines est telle que nous pouvons y ajouter une foi entière; mais par un caractère commun à laplupart des images des princes, des pontifes et des personnages duXV° siècle,elles sont toutes de profil et par conséquent ne donnent qu'une idée incomplète de sa physionomie. Si les monuments de la numismatique sont d'une importance capitale et peuvent servir de points de comparaison, de témoignage irréfutable, ils ont, à certaines époques, l'inconvénient grave de revêtir un caractère hé roïque, de prendre un aspect monumental qui transfigure le personnage et ne donne pas toujours unejusteidée desonaspect. Souventaussi l'exécution est rude, fruste, la matière, même maniée par un artiste de génie, semble à peine dégrossie, et nous ne trouvons parfois dans les représentations grandioses des Pisanello, des Matteo da Pasti et des Sperandio, que le geste général et la silhouette caractéristique. Presque jamais, alors qu'on les saisira si bien dans quelques médailles antiques d'une exécution précieuse, ou dans des effigies de la pleine renaissance italienne, française et allemande, on ne trouve de 1446 à 1500, dans les œuvres que nous citons,un de ces « signes particuliers » qui, àune époque où les traits des personnages représentés prennent tous un air de famille, permettrait de reconnaître à coup sûr le personnage et de l'identifier sans conteste. Il va sans dire que nous choisissons pour en faire les types auxquels nous LES PORTRAITS DES BORGIA. SPROPICORICO 81 allons soumettre les représentations d'Alexandre VI, celles de ses médailles qui sontcontemporaines, et que nous négligeons cellesqui ne sont que desRestitutions faites après coup pour former collection. La médaille que nous produisons ici est inédite, l'original est au Cabinet de Madrid, elle est anonyme, et son revers nous dit dans quelle circonstance elle a été modelée. Expliquons-en la légende : MO. AD. VAL. FOS. PROP. COR. Q. C. c'est-à-dire MOLEM. ADRIANUM. VALLIS. FOSSIS. PROPUGNACULIS. CORRIDORIS QUE. CINXIT. Et pour la traduction, en y joignant l'exergue de la face ALEXANDRE VI. Souverain Pontife, ami de la justice et dela の

Médaille d'Alexandre VI.- Commémorative des Travaux du Môle d'Adrien. (Fort Saint-Ange )
Anonyme.-Communiquée par M. Aloïss Heiss.
paix, ceignitparprudence le môle d'Adrien de remparts, de fossés et de passages souterrains. Le fait historique de l'ouverture dela communication secrète entre le Vatican et le fort Saint-Ange par Alexandre VI est constaté pour l'histoire; quant à l'image elle-même, tout en accusant de l'ampleur et une puissance de rendu dans la forme symbolique du môle, elle est rude, grossière, sans que le profil du pontife démente cependant l'image du Pinturicchio au point de vue de la construction. La seconde médaille que nous publions à la fin de ce chapitre est celle com mémorative du Jubilé de 1500;elle n'est point contemporaine, c'est une restitu tion de Paladino,mais si on compare le profil avec celui de la fresque du Pintu ricchio, on y retrouvera plus de fermeté, et on sent que l'artiste s'est inspiré d'un II H MOMO XANDERPON 82 LES MONUMENTS DES BORGIA. document sérieux. En somme, dans toute la numismatiquespéciale à Alexandre, le portrait semble copié d'après un même type¹ .-- P ORTRAIT D'ALEXANDRE VI. La Fresque de Pinturicchio. Dans le chapitre précédent nous avons insisté sur l'effigie d'Alexandre VI peinte vers 1493 ou 1494 dans les appartements Borgia; c'est là le monument par excellence ; nous avons fait observer que si la physionomie du pontife, représenté à genoux, les mains jointes, dans ses vêtements pontificaux, présente au point de vue de l'ensemble un aspect de grandeur incontestable tout en conservant la réalité de la vie, elle n'est pas tout à fait conforme aux descriptions que nous ont laissées les orateurs étrangers représentant les divers souverains auprès du trône de saint Pierre. Alexandre, né en 1431, n'était âgé que de soixante-trois ans au moment où le Pinturicchio l'apeint dans son propre appar tement ; en face de son modèle, il travaillait d'après nature, et non plus d'après des documents plus ou moins exacts. Paolo Capello , dans la lecture de sa relation de son ambassade à Rome faite au Sénat, en septembre 1500, nous fait du pontife un croquis, tracé aussi d'après nature, qui jure d'autant plus avec celui du Pinturicchio que l'artiste peignait le pontife en 1494. « Le pape dit l'ambassadeur a soixante-dix ans, chaque jour il rajeunit, ses préoccu pations ne durent qu'une nuit, il veut vivre, il est d'une nature joyeuse, et ne fait que ce qui tourne à son avantage. » Si on considère que Capello parle d'Alexandre six années pleines après que Pinturicchio l'a peint, le personnage I. M. Aloyss Heiss, l'auteur des Médailleurs de la Renaissance (J. ROTHSCHILD, éditeur), auquel nous devons le moulage de la médaille inédite de Madrid, compte sept médailles d'Alexandre : 1º Celle que nous reproduisons ici ; 2º Une autre dont le revers est à peu près le même (T. Numism. méd. ital., t. I, pl. xxv, 5), d'un travailplus fin que le nº 1, mais moins sculptural elle est l'œuvre d'un ferrarais, graveur en monnaies, nommé Giovanni Maria; 3. Une pièce avec le couronnementd'Alexandre VIque M. Friedlænder attribue au Caradosso,— attribution que n'admet pas M. Milanesi qui observe que le Caradosso n'avait pas quittéMilanpendant le pontificatd'Alexandre VI ; 4º Une pièce avec l'écusson des Borgia au revers (T. N. méd. papales, pl. m, nº 6) et le profil de Paladino (qui est une restitution de la fin du xvre siècle); 5° La pièce du Jubilé (que nous donnons en cul-de-lampe), qui est également une restitution de Paladino ; 6. Un bronze, avec au revers un bœuf couronné (allusion aux armes des Borgia, qui pourrait être du temps, (T. N. méd. ital. , t. I, pl. xxv, 5) ; 7º Un dernierbronze enfin, avec une croix grecque ornée de huit rosaces au revers (T.N.méd.ital., t.I, pl. xxv, 3 qui a toutes les apparences d'une restitution, le revers se rencontre sur des pièces de la fin du xvie siècle. 2. Paolo Capello. Relation au sénat, citée dans Sanuto, tome III, col. 846-7. LES PORTRAITS DES BORGIA. EXANDER YSEXTVS 83 semblera encore moins flatté, et l'artiste nous aurait donné alors un portrait d'un caractère absolument réaliste. Ce n'est cependant pas le seul témoignage qui nous reste, nous avons un autre document de la main du même artiste; c'est un panneau ruiné, mais très précieux, conservé aujourd'hui au Musée de Valence (Espagne), qui aurait été exécuté en 1492 pour le cardinal Francesco de Borgia, cousin du pontife, qui fonda à Jativa la chapellede Notre-Dame des Fièvres, et la dota d'une rente de cent ducats. Schmarsow, le biographe autorisé du Pinturicchio, a cité ce por trait en le faisant figurer dans son œuvre. Nous mettons sous les yeux ce monu ment dans toute sa vérité, reproduit par des procédés qui ne permettent point d'interprétation, et sont le plus sûr garant du carac tère d'un document. L'œuvre est singulièrement ar chaïque encequiconcernelesdeuxpersonnagesdivins, le pli rectangulaire fait penser aux primitifs de l'école de Sienne, on n'y sent la nature directement consultée que dans le portrait lui-même qui, il faut l'avouer, ☑ rappelle beaucoup celui des appartements par l'atti tude et le geste. Les lecteurs observeront toutefois que l'un des traits caractéristiques de la physionomie du pontife c'est la courbure du nez, toujours très accen tuée dans les médailles, et qui est conforme dans la fresque des appartements. Or ici, le nez est droit et, à moins d'une restauration du profil dans laquelle aurait disparu la courbure, signe particulier du visage, nous avouons que si respectable que soit l'origine de l'œuvre, cette circonstance doit faire naître un doute sur l'identité du personnage représenté. Cette identité cependant n'a jamais été mise en doute, mais jamais non plus la critique n'a rassemblé pour les rapprocher les uns des autres les éléments de

Le Pape Alexandre VI.
(Fac-similéd'une Gravureancienne).
comparaison. Je vois bien là, sur le piédestal qui supporte le Christ enfant, les armes des Borgia, mais je ne vois pas les clés pontificales, et aux pieds du per sonnage, ce n'est point le trirègne qui sert de premier plan, mais bien la mitre des archevêques, à forme angulaire. Je ne sais point non plus si le surplis blanc dont les manches coupent la tunique sombre sont l'attribut du saint Père, etnon point celle d'un prélat; et pour toutes ces raisons je me demande s'il ne faudrait pas voir dans le donataire de laViergede la chapelle de Notre-Damedes Fièvres, PONTIFEX MAXIMV 84 LES MONUMENTS DES BORGIA. le cardinal François Borgia lui-même, né à Sueca près de Valence, cubiculaire, évêque de Teano, archevêque de Cosenza, trésorier du pontife Alexandre et son cousin, qui n'était pas encore cardinal à l'époque del'exécution duportrait. Je n'insiste pas davantage, les documents sont lisibles , le lecteur conclura. Mais s'il est possible que le souverain SKARTA GRA A

Alexandre VI.- Panneau du Pinturicchio au Musée de Valence.
Communiqué par Don Francisco de Madrazo, Directeur du Musée de Madrid.
pontife envoie son portrait à la chapelle de Notre-Dame des Fièvres, il est plus natu rel encore que le fondateur de ladite chapelle y soit re préesntéen adoration devant la Vierge. Ce panneau précieux et vénérable a son histoire; il figurait encore en 1818 dans la chapelle, mais les mem bres de la fabrique en fai saient peu de cas à cause de sa vétusté; le peintre Don Francisco Llacer ayant reçu alorslacommanded'unnou veau tableau représentant la Madone des Fièvres, la fa brique, afin de lui venir en aide, lui envoya comme ren seignementl'original duPin turicchio, quel'artiste garda dans son atelierjusqu'en 1830 et où le restaurateur du musée de Madrid, Salvator Martinez Cabelly, eut l'occasion de le voir. Vers 1850, le panneau, quoiqu'on eut souvent offert à la fabrique de le reprendre, était encore dans l'atelier; enfin LES PORTRAITS DES BORGIA. 85 une dernière sommation de l'enlever étant restée sans réponse, l'artiste l'envoya à l'Académie de Valence, où le président d'alors, Don Francesco Carbonell, accepta le dépôt. L'œuvre y figure encore. Don Frederico de Madrazo, l'honorable directeur du Musée de Madrid, chez qui nous avions vu une copie exécutée par lui d'après ce précieuxpanneau, a bien voulunouscommuniquerunephotographiefaiteàValenced'aprèsl'originalméme. Laurentdel

Alexandre VI présente à Saint Pierre Pesaro, Capitaine général de l'Église.
(Tableau du Titien au Musée d'Anvers )
Nous reproduisons ici un superbe buste qui figure au Musée de Berlin, cata logué sous le nom de Paul II; une ressemblance réelle avec Alexandre VI a porté quelques amateurs à prendre cette représentation monumentale et d'un aspect superbe pour celle d'Alexandre VI. Ce fut un instant le cas de M. W. Bode lui même qui, dans un travail publié en 1883 (Bustes italiens duxv siècle, page 195) écarte l'hypothèse d'un portrait de Paul II pour des raisons tirées de la forme du menton, moins proéminente. M. E. Müntz, à son tour, a vu là un Borgia, et, s'appuyant sur une gravure ancienne que nous reproduisons ici, il tientpour son opinion première. Devant de telles autorités ceux qui se croient les mieux ren 86 LES MONUMENTS DES BORGIA. seignés ne peuvent que devenir hésitants et timides, mais j'ai recommencé mon enquête, et m'en tiens à Paul II. Une comparaison attentive de lafaceet du profil du buste avec la plupart desgravures des divers cabinets d'estampes de l'Europe autorise cette conclusion. J'ajoute que le buste a été acheté à Berlin sous le nom de Paul II; je vois donc là Barbo, vénitien élu en 1464, qui a régné six ans. La caractéristique de la figure, la diffé rence entre les deux types, est dans le grand espace qui sépare le nez de la bouche et la perpendicularité de cette partie du visage, tandis que chez Alexandre, cette ligne est oblique. Le buste de Berlin, vu de face, présente aussi une disposition très particu lière des mèches dufrontqui,partagées dans l'axe, tombent assez bas sur chacun des yeux et sont frisées avec recherche ; ce n'est point le cas pour Alexandre VI.

Buste de Paul II au Musée de Berlin.
Une composition du Titien qui figure au musée d'Anvers nous montre Alexandre VIprésentant àsaintPierre un capitaine de l'Église. Le document n'est pas contemporain, cela va de soi, mais, outre que ce grand artiste peint d'après des documents sérieux, la simple comparaison de la gravure avec la médaille du jubilé prouve qu'il a puisé à bonne source. Le pontife, qui porte la tiare, tient à la main le vexillum; le personnage présenté est un Pesaro, de la famille vénitienne, qui aurait été évêque de Paphos ; le cas est bizarre, mais le capitaine général de l'Église tenant lui-même l'étendard et ayant son casque à ses pieds, il n'y a nulle méprise; on remarquera qu'il porte lesolideo, qui cache la tonsure, et qu'il revêt le surpli et le manteau des prélats. Nous tenons le document pour d'autant plus curieux que tous les attributs sont conformes, et que, dans l'original (qui par sa dimension, rend mieux les traits du pontife LES PORTRAITS DES BORGIA. NDOVI PO 87 qu'une reproduction réduite comme la nôtre), Alexandre VI est absolument identique aux deux médailles les plus caractéristiques et à la fresque elle-même. Enfin, encore que ce soit l'œuvre d'un graveur du xvII° siècle, et qu'il n'y ait pas là un témoin contemporain, nous repro duisons aussi un fac-similé du portrait d'Alexandre VI qui figure en tête de l'ou vrage d'Alexandre Gordon,dédié au duc de S Mantoue : La vie du pape Alexandre VI et de son fils César Borgia¹. Ce portrait, gravé par Bernaerts, pourrait avoir eu pour source un document qui nous a échappé; le pontife paraît là dans son attitude puissante, avec le cou nu, sa force physique et la robuste allure qui le caractérisent d'après tous les récits du temps. C'est sûrement un portrait de facture pour lequel l'artiste a consulté un document assez vivant ; le portrait est

Alexandre VI.
(Frontispice de l'Ouvrage de A. Gordon).
peu sérieux comme document, maisil faut tout connaître dans cet ordre d'idées : il ne contrarie d'ailleurs en rien l'idéal qu'on se fait du sensuel pontife. I. Voir la traduction française imprimée à Amsterdam, chez Pierre Mortier, 1732 . LESSA R ANDROV PON
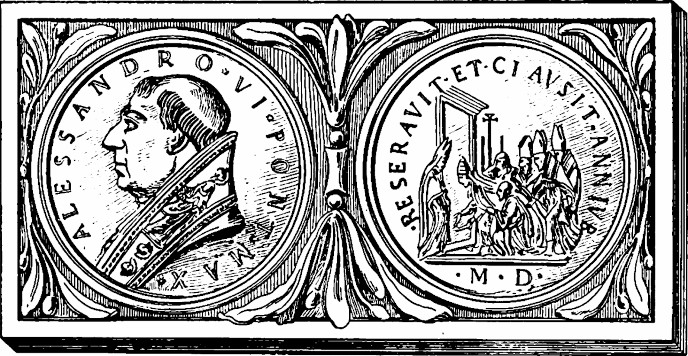
Médaille d'Alexandre VI. ― Commémorative du Jubilé de 1500.
MD VW VITET- CIAVSIT ANNIVA LEN ZVOLAD FORG ㅇㅇ

César Borgia d'après Paul Jove. ― La Frise est tirée d'une Gravure de Maître Hercule.
LES PORTRAITS DE CÉSAR BORGIA Mettons tout d'abord sous les yeux du lecteur, comme si nous en admettions l'authenticité sans conteste, le célèbre portrait de César attribué à Raphaël, qui fait partie de lariche collection du Palais Borghèse à Rome. Un des portraits les plus séduisants qui soient au monde, image à la fois vivante, psychique et mys térieuse ; depuis plus de deux siècles elle sert de thème aux générations et elle a acquis l'autorité que donne une longue tradition. D'où vient l'œuvre et où sont ses titres ?- Personne ne peut répondre à cette question ; pas même le chef actuel de la famille Borghèse. C'est en vain que le prince a tenté de remonter à l'origine en interrogeant les archives de la famille, le portrait n'a pour lui qu'une tradition qui date de plusieurs siècles, et aucun document ne nous atteste sa provenance. La reproduction que nous donnons ici de cette image célèbre aide à la décrire; directement faite sur l'original, elle saura le rappeler à ceux qui ont visité le palais des Borghèse. Le prétendu César est debout, peint jusqu'à mi-corps, la main droite sur la poignée de son épée, la gauche largement ouverte et campée 0000

CÉSAR BORCIA (?)
Galerie Borghèse à Rome.
LES PORTRAITS DES BORGIA. 89 sur la hanche ; revêtu d'un justaucorps à trois rangées de boutons dont la manche gauche seule montre des crevés de satin à la mode des lansquenets d'Allemagne ; il porte sur la tête une toque noire ornée de perles, ombragée d'une plume. Le front, très haut et très pur est dégagé des cheveux, ramenés en arrière, une barbe d'un ton châtain, séparée par le milieu, retombe en larges mèches sur sa poitrine, les yeux largement arqués et ombragés de sourcils nettement dessinés, semblent jeter des flammes; toute la physionomie respire la jeunesse, l'élégance et la force. Or, non seulement la plupart des juges les plus compétents de l'Europe se refusent à voir dans cette œuvre le portrait authentique de César, mais personne aujourd'hui n'ose plus prononcer à son sujet le nom de Raphaël. Longtemps encore cependant les pèlerins du monde entier qui traversent la ville éternelle persisteront à s'attacher à une tradition qui résiste à tous les efforts de la critique moderne ; et le modèle audacieux, séduisant et perfide, sorte de sphinx auquel on voudrait arracher son secret, s'imposera toujours à l'imagination de ceux qui veulent trouver dans cette image le reflet vivant des singuliers contrastes qu'offre dans l'histoire le terrible fils du pape Alexandre VI. Qui donc, le premier, a osé contester l'authenticité du portrait?- Depuis une vingtaine d'années déjà, la comparaison de l'âge du peintre avec l'œuvre, et celle de l'âge du modèle avec les conditions, mieux connues, de l'histoire de sa vie, avaient fait naître l'incertitude; le doute existait déjà, quand une affirmation très nette, exprimée par un historienillustre, le plus autorisé de ceux qui ont tenté de restituer laviede Lucrèce Borgia, Ferdinand Grégorovius, vint porter à latradition un coup dont elle ne devait plus se relever. « Il n'existe, a dit l'auteur de l'His toire de Rome au moyen âge, aucun portrait authentique de César Borgia, celui du palais Borghèse a été baptisé de ce nom sans aucune espèce de fondement' . » Les critiques les plus compétents allaient à leur tour saper la légende qui attribue le portrait à Raphaël ; MM. Crowe et Cavalcaselle, Morelli, E. Müntz, tous ceux qui se sont attachés au Sanzio, repoussaient l'attribution en donnant deux sortes de preuves, des preuves techniques et des documents biographiques ; le dernier des historiens du peintre d'Urbin, homme d'État habile, brillant ora teur, parfait humaniste, M. Marco Minghetti, qui devait être bientôt enlevé à I. Storia della Città diRoma nelmedio Evo.-Traduction italienne (Gregorovius), vol . VII, p.105. 12 90 LES MONUMENTS DES BORGIA. l'affection de ses amis, à Rome même, à deux pas du palais Borghèse, ache vait la ruine de la tradition dans un livre où il résumait les plus récentes décou vertes sur le Sanzio' , en affirmant la négative sans même se donner la peine de la prouver, comme si elle était hors de discussion, et donnant pour raison péremptoire que le costume du personnage appartient à la deuxième moitié du xvi° siècle. Voyons donc qui aurait pu peindre César, où et quand il a pu poser, si ses traits sont connus, et par quel document ils pourraient l'être. Un certain nombre d'artistes hantaient alors le Vatican; ont-ils laissé un portrait, une fresque, une médaille, œuvre contemporaine d'Alexandre VI, à laquelle on pour rait comparer les portraits prétendus de César et qui pourrait servir de base à une discussion sérieuse ? Borgia est né en 1476; il meurt dans sa trente et unième année, après avoir quitté Rome en 1503 et l'Italie en 1504. Dès lors, prisonnier d'État, enfermé dans une forteresse au nord de l'Espagne, célé à tous les yeux, il s'enfuit de sa prison à la fin de l'année 1506 pour tomber trois mois après en Navarre, en mars 1507. Jusqu'en 1498 il est cardinal de Valence, et n'a été relevé de ses vœux que pour venir en France épouser la sœur du roide Navarre, Charlotte d'Albret, le 12 mai 1499; il n'en reviendra que pour prendre le commandementdes troupes pontificales et entreprendre la campagne des Romagnes, en 1500. J'écarte tout d'abord l'objection, qui paraît grave, du costume séculier porté par un cardinal; car il est avéré que César seplaisait à s'habiller en cavalier espa gnol, et d'ailleurs, il est impossible, en regardant l'image du palais Borghèse, d'y voir un homme de moins de vingt-sept à vingt-huit ans au moins, et César n'appartient plus à l'Église. Tout portrait de César homme fait, dans l'âge où il est ici représenté, n'a pu être exécuté par un peintre italien que de 1503 au prin temps de 1504; passé cette époque, si on veut admettre qu'il a pu poser devant un peintre, il faudrait que l'artiste ait opéré en Espagne, dans la prison de Chin chilla de la province de Valence, ou dans celle de Médina del Campo au nord de la Péninsule. Dans ce cas bien peu admissible (on ne fait pas le portrait d'un 1.-Raffaello, par Marco Minghetti, Nicolas Zanichelli, 1885.-« Nella galleria Borghèse, è un ritratto che dicesi di Cesare Borgia. Ma non credo vi sia oggimai alcun intendente di belle arti che non lo rico nosca per opera del Bronzino, oltreche il personaggio per il costume che porta appartiene a mezzo secolo dopo Cesare Borgia. » LES PORTRAITS DES BORGIA. 91 prisonnier qu'on garde à vue), il faudrait que l'œuvre dénonçât son origine espa gnole, et ce n'est pas le cas pour le portrait Borghèse. Voilà l'époque nettement et irréfutablement circonscrite ; menons de front les deux enquêtes et voyons si, en admettant que César ait posé devant Raphaël dans la dernière année de son séjour en Italie, c'est-à-dire vers 1503, l'artiste était en âge et en situation de le peindre ; et examinons si l'œuvre elle-même, par son caractère, répond à la manière du peintre d'Urbin à cette époque. Né le vendredi saint de l'année 1483, le Sanzio a dix-sept ans en 1500 ; cette année-là, il est à Pérouse, près du Pérugin; on sait qu'il se dégagera assez tard des influences de ce maître et de celles de Timoteo delle Vite. Il restera dans cette villejusqu'en 1502, reparaîtra à Urbino en 1504, et, dans le cours de la même année, ira se fixer à Florence. Ce n'est que quatre années plus tard, en 1508, que le jeune artiste viendra pour la première fois à Rome où, par une lettre datée du 5 septembre de cette année, lettre adressée à Bologne à Francesco Francia, il constate qu'il ne peut plus suffire aux commandes. Le 14 octobre 1500, César a bien passé quelques jours à Pérouse et, à la rigueur, il aurait pu y rencontrer Raphaël ; maisle peintre des Stanze n'a que dix-sept ans, non seulement il n'est ni consacré ni même connu, mais la date de la seule œuvre qu'on connaisse de lui à cette époque est contestée, et toutes les œuvres qu'il peindra jusqu'à sa période flo rentine se ressentent si fortement de l'empreinte de ses maîtres qu'on hésite parfois à les lui attribuer. César Borgia, à ce moment, a pour peintre officiel, vivant à ses côtés comme son pensionnaire, Bernardino Betti, le Pinturicchio, qu'il a connu de tout temps; celui-ci apeint son portrait sur les murs du château Saint-Ange, et il a décoré, de 1493 à 1495,les appartements des Borgia. C'est dans ces circonstances que César a pris le peintre en affection, il le revoit à Pérouse à son passage, scelle avec lui des relations nouvelles, lui accorde une concession sur sa demande et en avise dans les termes suivants le vice-trésorier chargé d'exécuter ses ordres : « Bernardino nous a toujours été cher à cause de ses mérites et, de nouveau, nous venons de l'attacher à notre personne. » Toutes les probabilités sont donc contraires à l'hypothèse de l'exécution d'un portrait par Raphaël : l'artiste est trop jeune, il est trop loin, et de plus il est tout à fait obscur; cependant, comme on ne se flatte point de connaître toutes les circonstances de la vie des artistes et que celui-ci est d'une précocité rare, si l'œuvre se dénonçait ouvertement comme une œuvre de son pinceau, on serait 92 LES MONUMENTS DES BORGIA. embarrassé malgré l'absence de concordance de l'âge du modèle avec celui du peintre. Voyons donc le côté technique de la peinture, et, pour ne point tomber ducôtéoù nouspouvons pencher, appelons à nous les grands experts de l'Europe. L'honorable sénateur italien, M. Morelli, est le premier en date ; il vit à Rome en face du portrait Borghèse; il l'a étudié et a même donné consultation sur le sujet : « Che ilcuadro nonpossa essere diRaffaello; credo che si ammetterafacil mente dagli amicie conoscitori dell'arte i piu corti e superficiali ¹ . » Cela dispen serait du reste, mais l'écrivain, lui aussi, rappelle les incompatibilités des dates fournies par l'histoire. « Quel malheur, dit-il, que ceux qui ont prononcé le nom de Raphaël aient oublié que la carrière politique du héros est terminée vers la fin de l'année 1503. Si les traits du modèle étaient vraiment reproduits sur ce panneau par la main de Raphaël, le dessin aussi bien que la facture devraient révéler la première manière de l'Urbinate (entièrement péruginesque), dont il n'existe pas trace dans ce tableau... »- Et le voilà en face du panneau, l'exami nant en expert : « Observons avec soin le portrait : le cavalier porte un béret noir à plumes, un pourpoint noir à manches, à crevés et à manchettes; sa main droite repose sur la garde de son épée, la gauche s'appuie sur la hanche. La forme du vêtement indique, dans ce pseudo-César, un gentilhomme florentin du premier tiers ou du premier quart du xvi° siècle, et si on enlève l'épais vernis jauni par le temps, qui recouvre la peinture,je ne crois pas me tromper en disant qu'ilprésen terait à nos regards un tableau du Bronzino, avec l'émail propre à ce maître, le froid coloris de ses chairs, et ses yeux fortement, durement creusés. La raideur élégante de la pose nous révèle aussi le Bronzino; elle est presque identique à celle des portraits du Panciatici des Offices, et à celui du Giannetto Doria de la galerie Doria Pamphili à Rome. Le dessin de la main fait aussi penser à l'École d'André del Sarto et surtout au Pontormo. Pour conclure selon ma conviction, ce soit-disant César Borgia attribué à Raphaël n'est pas d'une autre main que celle d'Angelo Bronzino. » M. Morelli, on le voit, est singulièrement affirmatif; écoutons maintenant le Dr Wilhelm Bode, le savant conservateur du Musée de peinture de Berlin : « Quant au portrait qu'on regarde comme celui de César Borgia dans la galerie Borghèse, je suis sûr que le tableau n'est pas du temps de César et qu'il n'est pas 1.–« Que le tableau ne puisse pas étre de Raphaël,je croisque le fait sera facilement admispar tous les amis et connaisseurs de l'art les plus courts de vue et les plus superficiels.>>>

PRÉTENDU PORTRAIT DE CÉSAR. ― MUSÉE CORRER DE VENISE
LES PORTRAITS DES BORGIA. 93 deRaphaël. Jedoute qu'ilsoit du Parmegianino ou de Bronzino, etcertainement il n'est pas de Giorgio Perez, leur contemporain. Pour moi, c'est un tableau italien de 1525 à 1530 à peu près, et d'un maître florentin comme le Rosso; pour l'attri buer à Bronzino ou à Parmegianino, je le trouve trop brun et trop chaud. » M. Morelli avu là une œuvre de 1525 à 1535, M. Bode se maintient dans les mêmes termes. Le premier a cité Bronzino (mais Bronzino bruni, chauffé, cuit par des vernis successifs); et c'est justement cet aspect chaud (artificiel selon M. Morelli) qui empêche M. Bode d'attribuer l'œuvre au Bronzino. Invoquons un troisième témoignage, considérable aussi, celui de l'un des auteurs de l'Histoire de la peinture dans le nord de l'Italie. « J'ai revu mes notes sur le Borgia du palais Borghèse, m'écrit M. Crowe, le panneau est ancien, les mains rappellent Parmegianino, elles sont minces, osseuses, grandes, mais peu charnues. La surface lisse ferait penser au Bronzino, le fond rappelle la manière de Raphaël, telle qu'elle était pratiquée par Jules Romain, mais le tout est telle ment altéré par des repeints qu'on ne peut véritablement émettre avec certitude aucune opinion. » M. Mundler, qui a joui d'une réputation sérieuse comme connaisseur, pense au « Parmegianino » ; quant au célèbre auteurdu Cicerone, Jacob Bur ckardt, il cite le nom de « Giorgio Perez » (que M. Bode repousse); mais, en somme, de tant de savants témoignages, pas un ne conclut à un artiste de la fin du xv° siècle, ou des toutes premières années du xvi°. Et, en effet, comment pou vaient-ils y penser?- si le portrait avait été fait sur nature entre 1500 et 1504 (pour concorder à l'extrême rigueur avec l'âge du modèle), on devrait avoir devant les yeux une œuvre d'un des derniers Quattrocentisti, d'un homme qui a connu les primitifs; tandis que celle-ci, très libre, très avancée, d'un relief extraordinaire, dénote une main preste, audacieuse et qui s'est affranchie du modèle. Nous pourrions déjà résumer le débat en ces termes : Si c'est là le portrait de César, il n'est point de la main de Raphaël; si l'œuvre doit être attribuée au peintre d'Urbin, elle n'estpointl'image de César. Mais dégageons mieux le terrain et posons cette première conclusion que personne ne se refusera, je suppose, à accepter :- Leportrait de la galerie Borghèse est de beaucoup postérieur à César Borgia;- iln'estpas de la main de Raphaël; et nous ajoutons : s'ilreprésente César (car nous ne voulons encore ni l'affirmer, ni le contester),- il n'a pas pu 94 LES MONUMENTS DES BORGIA. être exécuté d'après nature : c'est-à-dire que nous serions en face d'une restitution faite d'après quelque document précieux qui a disparu.
CÉSAR BORGIA D'APRÈS LES CONTEMPORAINS. Appelons un à un en témoignage les contemporains de César, pour savoir quels sont, entre 1500 et 1503, et son extérieur, et ses traits ? Le fils du cardinal Rodrigue Borgia et de la Vannoza Catanei, né en 1476, youé à l'Église dès l'âge de douze ans, est devenu un personnage par suite de l'élection de son père au pontificat en 1492. Nommé à seize ans archevêque de Pampelune ; à dix-sept ans il est cardinal de Valence; rongé par l'ambition, à vingt-deux ans, il a déjà rejeté la pourpre, et, ayant ceint l'épée, nommé capitaine général de l'Église, commence sa carrière politique. Par suite d'une alliance avec le roi de France qui rêve la conquête du Napolitain et sollicite une grâce du Saint-Siège, César épouse Charlotte d'Albret, sœur du roi de Navarre; avec l'aide de nos lances, il entreprend d'abattre les petits tyrans des Romagnes ; trois campagnes successives vont lui permettre de ceindre la couronne ducale, et il signera : César de France, Duc de Valentinois, Duc des Romagnes, Capitaine général de l'Église, Gonfalonier, Seigneur de Piombino, de Faënza, d'Imoli, de Cesena, de Rimini, de Pesaro et de Fano. Tel est le personnage que nous devons avoir devant les yeux à l'âge que nous présente le modèle. Nous n'avons trouvé nulle part un portrait exact ou une description précise faite d'après nature par un témoin oculaire autorisé; cependant tous les ambassadeurs des princes d'Italie qui viennent rendre hommage au jeune prince, les courtisans, les poètes lauréats, les chroniqueurs, et aussi les seigneurs de l'état-major de Charles VIII qui ont vu César à Chinon lors de son mariage, ont célébré sa beauté, sa tour nure, sa recherche excessive dans les habits, son luxe extraordinaire; et quand les Français trouvent qu'il est bellâtre, efféminé et qu'il a « vanité et bombance sotte » , les orateurs et les envoyés des princes le qualifient : biondo, bello, bellis simo, realissimo; et tous s'entendent pour vanter sa fière tournure. Boccaccio, envoyé du duc de Ferrare auprès de la cour Pontificale, est celui qui nous a laissé le premierportrait qu'on ait du héros, mais s'il est assez piquant dans sa forme succincte, il nous est de peu de secours, car il l'a tracé au moins dix ans avant l'âge du portrait Borghèse. « L'autrejour je fus trouver César dans son palais du Transtevère; il partait LES PORTRAITS DES BORGIA. 95 pour la chasse, en habit tout à fait mondain, c'est-à-dire vêtu de soie et en armes, une petite tonsure rappelait seule en lui l'homme d'Église... C'est une personne d'un esprit supérieur et d'un naturel exquis ; ses manières sont celles d'un prince; il est d'une humeur particulièrement sereine, d'une grande gaieté, tout en joie (è tutto festa)... Doué d'une modestie haute, son aspect est de beaucoup supérieur en grâce et en dignité à celui de son frère, le duc de Gandia, qui ne manque pas non plus de qualités. L'archevêque n'a jamais eu de goût pour le sacerdoce. » Nous sommes plus heureux avec Antonio Cappello l'ambassadeur de la Sérénissime, car il le voit juste au moment où on aurait dû le peindre : « César Borgia a vingt-sept ans, il est très beau de corps, grand, bien fait, plus beau encore que le roi Ferdinand 1. Il est realissimo, très prodigue, ce qui déplaît au pape ; s'il vit, il deviendra un des plus grands capitaines de l'Italie. » Le crayon est flatteur, mais il est trop sobre de détails; les envoyés louent toujours la desinvoltura, l'aspect, la gaieté, l'esprit et la force de l'homme ; par-ci par-là aussi, on a des descriptions de costume; une fois même, on voit le Valen tinois entrer en danse, masqué, à Ferrare, au mariage de sa sœur, et, faisant des passes en solo, dénoncer son personnage par sa grâce unique, on dit de lui : « l'unico Cesare ». Mais nulle part nous n'avons un signalement net qui nous fournirait un terme de comparaison. Quand l'historien Grégorovius va tracer de main de maître son portrait historique, qui résume bien l'impression que laisse la lecture de tous les témoignages contemporains , tout en affirmant la beauté du monstre, il se tiendra encore dans des généralités. « Comme Tibère dans l'antiquité, dit l'auteur de Rome au moyen âge, César Borgia était le plus bel homme de son temps ; la nature lui avait prodigué ses dons les plus heureux ; robuste de corps il avait la force d'un athlète. Jamais il ne se laissait entraîner par l'ivresse des sens qui, chez lui, restaient au service d'une intelligence froide et aiguisée. Sur les femmes il exerçait une attraction magique, mais son action était plus énergique encore sur les hommes, il avait le don de les désarmer... » Il n'y a évidemment pas incompatibilité entre ces descriptions et l'image Borghèse; la physionomie est à la fois énergique et séduisante, la tournure élé I. d'Italie. L'héritier d'Aragon, prince royal de Naples, était regardé alors comme le plus beau prince 96 LES MONUMENTS DES BORGIA. gante, l'accent a de l'autorité et de l'audace jointe à une sorte de maestria qui correspond aux témoignages; mais, je le répète, ce sont là des traits généraux qu'on retrouve dans bien des portraits, et comme aucun témoin oculaire n'a indiqué un trait précis, un accident de la forme, ce qu'on appelle en terme de signalement, un signeparticulier, le contrôle par comparaison devient impossible. Je me trompe, un contemporain de César, Paolo Jovio, évêque de Nocera, biographe de César, a donné de l'aspect de son visage et de l'ensemble de sa phy sionomie une impression rapide et caractéristique; mais, en la lisant, le trouble et l'indécision redoublent, tant le témoignage contraste avec celuides historiens et des autres contemporains. Rejettant alors tous les documents écrits, plus ou moins suspects suivant les passions qui animent ceux qui nous les ont légués, nous ne voulons plus soumettre à notre critique que les monuments contempo rains pour y trouver le portrait type indispensable comme point de comparai son. Nous allons les faire comparaître et les examiner tour à tour. ES MÉDAILLES DE CÉSAR BORGIA. LENT DVX Les travaux les plus récents ayant pour objet la numismatique italienne, ceux de M. Friedlænder, de M. Armand, et de M. Heiss, ces derniers si complets au point de vue des représentations, sont muets au sujet de César Borgia. Notre enquête per sonnelle dans les divers cabinets de l'Europe nous a mis en présence, au Musée Carrara, à Bergame, d'une médaille probablement unique, mais si certainement apocryphe que nous ne pouvons pas la discuter et que les écrivains cités ci-dessus n'en ont même pas tenu compte. On pourrait lui donner pour pendant une CAESAR BOR autre restitution, connue des amateurs, gravée dans l'ouvrage de Guillaume Roville, imprimé à Lyon, en

Image de César, d'après Guillaume Roville. (Promptuaire des Médailles.)
1553, sous le titre de Promptuaire des médailles. La critique n'a pas compté davantage avec ce document, et elle a eu raison, il n'y a point à douter qu'il ne soit inventé par l'auteur¹. On verra toutefois que ces deux apocryphes ont la même origine, et, par là, qu'ils corroborent les conclusions I. Guillaume Roville avait de « la science, dit Baillet, mais ce qui l'a particulièrementfait connaître à la postérité, est la curiosité qu'il avait pour les portraits : il n'épargnait aucune dépense pour tirer VA GIA 1 LES PORTRAITS DES BORGIA. 97 de ce travail. Detoute façon les deux documents n'étant pas du temps de César, il n'y a pas lieu de s'y arrêter davantage. Afin de ne rien négliger dans la numismatique de ce qui porte le nom de César, indiquons une médaille de Pie III, le successeur d'Alexandre VI, qui ne régna que vingt-sept jours, au revers de laquelle on voit un gonfalonier de l'Église en armure, agenouillé devant le pontife, le vexillum à la main. L'image du personnage représenté en pied est à une échelle si minime qu'on ne peut en tenir compte que pour l'inscription 1503 gravée en exergue, date à laquelle César fut reconnu par Pie III comme capitaine général de l'Église. A SCULPTURE. —La sculpture est muette aussi, et, jusqu'àpreuvedu con traire, nous croyons pouvoir dire qu'aucun musée, aucune collection célèbre, n'offre une statue, un buste ou un médaillon, bronze ou marbre (du xv° siècle ou des premières années du xvi°) surlequel on lise le nom de César, ou qui le représente, au dire d'une tradition déjà consacrée. Nos recherches spéciales à la Bibliothèque du Vatican et dans tous les dépôts des Romagnes où se trouvent les manuscrits des capitaines de César, ceux des poètes, des humanistes et des chroniqueurs de son entourage, ne nous ont offert ni uneillustration, ni une lettre ornée, ni une composition, où, renseigné comme nous croyons l'être, nous ayons pu reconnaître le personnage. ES FRESQUES. Voyons désormais les fresques. Du vivant même de César, deux grands artistes,le Pinturicchio et Cosimo Roselli, ont cer tainement représenté les traits du fils d'Alexandre, soit dans des por traits, soit dans des compositions d'ensemble. Vasari a décrit ces œuvres et a désigné le monument qu'elles décoraient, mais un témoignage plus direct nous en est resté : c'est celui de Laurent de Behaim, qui, ainsi que nous venons de le dire dans l'étude qui précède, a copié, sous les fresques mêmes, les légendes des sujets représentés. Le compagnon de l'alsacien Burckhardt, le ceremoniere d'Alexandre VI, Laurent, qui fut vingt-deux ans majordome du Vatican, était ou faire tirer les hommes illustres, les animauxet les plantes, mème au naturel. Il serait à souhaiter néanmoins qu'il y eût apporté plus de fidélité et plus d'exactitude, et qu'il ne se fût pas donné la liberté d'inventerà plaisir les portraits et les médailles qu'il voulait faire passer pour véritables comme dans le livre qu'il publia en 1553 : le Promptuaire des médailles, (Jugement des savants, t. Ier, p. 174.) 13 4 98 LES MONUMENTS DES BORGIA. né à Nuremberg; il faisait partie de la colonie d'allemands cantonnés depuis près d'un demi-siècle dans le Vatican. Érudit, poète, musicien, archéologue, il collectionnait les inscriptions, et les écrivait sans ordre, dans un cahier ma nuscrit qui nous a été conservé, et qu'on peut consulter à la Bibliothèque natio nale de Munich, dans la grande série Hartmann Schædel. Les fresques sur les murs des salles basses du château Saint-Ange récemmentexécutées au moment où les vit Laurent de Behaim représentaient des épisodes de la campagne de Charles VIII, tout à gloire du pontife : Le Roi de France à genoux devant le pape dans le jardin du château de Saint-Ange. —L'Obédience du souverain au consistoire.- Philippe de Sens et Guillaume de Saint-Malo recevant la pourpre. La Messe à Saint-Pierre, Charles VIII servant la messe.- La Procession à Saint-Paul-hors-les-murs où Charles VIII tient l'étole du pontife. Départ du roi pour Naples, accompagné de César Borgia et du sultan Djem. De tant d'œuvres si précieuses, nous l'avons dit déjà, rien ne nous reste,que les légendes copiées par un contemporain. Il est certain que nous avons perdu là des portraits du plus haut intérêt, ceux de Lucrèce Borgia, de N. Orsini, comte de Pittigliano, celui de César, celui de Djem, celui de Trivulzio, et de tant Le d'autres. Alexandre VI avait aussi demandé au Pinturicchio de décorer les salles de ses appartements privés dans le Vatican même, ces « Ædes Borgiæ » auxquels nous venons de consacrer un long chapitre. Au milieu de compositions très nombreuses, pleines d'épisodes, où l'artiste a introduit des figures étrangères à l'action, et sur lesquelles nous aurons à revenir, on pouvait sans doute espérer retrouver un portrait de César ou de Lucrèce, mais on avu que l'examen le plus minutieux de toutes les têtes des personnages, fait en présence d'artistes compé tents et d'archéologues autorisés nous permet d'avancer, qu'en dehors d'une belle représentation d'Alexandre VI, et d'un portrait superbe, très ample, admirable ment conservé, qui pourrait être celui du duc de Gandia, et d'un autre portrait équestre que nous croyons celui du fameux Djem, ou Zizim, on ne retrouvera là aucun portrait de la famille Borgia. La date des peintures, 1494, écrite en lettres d'or dans les ornements de la voûte, explique cette abstention, César n'est I. Cette question des portraits des Borgia dans les Fresques des « Appartements » ne peut être traitée qu'en face des compositions elles-mêmes, afin de donnerles preuves àl'appui, nous renvoyons le lecteur au chapitre spécial aux Fresques du Pinturicchio : Les Appartements Borgia. : LES PORTRAITS DES BORGIA. 99 pas encore né à la vie politique, il n'a pas dix-huit ans, quant à Lucrèce elle n'est encore que dans sa quatorzième année. Le résultat, au point de vue des représentations par les fresques, est donc aussi négatif que celui que nous offre la numismatique. ES ESTAMPES. Nous ne tiendrons compte, après avoir fouillé laplu part des cabinets d'estampes de l'Europe, que des œuvres du xvi° siècle ; toutes celles qui sont postérieures, étant la reproduction assez récente de portraits peints dont nous aurons à discuter les originaux. Le plus ancien portrait gravé que nous offre l'iconographie est celui qui figure dans le volume de Paul Jove « Elogia virorum illustrium », au-dessous de la biographie de César. C'est un in-folio publié en 1551 à Florence, par Torrentini; l'ouvrage porte un sous-titre qui a pour nous un grand prix : « Veris imaginibus supposita quæ apud Museum Jovianum spectantur ». Mettons d'abord l'image sous les yeux du lecteur, et, puisque l'auteur nous indique l'original de son musée privé qu'il a pris pour document, nous le chercherons dans les collec tions pour le présenter aux lecteurs. Paolo Jovio est né en 1473 — trois ans avant César Borgia; et il est mort en 1552. Évêque de Nocera, il était en outre médecin, et compte comme historien. C'était un homme envieux, vénal, mais passionné pour les arts et l'un des plus célèbres collectionneurs du xviº siècle ; il avait recueilli, dans sa maison de Côme, des statues antiques, des médailles, des inscriptions, des tableaux, des gravures, et formé le Museum Jovianum, célèbre dans toute l'Italie, collection des portraits des hommes illustres, anciens et contemporains, qui a servi depuis de type à nombre d'autres collections de même nature en Europe. On sait qu'il était en relation avec le Vatican, et même s'il n'a point connu personnellement César, ce dont nous n'avons nulle preuve, il est impossible d'admettre, qu'ayant dans son propre cabinet, bien en vue, l'image du fils d'Alexandre VI, et vivant dans le même monde, dans la même région que le modèle, appartenant même à l'Église, au monde du Vatican, et entouré de ceux qui avaient coudoyé César, ce portrait qu'il possédait ait été infidèle. Le premier protonotaire, revenant de la Cour Pontificale, à son premierpas dans la villa de Como, dans ce Museum Jovianum, eût averti l'évêque de cette méprise qui eut singulièrement déprécié sa fameuse collection. 100 LES MONUMENTS DES BORGIA. Mais ce n'est pas assez ; on peut poser en principe, qu'au point de vue icono graphique, en ce qui touche les contemporains et les personnages de son temps, Paul Jove est indiscutable. Si les bibliophiles qui possèdent l'œuvre veulent nous

César Borgia, Capitaine général des Troupes pontificales. D'après l'Illustration de Paul Jove.
suivre, ils acquerront vite une conviction à cet égard.-D'où vient le bois gravé qui représente le Gattamelata à l'appui de la biographie du grand condottiere ? De l'image de bronze du Donatello à Padoue.-Le Giovanni Acuto (Hawk Woodle condottière anglais au service de Florence) est la reproduction (à peine interprétée) de la fresque colossale, portrait équestre peint sur lafaçade intérieure de la porte d'entrée de Santa Maria del Fior.- L'Alphonse d'Aragon est copié 0000 LES PORTRAITS DES BORGIA. ΙΟΙ sur la médaille du Pisanello.- Le Montefeltre a pour original le célèbre Piero della Francesca des Offices ; Hippolythede Médicis, enfin, trahit l'original du Titien par le costume hongrois dont il est revêtu, etc. Mais ce n'est pas tout, Paul Jove a donné une preuve évidente de ses scrupules en matière de repré sentations : s'il n'a pas connu le personnage ou obtenu le document sérieux pouvant luiservir à la réproduction de ses traits, il n'hésite pas à laisser en blanc dans ses beaux livres, la place que l'illustration devait occuper. C'est ainsi que, n'ayant pu reconstituer, ni les traits du Pic cinnino, ni ceux des deux Gonzague,d'Anto nio Colonna, du maréchal de Lautrec, de Philibert prince d'Orange, de Moncade et de François de Bourbon, la place à occuper est restée vide plutôt que de la remplir en recou rant à un portrait de pure fantaisie. doncun illustrateur qui montre de la critique. CÆSARBORGIAVALENT Voilà Voilà pour la gravure, mais puisque Paul Jove nous dit dans son titre qu'il gravait d'après les portraits de son propre Musée, voyons où est l'original peint de la collection des hommes illustres qui décorait la Villa de l'évêque ? Nous l'avons cherché dans la Villa même, chez les Jovio, dont la race n'est pas éteinte ; mais il n'existe plus, encore qu'il reste quelques débris des fameusescollections PLauren
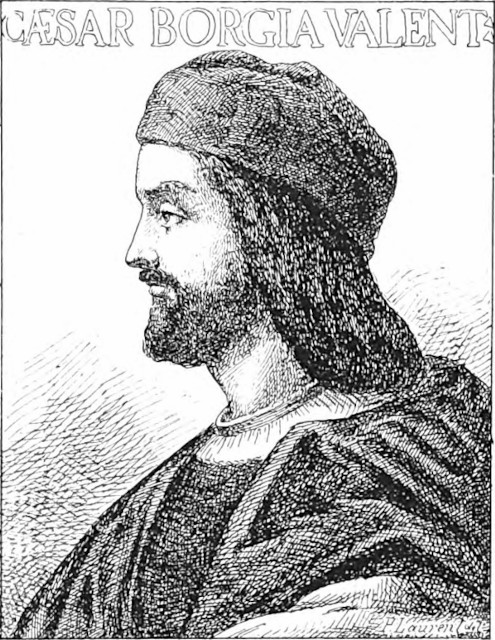
César Borgia. ― Copie du Portrait du Museum Jovianum (Côme, au Musée des Offices de Florence).
de l'évêque de Nocera ; l'œuvre a disparu au milieu des vicissitudes du temps. Adéfaut de l'original, nous avons pourtant au Musée des Offices la copie faite par l'Altissimo, c'est-à-dire par le peintre Cristofano Pappi sur l'ordre du troi sième grand-duc de Toscane, pour la collection des 522 portraits d'hommes illustres des Offices. Les archives du Musée font foi de cette origine; le catalogue officiel la constate, et pour que nous ne doutions point de la personnalité du modèle, le nom : CÉSAR. DUX. VALENTINO est écrit sur le panneau dont Paul Jove a établi la connexité avec la gravure, par le sous-titre de son livre : Veris imagi nibus supposita quæ apud Museum Jovianum spectantur. Le portrait sur bois est plus ample, plus noble, ily a des variantes, et le dessinateur a rectifié l'œuvre 102 LES MONUMENTS DES BORGIA. banale du peintre à la douzaine, mais nous n'avions pasbesoin de l'aveu solennel de Paul Jovepour reconnaître sous le même costume (celui decapitaine général de l'Église avec le beretto et la capa), César Borgia, duc de Valentinois. Voilà donc enfin un César indiscutable; GuillaumeRoville, à peine le portrait vient-il de paraître, recourt à ce document pour graver sa médaille ; un faussaire du musée de Bergame la copie ; Pompilio Lotti, qui résume l'ouvrage de Paul Jove, le grave à nouveau (au burin cettefois) ; et les collectionneurs de portraits du xvi° siècle (c'était la mode alors) reproduisent tous la même image (comme on peut s'en convaincre envisitant les châteaux de la Renaissance dans la Tou raine), Belleforest en France (voir la Cosmographie), Burman, en Italie et en Allemagne ( Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiæ, partie VIII, tome IX, page 65), le donne encore ; le Tesoro du Grevio y a recours, comme aussi le Diario cesenate, écrit dans la ville même où César est connu, où il a longtemps résidé et commandé en maître pendant trois années 1 . Voilà bien ce que nous appellerons l'étalon, le portrait-type auquel nous allons comparer tous les prétendus portraits de César; mais nous ne faisons nulle difficulté de reconnaître que le caractère du document est le caractère héroïque, que la condition d'avoir devant soi un profil ou une médaille seule, au lieu d'un portrait de face, est une condition assez précaire pour établir une juste compa raison. Si la gravure sur bois est noble et belle, comme celle des graveurs du grand siècle de latypographie, le document peint du Musée des Offices, lui, est un portrait de facture, assez grossier, qui n'a pas de valeur comme œuvre d'art, et n'emprunte d'intérêt réel qu'à sa condition d'être la seule représentation peinte à une époque contemporaine, possédée aussi par un contemporain de César, par un amateur d'art, son historien direct, celui qui l'a accusé, vilipendé, calomnié, s'il est possible encore de calomnierle beau monstre qui traverse si rapidement l'histoire à l'aurore du xv° siècle en Italie, celui dont les poètes ont comparé la chute à celle de l'astre-roi : Mancar dovendo, ando dove andar sole Phebo, verso la sera, al Occidente. 1.- La dernière copie dont nous avons constaté l'existence figure àBrienne (Aube) dans le château des princes de Bauffremont-Courtenay. Elle a dû faire partie d'un ensemble aujourd'hui dispersé. LES PORTRAITS DES BORGIA. ORTRAITS DANS LES DIVERS MUSÉES. P 103 En dehors du Palais Borghèse, trois musées italiens se disputent l'honneur de posséder un portrait de César Borgia : le Musée civique de Bergame, celui de Forli, et le Musée Correr de Venise. La Galerie privée des Castelbarco Albani, de Milan, aujourd'hui dispersée, possédait naguère une œuvre attribuée à Raphaël qu'on regardait aussi comme le portrait de César, et à laquelle ceux qui l'ont acquis donnent encore ce nom avec insistance. Enfin, dans la Galerie Hope, à Dep Deen (Angleterre), près de Dorking, figure un portrait qui a fait partie de la Galerie du Régent au Palais-Royal, et qui a été gravé au siècle dernier avec la légende « César Borgia, duc de Valentinois ». Nous aurons encore à présenter au lecteur une nouvelle représentation, dont personne n'a jamais fait mention, découverte dans la campagne spéciale que nous avons faite à la poursuite des documents sur César dans toutes les villes de son duché des Romagnes, et la série des œuvres sera épuisée. Il y aurait bien encore ici et là quelques prétendus por traits dans des galeries privées, mais ni l'âge du modèle, ni celui de la peinture ne permettent de les discuter ; nous les mentionnerons cependant, afin d'être aussi complet que possible. E PORTRAIT DE BERGAME. Le panneau que nous reproduisons ici représente un personnage de face, à mi-corps, coiffé d'un béret noir, vêtu d'un pourpoint bleu et noir, la main sur la garde de sa dague. La physionomie est très énergique, les cheveux sont longs, la barbe légère, la tête se détache surun fond depaysage tourmenté par latempête, deux petites figures de femmes chassées par l'ouragan traversent les fonds. Attribuée par le catalogue au Giorgione, l'œuvre, avec toute une riche collection, a été donnée au Musée (Aca démie Carrara. Galerie Lochis) par le comte Lochis. Le comte actuel, ama teur et bibliophile distingué, n'en connaît point l'origine ; une note manuscrite trouvée dans les papiers du donateur porte ces mots : « Ce portrait passe pour celui de César Borgia, il pourrait être de Dosso Dossi. » La peinture a beaucoup de caractère, elle a attiré l'attention des historiens de l'art. M. Morelli, qui est de Bergame même, veut voir là un Giacomo Francia, fils de Francesco, peintre et orfèvre, comme son père. MM. Crowe et Cavalcaselle, les historiens de la peinture dans le nord de l'Italie, tiennent pour Calisto de Lodi. Nous avons fait la comparaison avec les œuvres du maître à Brescia, à Crema, à Alexandrie et à 104 LES MONUMENTS DES BORGIA. Milan; nous tenons pour le même artiste, car les tonalités sont puissantes comme les siennes, et il y a là particulièrement certain ton vert que nous retrouvons d'ordinaire dans les vêtements des personnages de Calisto de Lodi. M. Francesco Monetti, l'obligeant secrétaire de l'Académie de Bergame,nous a fait observer qu'on a toujours attaché une signification particulière au caractère des fonds, sur lesquels l'artiste a cru devoir détacher la figure du personnage. César, dit-il, était donnaiolo (adonné aux femmes), sa vie fut tumultueuse; les gens à imagination veulent voir dans cette tempêté qui courbe les arbres, et dans ces petites silhouettes de femmes qui fuient sous l'aquilon,comme si elles allaient cher cher fortune, un double état de l'âme. Notre psychologie va moins loin, nous croyons qu'un fait constant domine tout dans cette difficile et peut-être insoluble recherche que nous avons entreprise : par tout et toujours en Italie, de Venise à
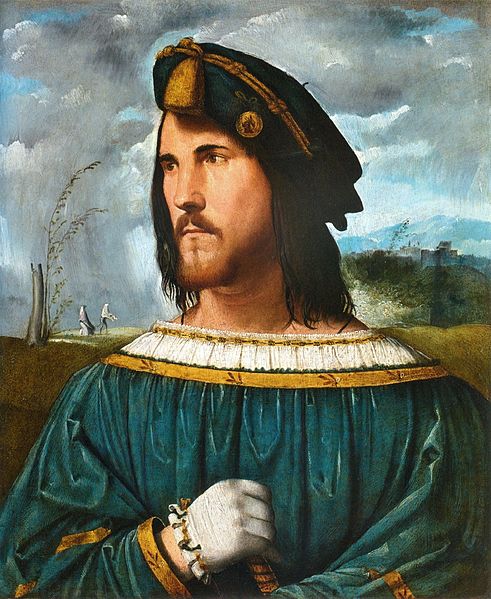
Prétendu Portrait de César Borgia au Musée de Bergame. Communiquépar M. Monetti, Conservateur.
Naples, de la Méditerranée à l'Adriatique, on atenté de trouver un portrait de César, et, chaque fois qu'on a rencontré, dans un musée, dans une galerie, un personnage inconnu, à la face énergique, à la prestance noble, fière, élégante, hardie, dont le cos tume pouvait dater de la fin du xv° siècle ou des premières années du xvi , un des premiers noms qu'on ait prononcés est celui de Borgia. Nous en dirons autant quand nous tenterons de retrouver un portrait authentique de Lucrèce. Il y a un certain idéal dont on ne s'éloigne guère, suivant qu'on est plus ou moins lettré, quand on cherche une image du fils d'Alexandre VI, et ici encore on re trouve certains traits compatibles avec le caractère du personnage; le béret noir peut se comparer à celui du portrait de Paul Jove, les longs cheveux, cette beauté grave, cette expression presque menaçante, ce geste (toujours le même), de lamainqui s'appuie sur l'arme,comme si lemodèle devait être prêt à frapper, seraient bien dans le caractère; mais malgré tant d'apparences, les objections se présentent en foule. Si la critique n'est point d'accord sur le maître, aucun de
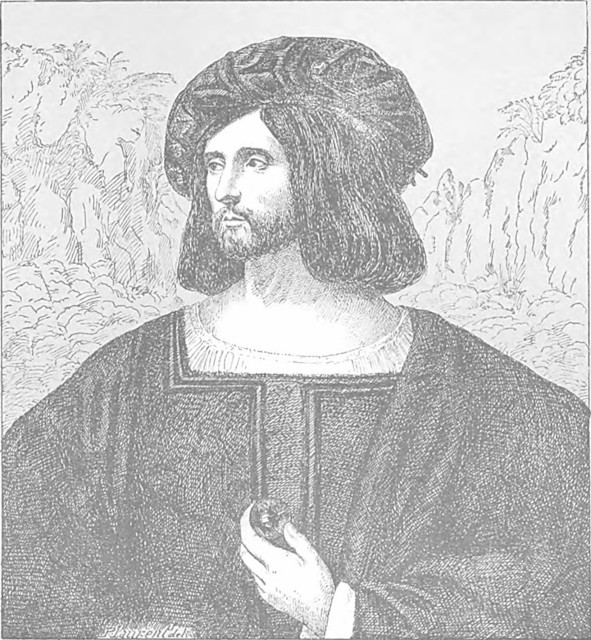
CÉSAR BORCIA (2)
Ancienne Calerie Castelbarco Albani
LES PORTRAITS DES BORGIA. 105 ceux dont on prononce le nom, ni Giacomo Francia, ni Romanino, ni Calisto de Lodi, n'est contemporain (en tant que peintre bien entendu) et n'a pu ren contrer César avant 1503, date extrême d'une exécution possible. J'ajouterai qu'ici l'idée d'une RESTITUTION ne peut pas même être admise, parce que laligne inflexible du nez du portrait qui part du sommet du front, et descend sans courbures jusqu'à la moustache, contrarie très visiblement l'asser tion du profil de Paul Jove. Si l'œuvre est à retenir comme pleine d'intérêt pic tural, elle est à écarter résolument au point de vue de l'iconographie; elle n'est point contemporaine du héros. NCIENNE COLLECTION CASTELBARCO DE MILAN. Portrait à mi-corps, attribué à Raphaël. Panneau peint à l'huile. Personnage de face, coiffé d'un grand béret noir, barbe blonde, pourpoint jaune et rouge. Pein ture citée dans Crowe et Cavalcaselle, II° vol., page 453 (Story ofPaintingin the North ofItaly) l'œuvre accuse la facture du premier quart de xvı siècle. L'origine de ce portrait, du caractère le plus pénétrant, est entièrement inconnue, au dire même de l'honorable comte Castelbarco Albani, qui a bien voulu faire des recherches à son sujet. Le grand-père du comte, César de Cas telbarco-Visconti-Simonetta, en avait fait l'acquisition au siècle dernier; c'est dans la collection du fils que l'on vu les écrivains d'art qui l'ont décrit. A la mort dupère du comte actuel, il a été vendu aux enchères dans la villade Vaprio. Un amateur d'art, M. Graeschen, ingénieur civil àMilan, s'en est rendu acquéreur; il l'a transporté vers 1885 à Paris, où nous avons pu l'étudier à loisir. Depuis, il a été soumis à l'examen de la plupart de nos collègues les critiques d'art. Le portrait Castelbarco est à n'en pas douter d'un maître de Crémone, Alto Bello Melone, fils de Marc-Antonio, de la Vesinanza de Sancto-Andrea, qui a signé ALTOBELLO DE MELONIBUS P. M.DXVII ses fresques de «La vie de la Vierge », exécutées dans la cathédrale de Crémone. Il est difficile par le seul souvenir de comparer deux œuvres au point de vue de la couleur; mais si on oppose le portrait Castelbarco à un autre de la main d'Altobello qui figure au Musée de Stuttgart, aucun doute ne subsistera plus. MM. Crowe et Cavalcaselle ont, les premiers, restitué le prétenduportraitde César aupeintre de Crémone : nous avons tenu à comparer l'œuvre à d'autres du même maître afin de corroborer leur opinion ou de l'infirmer: lefait nous paraît indiscutable. 14 106 LES MONUMENTS DES BORGIA. Si nous nous plaçons au pointde vue du type du personnage, son âge est cer tainement trop avancé pour qu'il puisse représenter César, car il ne pourrait, selon toute apparence, avoir moins de trente à trente-cinq ans, et on n'oublie point que César ne peut en avoir plus de vingt-sept au moment où il aurait posé. On dirait le modèle miné par la fièvre : les yeux sont vitreux, la face est hâve, les joues émaciées, le sang ne circule point sous la peau; il serait bien diffi cile de reconnaître là ce vigoureux Borgia qui, aux applaudissements de la foule, sur la place Saint-Pierre, d'un seul coup de stocco, abattait un dernier taureau après en avoir tué cinq consécutivement. Mais le côté étrange de la physionomie, le geste, la main qui repose sur le pommeau de l'épée (que quelques écrivains ont pris pourunede ces boulesd'or percées àjour dans lesquelles on mettait des par fums), une certaine recherche dans le costume, enfin le grand béret de soie noire qui fait comme une auréole à cette tête à la fois élégante et bizarre, et rappelle la coiffure du portrait Borghèse, tout appelait une attribution relevée, et nous ne sommes point étonné d'avoir à discuter celle qui porte le nom du Valentinois. Mais, encore une fois, l'âge du personnage, son expression débile, anémique, le peu de rapport réel du type avec celui de Paul Jove; et surtout d'autre part, la date rationnelle de l'exécution de l'œuvre, qui est unpeu postérieure à l'existence de César; enfin les conditions particulières à l'Altobello, qui peignant au nord de l'Italie de 1515 à 1540, n'a jamais pu avoir aucun point de contact avec le Valen tinois et ne serait même pas son contemporain, en tant que peintre au moins : tout condamne ce portrait au point de vue de l'iconographie. Le panneau n'en a pas moins une haute saveur; il est à regretter cependant que l'œuvre soit d'une exécu tion inégale. M. Anatole Gruyer, l'historien de Raphaël, l'a examiné avec sa haute compétence et a constaté les faiblesses qui nous avaient frappé. La tête est très bien dessinée et modelée avec une science accomplie; il y a dans la cavité des yeux, dans l'anatomie du visage,une recherche savante, une grande finesse et ungrand tact; mais latête seule est exécutée à point; les lignes du cou, les attaches des épaules, la poitrine, la main ne semblent pas du même artiste, ou celui-ci, dès qu'il perd l'appui de la nature, n'est plus semblable à lui-même; la main sur tout est particulièrement faible Vallardi, l'éditeur milanais dont on cite souvent le nom à propos du précieux Recueil de dessins acheté par le Louvre, possédait une replica de cette toile qui était d'un dessin plus savant; elle a été vendue à Paris le 2 mai 1870 au prix de onze mille centfrancs; elle était aussi attribuée à LES PORTRAITS DES BORGIA. 107 Raphaël. Nous l'avons cherchée en vain dans les collections connues; peut-être cette mention aidera-t-elle à retrouver sa trace; leprix qu'elle a atteint indiquerait une œuvre sérieuse et qu'on voudrait pouvoir comparer à celle-ci. USÉE DE FORLI. PORTRAIT A MI-CORPS SUR PANNEAU. Unpersonnage de face, à cheveux courts, à la barbe rare, coiffé d'un bonnet informe, de couleur vert sombre, le cou nu sort d'un col blanc rabattu, la main ramènesur la poitrine la draperie rouge aux larges plis qui recouvre les épaules. N° 1100 du catalogue, attribué au Giorgione;-0,53 haut. sur 0,40larg. L'honorable directeur du Musée de Forli, M. Antonio Santarelli, nepossède pas de document sérieux sur l'origine de cette œuvre, très restaurée, et qui présente bien peu d'intérêt. Le panneau a été donné à la ville par le comman deur Pietro Guarini. L'auteur des Me morie della Pinacoteca di Forli s'ex prime ainsi à son sujet : « Quand on considère attentivement l'effigie du cé lèbre tyran attribuée à Raphaël, conser vée dans lagalerie Castelbarco à Milan, on ne fait aucune difficulté de recon naître le même personnage dans notre tableau, avec cette différence qu'ici, il a été représenté à un âge plus avancé; la barbe est courte et serrée comme celle du modèle, mais les cheveux sont courts, au lieu de tomber sur les épaules en boucles épaisses. Il ressemble aussi au portrait gravé dans les Capitaines illustres de Pompilio Lotti (Rome, 1635 , in 4°, p. 149.)
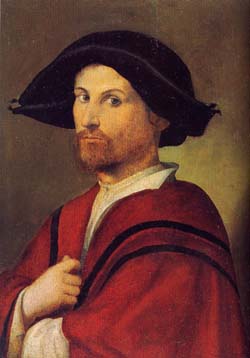
Portrait prétendu de César Borgia. (Musée de Forli )
Le lecteur a sous les yeux le portrait Castelbarco, il peut donc juger du peu de ressemblance des deux documents, et, comme le portrait de Pompilio Lotti, auquel ce critique se réfère, n'est autre que celui de Paul Jove (interprété au burin), qui n'a aucun point de contact avec celui de Forli, il n'y a pas à insister. 108 LES MONUMENTS DES BORGIA. La galerie de Paul Jove, la galerie Borghèse et le musée de Bergame, nous ont du moins montréjusqu'ici les traits d'un gentilhomme fier et hautain; celui-ci est un assez pauvre diable mal vêtu, singulièrement coiffé, quelque poète famé lique sans doute qui aura mérité les honneurs d'un portrait, rimeur en vers latins ou en langue vulgaire; ce n'est point là César Borgia. M. Morelli connaît l'œuvre, il a cité en face d'elle le nom de Palmegiano da Forli ; la peinture est entièrement repeinte, et le délicieux peintre des voûtes du Carmine de Forli ne ratifierait pas l'attribution du sympathique sénateur.Le pan neau a été gravé avec fidélité par un jeune artiste de Forli, M. Giacomo Simon celli ; M. Antonio Santarelli a bien voulu nous encommuniquer une épreuve que nous reproduisons ici; ce tableau n'est d'ailleurs plus qu'une ombre. BUSEO CIVICO-- CORRER. UN PANNEAU, Nº 44, MESURANT 0,44 HAUTEUR sur 0,31 Largeur, PEINT A L'HUILE.- Personnage de profil, sur fond vert; un béret à plume sur un bonnet de soie noire rayé, pourpoint noir velours broché, revers àfourrure. — Attribué à Léonard deVinci. Ce panneau, plein de caractère, a été donné en 1848 au Musée Correr pen dant le siège de Venise, par le grand patriote italien, le général Pepe, qui croyait laisser à la ville de Venise une œuvre doublement précieuse au point de vue du peintre et du modèle. La déception est aussi complète que possible, au double point de vue des deux attributions. MM. Crowe et Cavalcaselle ont tenu compte de l'œuvre et l'ont rejetée, mais on est dispensé de la discuter parce qu'une replica de cettetoile, ou l'original pro bable, a été signalée par M. Morelli dans la sacristie de l'église de Monte-Oliveto où l'inscription qu'elle porte nous donne la clef de l'énigme. Il faut voir dans l'inconnu du Musée Correr, unDon Fernando Avalos d'Aquino, vice-roideSicile. Comme ilexiste une médaille du marquis de Pescaire et de Guast, par Cesare da Bagno, la confrontation est facile, et la discussion est close. MOLA. PORTRAIT PEINT A L'HUILE SUR TOILE. Personnage à mi corps, de profil, avec l'inscription : CÆS. BORGIA VALENTINVS. Propriété du comte Codronghi, député des Romagnes. Déposé dans le cabinet du syndic de Forli au moment où nous poursuivions notre enquête, M. Alessandretti nous a fait les honneurs de ce portrait avec une grande bienveil LES PORTRAITS DES BORGIA. 109 lance et nous l'avons cru assez important comme élément de démonstration pour en faire exécuter un fac-similé. Il était naturel de rencontrer un portrait de César dans une ville pleine de la tradition du Valentinois, où on conserve nombre de documents qui attestent sa rigueur comme capitaine, son activité comme administrateur, sa libéralité comme souverain, et où son pouvoir s'est affirmé pendant trois années consécutives. Depuis le portrait des Offices, celui-ci est le seul qui porte une inscription. Il suffira de jeter les yeux sur cette représentation pour constater son identité avec celle du portrait gravé par Paul Jove dans l'édition de 1551 des Elogia Virorum Illustrium. La peinture est fruste ; elle n'a pas grande valeur au point de vue de l'art ; c'est encore une de ces œuvres de facture, destinées à décorer quelque salle des gardes. Il n'y a là aucune recherche dans l'exécution, aucune préoccu pation du détail, ni des nuances du modelé; enfin c'est un document plutôt qu'une œuvre d'art. César porte le beretto de capitaine général, la chemisette à mille plis au col brodé d'or qui sort du pourpoint brodé et une sorte de jaquette ouverte sur l'épaule qui laisse voir la manche blanche de fine toile. Conservée sans beaucoup de souci dans la famille Codronghi, qui compte parmi les plus anciennes des Romagnes, la toile figure déjà sur les inventaires du xvi° siècle. Il est plus que probable que c'est la dernière des innombrables copies d'un original fameux aujourd'hui disparu, qui faisait loi au temps même des Borgia, et qui a dû donner naissance à la nombreuse série de ces profils du Valentinois qui onttous le même caractère, et peut-être même au type gravé dans Paul Jove, dont elle confirme l'authenticité par l'inscription qu'elle porte.Reproduite à l'infini, commecelle d'un souverain, afin de figurerdans toutes les villes et places soumises à sajuridiction, l'image , comme nos anciens portraits de souverains faits pour les Préfectures, était toujours l'œuvre de praticiens d'une certaine adresse de main, gens toujours pressés et mal rétribués : ainsi s'explique son exécution hâtive et sommaire. Si banale que soit la peinture dont nous donnons ici une copie fidèle, nous devons considérer que la matière même est du temps ; elle est une pré cieuse épave du grand naufrage dans lequel ont sombré, vers 1503, au moment de la réaction qu'amenèrent la mort d'Alexandre VI et l'élection de Jules II, toutes les images, les inscriptions, les écussons, enfin les monuments de toute nature qui pouvaient rappeler le souvenir odieux des Borgia. 110 LES MONUMENTS DES BORGIA. ALERIE HOPE A DEEP-DEEN. Cette toile qui figure aujourd'hui à la Galerie Hope, attribuée au Corrège, a été gravée au burin par Deque vauvillier fils, dans l'ouvrage célèbre la Galerie du Palais-Royal, par J. Couché. L'épreuve porte en légende ces mots : Le duc Valentin; mais l'ori ginal ne porte ni signature ni inscription. Nous avons recherché l'origine de ce portrait, elle est singulière; on la suit dans les diverses péripéties qu'elle a subies depuis Modène jusqu'à Deep-Deen avec documents à l'appui. Un duc de Modène, à la fin du xvi° siècle, fit hommage de ce tableau, avec dix-neuf autres, à l'empereur Rodolphe et les lui adressa à Prague, qui fut bientôt assiégée par Gustave-Adolphe. Devenues le butin du héros suédois, ces toiles furent données par lui à sa fille, la reine Marie-Christine qui les transporta à Rome, où elle mourut. Livio Odescalchi, duc de Brac ciano, neveu du pape, les acheta à la suite de son décès; lui-même disparut bientôt, et comme le frère de Louis XIV formait alors ses collections, il profita, à son tour, de la fin d'Odescalchi pour les enrichir. Philippe-Égalité son héritier, pressé d'argent, vendit les toiles de l'École Italienne et celles de l'École Française à Walkner, banquier belge, pour sept cent cinquante mille livres; et Walkner les revendit à son tour neuf cent mille au père du marquis de la Borde. Cette col lection exposée rue d'Astorg, dans l'hôtel de Méréville, passa, à la Révolution, à Londres, où le duc de Bridge-Water, Lord Carlisle et Lord Gower s'associèrent pour l'acheter. Ceux-ci en firent une exposition chez Bryan à Pall Mall, et au Ly ceum, dans le Strand, puis, ayant écrémé la collection par un choix personnel, abandonnèrent bientôt le reste au public. Le César Borgia n'avait pas eu leur suffrage ; un collectionneur bien connu, Thomas Hope, l'acquit aux enchères et le paya cinq cent guinées; il figure aujourd'hui dans une des résidences de la famille, à Deep-Deen, près Dorking à côté des beaux Véronèse de la même collection du Palais-Royal : c'est là que nous avons pu l'examiner. L'âge du modèle éloigne l'idée d'une représentation de César faite d'après nature. Waagen l'a vu et, constatant l'attribution au Corrège, a écrit sur son cata logue : « elle est d'un autre maître ». Comme le Corrège a neuf ans au départ de César, il est en effet inutile de discuter cette attribution. Au point de vue des traits et du caractère, étant donné le costume, le geste, le béret noir très ample (qui fait toujours penser à celui du modèle du palais Borghèse), rien ne détourne absolument de l'idée de voir là un César peint d'après des renseignements ; LES PORTRAITS DES BORGIA. III quelque restitution sans grande autorité exécutée pour figurer dans une galerie d'hommes illustres, car il faut toujours tenir compte de la tradition etdes origines. On pense à Lorenzo Costa, ou à Lorenzo Lotto, en facede la toile, où rien, d'ail leurs, ne dénonce une œuvre exécutée sur nature. La comparaison avecleportrait de Paul Jove n'est pas non plus favorable au modèle, et si on veut s'attacher à des preuves d'un caractère archéologique, ce César n'appuie pas la main sur un stocco italien du xv° siècle, mais bien sur une arme de la fin du xvi . Enfin les crevés à l'allemande des manches, et la cuirasse à mi-corps laissant voir des crevés au corsage, dénotent tout au plus l'époque des conquêtes de Charles-Quint en Italie, et le voisinage des lansquenets ; époque postérieure à César. ONCLUSION.- Il est temps de conclure, et on ne s'étonnera pas, à défaut d'une œuvre éclatante, d'une authenticité incontestable à la fois comme exécution et comme représentation, de nous voir exposer ici ce que nous appellerons les vues de l'Esprit, inspirées par une étude minutieuse de la carrière du Valentinois. La vie du héros est trop courte dans son ensemble, et de 1499 à 1507 elle est trop dramatique, trop tourmentée, pour que nous nous étonnions de ne point trouver son image accomplie, exécutée dans les loi sirs de la paix par quelque artiste attaché à sa personne et devenu son familier. César est un personnage étrange; ce grand agité plein de contrastes, est à la fois un taciturne, un mystérieux et un noctambule ; la nuitil veille, il dicte, et met ses secrétaires sur les dents ; on ne saurait le saisir et le fixer ; quand il ne mène pas la vie des camps avec tous ses hasards, il se cèle à tous les yeux, et les ambassadeurs attendent un mois l'audience ducale. Fort jeune, de 1495 à 1498, il avait posé devant Pinturicchio et Cosimo Rosselli, le fait est certain; plus tard, Pinturicchio, devenu son peintre de cour, aurait pu le représenter encore, mais la grande œuvre de la décoration de la bibliothèque de Sienne allait trop tôt éloi gner l'artiste de son protecteur. La figure de l'empereur Maximin faisant com paraître sainte Catherine dans la Salle de la vie des Saints, passe, aux yeux de quelques-uns, pour un portrait de César Borgia, et si on le compare au profil du portrait de la collection de Paul Jove, il y a là des points de contact réels; mais nous l'avons dit et nous le répétons, en 1494, date de l'exécution de ces fres ques, César n'a pas dix-huit ans et il est impossible de voir dans le Maximin à longue barbe un hommede cet âge. 112 LES MONUMENTS DES BORGIA. Léonard de Vinci dut beaucoup à Borgia; il fut pendant trois ans son ingé nieur militaire ; il était donc naturel de chercher l'image du duc dans les croquis

Portrait prétendu de César Borgia. ― Provenant de la Galerie du Régent de France.
Aujourd'hui à Deep-Deen, chez M. Hope.
faits dans les Romagnes, au camp même du Valentinois, dans les dessins des manuscrits conservés à l'Institut, et désormais publiés avec une conscience et un savoir accompli, par M. Ravaisson-Mollien ; mais c'est en vain qu'on les inter CAES , BORGIA . VALENTINVS ESAR EORGIA

Appartenant au Comte Codronchi
LES PORTRAITS DES BORGIA. 113 roge. Vallardi, le possesseur du fameux Recueil de dessins du maître du musée du Louvre, se flattait de posséder un portrait de César, dessiné par Léonard ; il l'a décrit minutieusement dans son catalogue, et nombre d'historiens l'ont cru sur parole. M. Odoardo Alvisi, l'auteur d'une œuvre pleine d'intérêt, César Borgia, Duca di Romagna, a pris ce dessinpour type ety a attaché de l'impor tance, mais M. de Tauzia, le conservateur du Louvre, détachant ce dessin duRecueilVallardi pour lemettre dans un cadre sous les yeux dupublic, l'a rendu désormais à Holbein, son véritable auteur, et tout le monde aujourd'hui peut se rendre compte de la méprise. Là encore, le béret allemand, la barbe tradition nelle et l'attribution à Léonard ont déterminé l'erreur, et chacun sait d'ailleurs que Vallardi, grand fantaisiste, aimait à farder ce qu'il possédait. Est-ce à dire que nos recherches, longues et ardues, sont restées infructueuses ? Non; mais nous nous garderons d'en exagérer les résultats. Nous reconnaissons trois des documents que nous avons produits comme exécutés par des contem porains de César et dignes de crédit. Le Bois gravé dans la 2º édition de Paul Jove est le plus intéressant de tous ; — le Portraitdes Offices deFlorence alamême valeur iconographique, mais il n'est point une œuvre d'art; nous ajouterons plus de foi encore au Portrait conservé à Imola chez l'honorable comte Codronghi, députédes Romagnes, qui porte l'inscription : CÉSAR BORGIA VALENTINUS. Ces trois documents sont des documents incomplets et sommaires, mais il faut cependant s'y attacher avec force parce que ce sont les seuls qui soient contemporains. On doit regretter que tous les trois soient des profils; mais cela s'explique puisqu'ils procèdent tous de la même origine. Il y avait probablement alors une médaille, ou une fresque ou un portrait selon la mode des quattrocentisti, qui a donné la note et le point de départ; et si on consulte les portraits exécutés de 1450 à 1500, on verra que laplupart sont des profils. Ces trois portraits représentent le Valentinois revêtu des insignes de capitaine général de l'Église ; l'uniforme étaitréglementaire, Burckardt, le ceremoniered'A lexandre VI, a compté jusqu'au nombre de perles du berreto, et les portraits res tent fidèles jusque dans ces détails. On a contesté que César portât la barbe tout entière, et quelques-uns ont vu là une dérogation à l'usage de la fin du xv° siècle sans se dire que le marquis de Mantoue, FrancescoGonzaga, agenouillé au pied de la Vierge dans le tableau de Mantegna du Louvre, porte une longue barbe comme quelques-uns des ducs de Milan. Pour César la réponse est facile. La médaille 15 114 LES MONUMENTS DES BORGÍA. de Pie III (ce pape de vingt-sept jours qui succède à Alexandre VI et précède Jules II), protecteur décidé de César, qui lui sauva la vie en 1503, en lui permet tant de s'enfermer dans le château Saint-Ange, alors que nu, désarmé, mourant de la fièvre, il était traqué par les Orsini ; porte au revers la devise « sub umbra alarum tuarum », et nous montre le gonfalonier de l'Église, son vexillum à côté de lui, agenouillé devant le pontife. Or, ce César porte la barbe et les longs che veux. L'image est microscopique, l'œuvre est faible, elle est restituée et tardive, mais elle a pour elle la tradition vaticane, elle a été exécutée par ordre pour la série dite des Pontifes ; déjà, au xvi° siècle, le savant Bonaini a commenté le fait qu'elle rappelle, et cefait est attesté par la date 1503, gravée surla représentation. Quedevient doncle portrait Borghèse, et quelle est son importance iconogra phique? Nous ne saurions le rejeter complètement; car aucun des traits n'est incompatible avec ceux de latradition; et cette dernière est si forte en sa faveur qu'il faut en tenir compte. Mais la difficulté réelle de la situation, ce qui interdit une conclusion formelle à son sujet, c'est qu'on ne peut absolument point com parer le portrait d'un personnage peint de face à celui d'un personnage peint de profil. Tout en déclarant que nous croyons voir dans ce personnage un homme de plus de vingt-six ans, nous serions tenté de voir dans ce beau visage barbu, au front pur, couronné de longs cheveux, un César Borgia restitué une trentaine d'années après sa chute, d'après des documents disparus, et ce sera notre con clusion en ce qui concerne ce chef-d'œuvre anonyme.

AUT. CESAR. AUT. NIHIL.
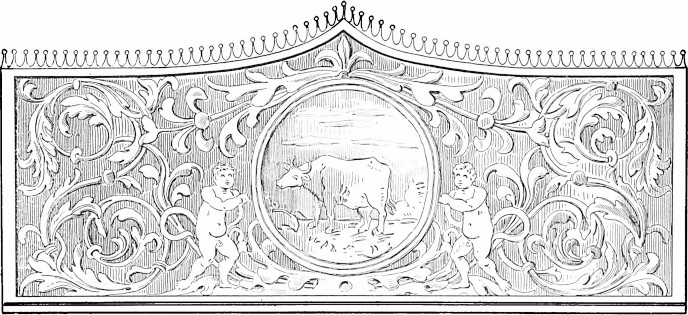
Le Bœuf Borgia.- Frise d'Épée du Maître Hercule.
LES PORTRAITS DE LUCRÈCE BORGIA L'historien le plus autorisé de Lucrèce Borgia, F. Grégorovius, a posé en principe qu'en dehors des deux médailles dont nous donnons ici la reproduction, il n'existe pas de portrait authentique de la duchesse de Ferrare. MM. Crowe et Cavalcaselle, les savants auteurs de l'Histoirede lapeinturedansle nordde l'Italie, après avoir discuté les représentations supposées de Lucrèce et signalé les por traits disparus cités par les historiens, ont opiné dans le même sens ; le marquis Giuseppe Campori, de Modène, qui avait compulsé tous les mémoires, catalo gues, livres d'entrée, correspondances et documents relatifs à la maison d'Este et aux artistes de la région, a conclu à lanégative et déclaré qu'il fallait s'en tenir aux médailles. Enfin le dernier espoir s'évanouit de trouver un portrait de Lucrèce, quand on voit queM. Venturi, dans un travailtrès complet sur laGalerie Royale de lamaison d'Este' , ne nous révèle rien à ce sujet. C'est un axiome désormais parmi les iconographes et les amateurs que, ni I. La R. Galleria Estense. Adolfo Venturi, 1883. Modena. Paolo Toschi. 116 LES MONUMENTS DES BORGIA. les peintures ni les gravures qui prétendent nous offrir l'image de Lucrèce ne la représentent véritablement. La réaction qui s'estfaite contre les Borgia, après la mort d'Alexandre VI, aurait fatalement entraîné la destruction des monuments qui les représentaient; on les aura supprimés, mutilés, soustraits ou dénaturés; ainsi s'explique qu'aucun Musée du monde ne puisse se vanter avec quelque droit de posséder une imagede la fille d'Alexandre VI. Nous allons prouver cependant qu'à défaut d'originaux incontestables dus à la main de quelque grand artiste du temps, il existe au moins trois copies d'un même portrait de Lucrèce Borgia qu'on peut rapprocher l'une de l'autre, compa rer avec les médailles, et corroborer par un Document déjà connu de quelques historiens, mais auquel ils ne pouvaient point ajouter foi parce qu'il était unique. En pareille matière, tous les raisonnements sont vains; il faut parler aux yeux et produire la conviction par la seule évidence des rapprochements. Nous ferons donc comparaître tour à tour les témoins, nous examinerons les monuments en exerçant sur chacun d'eux une critique inexorable. MONUMENTS CITÉS PAR GRÉGOROVIUS. Grégorovius, dans sa Lucrèce Borgia, dans la page consacrée au portrait de son héroïne, ne fait même pas les honneurs de la discussion aux toiles du Titien qu'on montre couramment à la galerie Doria-Pamphili comme des portraits de Lucrèce; il voit là une de ces fantaisies dont on est coutumier dans certaines collections, où les attributions sont rarement contrôlées, et il n'a pas même fait mention de la célèbre toile du musée de Dresde qui passe pour représenter Lucrèce et Alphonse d'Este, la considérant évidemment comme peu digne des honneurs de la dis cussion. Il cite, pour les réfuter, deux majoliques appartenant autrefois à Rawdon Brown, le savant éditeur des Calendars, passées par suite de sa mort et de la vente de son cabinet aux mains de M. Riquetti, le marchand de curiosités de Venise et désormais classées dans les belles collections de M. Édouard André (Paris). L'historien ajouterait quelque prix à un portrait peint que possédait l'hono rable directeur du cabinet numismatique de Ferrare, feu Mr Antonelli, « non pas tant, dit-il, à cause du nom de Lucrèce Borgia écrit sur la toile en carac tères déjà anciens, mais parce que quelques-uns des traits de cette image se rap LES PORTRAITS DES BORGIA. 117 prochent de ceux des médailles. De toutefaçon, conclut-il, ce n'est pas là un portrait authentique. » ES MÉDAILLES. Examinons à notre tour le portrait de Ferrare, les majoliques et le Titien de Doria-Pamphili, pour savoir quel fonds on peut faire sur leur authenticité. Mais d'abord, quoiqu'elles soient désor mais classiques et presque banales, montrons les deux médailles, base unique et fixe de toute la discussion, auxquelles il faudra toujours revenir pour comparer les documents que nous ferons surgir; ces deux médailles étant les deux seules représentations dont on puisse affirmer l'authenticité. Tous les lecteurs auxquels s'adresse une pareille dissertation savent à quoi s'en tenir sur leur mérite; Julius Friedlænder, le regretté directeur du cabinet de numismatique de Berlin, a essayé d'en déterminer l'origine; toutes ses hypothèses n'ont pas été acceptées, mais sa parole autorisée a cependant fixé certains points. M. Armand, dans son catalogue rai sonné¹, a résuméles conclusionsde lascience moderne à leur sujet. M. Friedlænder pense que le modèle en cire de la médaille qui nous montre Lucrèce les cheveux épars sur les épaules a été fait en 1502, et qu'on ne l'aurait exécutée en bronze qu'en 1505, alors que Lucrèce était devenue duchesse de Ferrare. Il veut aussi que la seconde médaille, celle dite à la Résille, à cause de l'ornement de la coiffure, soit de la même

Lucrèce Borgia, Duchesse de Ferrare.
Médaille communiquée par M. Aloïss Heiss.
main que la première; l'étude faite à la cire aurait servi de document. L'inscrip tion au revers de la première : F. PH. F. F, indiquerait qu'elle est l'œuvre de Filip pino Lippi. M. Milanesi a proposé une autre solution et lit : FINO PHINI (le nom d'un autre artiste), mais, dans l'incertitude, on persiste encore à ranger le médail leur parmi les anonymes et quelques bons esprits voient là l'œuvre de deux mains très différentes l'une de l'autre. En effet, dans le relief excessif de la pre I. Les Médailleurs italiens des xve et xvIe siècles. E. Plon, éditeur. Alfred Armand, architecte. Paris, 1883. 118 STONFERRAT LES MONUMENTS DES BORGIA. mière et dans le parti pris de bas-relief de la seconde, nous verrions la marque évidente de deux tempéraments très distincts. De ces deux médailles, l'une peut être regardée comme la médaille héroïque, malgré la réalité dont levisage est empreint, et malgré l'extraordinaire relief du bronze.

Médaille de Lucrèce Borgia, communiquée par M. Aloïss Heiss.
Grégorovius récuse toute autre repré sentation dans les termes suivants : « Il n'y a rien de certain que cette médaille, qui est de la période de la vie de Lucrèce à Fer rare; c'est une des plus belles de la Renais sance, on dit qu'elle serait de Filippino Lippi de 1502, l'année du mariage de Lu crèce avec Alphonse. Le revers porte une image caractéristique, non seulement pour le temps, mais pour Lucrèce elle-même : Un amour avec les ailes à moitié brisées attaché à un laurier. Près de lui, un violon, et, plus bas, un papier à musique annoté, le carquois du dieu d'amour brisé pend aux branches de l'arbre, et l'arc, dont la corde est rompue, pend à terre. Au tourde la médaille onlit : « VIRTUTI AC FORMA!! PUDICITIA PRÆCIosissimum ». Par detels sym boles, l'artiste a peut-être voulu donner à entendre que le temps des libres amours était passé, et l'arbre, le laurier, est sans doute une allusion à la maison d'Este. » APFALGIOSE L'autre médaille est bien un portrait, un peu pâle et effacé, mais cependant plus réel que le premier, parce qu'il nous donne une Lucrèce dans le costume du temps, avec des lignes fixes, des points de comparaison, la forme d'un vêtement, d'un bijou, des détails de mode précis, qui fixent une date etune région; elle offre enfin bien des parti cularités auxquelles nous pourrons nous attacher quand il s'agira de comparer les monuments les uns aux autres. Ajoutons que Lucrèce Borgia, mariée en

Revers de la Médaille de Lucrèce dite « à l'Amour captif ».
BORGIA LES PORTRAITS DES BORGIA. 119 1501 à Alphonse, fils du duc de Ferrare, n'assume le titre de duchesse que plus tard, et que la légende de la médaille lui donnant cette qualification, nous avons réellement son portrait de profil à l'âge d'au moins 25 ans. PORTRAITAFERRARE. De l'avis même de feu Msr Antonelli, directeur du cabinet de numismatique de Ferrare, qui, par l'intermédiaire de l'honorable syndic de la ville, voulut bien nous en commu niquer la photographie, le portrait cité par Grégorovius serait une copie LVCHRECIA·BORGIA·M·D· APR faite au xvi° siècle. On le conservait de temps immémorial dans lafamille Bucci de Ferrare ; il échut en don à Mr Antonelli en 1850; nous l'avons eu longtemps devantles yeux,il a été vendu à lamortde l'abbé et est resté à Ferrare. Une inscription dans la partie su périeure: LVCHRECIA. BORGIA.MD.AP.R. indiquerait que le portrait a été exé cuté à Rome en avril, l'année 1500. Lucrèce avait donc vingt ans (elle naît le 18 avril 1480); la duchesse n'estpas encorela femme d'Alphonse

Lucrèce Borgia, conservé à Ferrare. (Provient de feu Mgr Antonelli.)
d'Este, elle ne l'épousera qu'une an née plus tard. Si on veut comparer ce portrait auxmédailles, et surtout à celle à la résille, on retrouvera la même coiffure, la même tête ronde, la même mèche, qui pend, inerte le long des joues; le même cercle d'or retenant le même filet constellé de perles ; les mêmes divisions du corsage laissant voir la chemisette des Flandres. Le nez est rond, comme toute la physionomie, le menton est fuyant; cesont là les traits caractéristiques du masque de Lucrèce, et ils restent communs au pan neau de Ferrare et à la médaille. Je crois que Grégorovius a été sévère pour cette représentation; mais, comme i 120 LES MONUMENTS DES BORGIA. il s'est trouvé en face d'une copie très faible, naïve, et non pas d'un original savant et fort de dessin comme les belles œuvres de 1500, tout en constatant la ressemblance avec les médailles, il s'est dit sans doute : TESTIS unus, testis. NULLUS. Et il a passé outre. Puisque nous ne nous plaçons pas au point de vue de l'art, mais bien au point de vue iconographique, nous attacherons plus de prix à cette représenta tion ; elle n'a guère plus de valeur, au point de vue peinture,que celle qu'on attribue aux portraits de souverains que lepouvoir central envoie dans les muni cipes les plus humbles : mais il me semble qu'on doit y attacher une impor tance sérieuse au point de vue portrait; car, jusqu'ici, c'est l'unique image peinte ayant le caractère du temps qui porte une inscription, et présente des points de contact indiscutables avec la médaille; et par cela même elle devient le portrait type auquel il faudra toujours comparer les autres. Ceci dit, le célèbre écrivain n'a même pas fait l'énumération des cinq à six œuvres peintes attribuées à tel ou tel maître, qu'on nous montre un peu partout comme des portraits de la Lucrèce; par cette raison capitale que, partout, les traits du modèle diffèrent absolument de ceux des médailles, seul point fixe, et seul terme de comparaison jusqu'à ce que nous ayons rencontré le portrait de Ferrare qui, conforme aux médailles, leur emprunte par cela même une autorité fortifiée déjà par l'inscription qu'il porte. ES MAJOLIQUES. Le célèbre archiviste du gouvernement anglais à Venise, l'Inglese devenu populaire après trente-cinq ans de résidence sur la lagune où il se plaisait à conduire lui-même chaque jour son « Sandolino » , attachait un prix singulier à deux majoliques du xvi° siècle qui, selon lui, représentaient Lucrèce Borgia. Nous avons dit qu'elles sont classées désormais dans les vitrines de la collection Édouard André (Paris). Mélant d'une main savante lavérité historique aux hypothèses ingénieuses que lui suggérait sa connaissance des documents, Rawdon-Brown voyait là deux spécimens des poteries exécutées à Ferrare même par Alphonse d'Este, le propre mari de Lucrèce, dans les fours qu'il avait fait construire à son usage dans la cour de son palais. Le duc Alphonse, cet homme rude, épais, sans faste, négligé dans ses vêtements, qui se plaisait à faire manœuvrer des soldats, à dessiner des bastions, à fondre des canons et à fabriquer des armes et de la poudre, conti • LES PORTRAITS DES BORGIA. > 121 nuant ainsi la tradition militaire des Borso et des Lionel, le Bombardier enfin que Titien a peint la main sur un canon, s'était en effet adonné à la poterie deterre; il cuisait et peignait à l'émail. Mais ily a une objection bien grave à l'hypothèse de Rawdon-Brown : les majoliques deFerrare ont un caractère très accusé; elles sont presque toujours émaillées en blanc et diffèrent du type qui nous est présenté. De ces deux monuments nous en avons écarté un, parce que l'attribution n'est vraiment pas sérieuse au point de vue iconogra phique; nous donnons le second qui présente, on en conviendra, un air de fa mille avec la médaille à la Résille, et même avec celle aux cheveuxflottants.Doit on attribuer cette vague ressemblance à la mode du temps, au costume, à l'air de famille que les choses à peu près contemporaines et de même race ont tou joursentreelles ? Cescoupes amatorie, que Pesaro et Deruta ont mises en hon

Majolique à Reflets métalliques. ― Collection Édouard André (Paris).
Cités par Rawdon-Brownet par Grégorovius.
neur, sont choses courantes alors ; les « Lavinia Bella » , « Laura Bella », et même « Luchretia Bella » sont des formules, et n'ont rien de spécial. Il manque, en somme, à cette majolique, un écusson, une inscription, une indication, autre que ces initiales, qui préciserait au moins l'intention chez l'artiste et nous prouverait qu'il pensait à Lucrèce Borgia en exécutant rapide ment, sur le genou et au bout du pinceau un vague profil qui la rappelle et lui donne du prix. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner, dans de telles circonstances, que Grégorovius ait conclu dans les termes suivants : « Quand l'opinion de M. Rawdon-Brown serait fondée, ce qui n'est pas, des portraits de cette nature ne pourraient, dans aucun cas, nous offrir une ressemblance appréciable. » 16 122 LES MONUMENTS DES BORGIA. La majolique reste une œuvre de prix par ses brillants émaux, par le caractère de sa décoration et la valeur technique de sa fabrication, et elle mérite la répu tation dont elle jouit. E TITIEN DE LA GALERIE DORIA-PAMPHILI. La toile à laquelle l'histo rien donne la première place dans son énumération, sans cependant lui faire l'honneur de la discuter, représente une femme d'untype oriental. les cheveux relevés en turban, au milieu desquels elle a placé un bijou ovale d'où partent des rayons de perles. Elle est vêtue d'étoffes amples, d'un corsage à manches larges; elle pose la main sur un page noir, en chemisette blanche, qui tient à la main les gants de sa maîtresse et attend ses ordres. Personne n'a reconnu là Lucrèce; ni Grégorovius, ni Crowe et Cavalcaselle, ni l'honorable marquis Giuseppe Campori, si compétentpour tout ce qui touche lamaison d'Este.Toutproteste, eneffet,contre l'attribution: les traits, le costume, l'époque. Comment donc la tradition a-t-elle pu se faire autour de cette œuvre ? On a eu, de tout temps, la préoccupation de chercher dans les galeries de l'Europe un portrait deLucrèce Borgia; onsavaitque leTitien avaitdû lapeindre, ou du moins Ridolfi l'affirmait dans les termes suivants : « Il Tiziano l'aveva figu rata con rarissimi abbigliamenti in capo di veli e digemme,in veste di veluto nero con maniche trinciate da molti groppi, che con maestoso portamento teneva la mano mancaappogiataalla spallad'un paggettoEtiope, chesivedeinstampadirame di Egidio Sadler, rarissima in tale prattica. » (Maravigie del arte, t. I , p. 209). Ce fut le point de départ de l'erreur; Egidio Sadler, le graveur allemand ( 1570-1620), avait exécuté sa planche à Venise (ainsi qu'il le dit dans la légende écrite sous sa gravure), d'après un tableau qui y était de son temps. De Venise la toile passa à Prague, chez l'archiduc Rodolphe; de Prague à Stockholm, de là à Rome avec Christine de Suède, de sa galerie dans celle de Livio Odescalchi, et de celle-ci chez le Régent, au Palais-Royal¹. Si on recherche dans les cabinets I. On sent bien qu'au cours d'un travail dont on ne présente que les conclusions, on doit avoir feuilleté bien des livres, bien des catalogues, et examiné bien des dossiers : je ne fais qu'indiquer ici l'existence des diverses répliques ou copies. La première est à Doria-Pamphili, la deuxième à Modène, au Musée, copiée à Rome par Louis Carrache; la troisième, gravée par Sadler, qui (au dire de M. Ro binson) serait l'original, doit être encore aujourd'hui chez M. Cook de Richmond. C'est le tableau de la reine Christine de Suède, donné en 1599 par César d'Este à l'empereur Rodolphe, vendu en 1790, par Philippe-Égalité, au banquier Walkner de Bruxelles, passé aux mains de De Laborde de Méreville, LES PORTRAITS DES BORGIA. 123 d'estampes de l'Europe la gravure de Sadler, qui est loin d'être rare, on en trou vera deux états : l'un, que possède, entre autres,la Corsiniana de Rome, où on lit le nom de Lucrèce Borgia; l'autre, qui existe partout et entre autres à la Biblio thèque nationale, oùon lit simplement : «D'après un tableau qui existe à Venise. » De sorte qu'il y eut repentir ou indécision. Mais cette indécision cesse quand on voit qu'en entrant chez le Régent la toile du Titien redevient tout simplement l'Esclavone. On peut voir dans la « Galerie du Palais-Royal », publiée par Couché, la gravure de ce même tableau exécutée par Malœuvre en 1786, avec cette légende qui dissipe latradition formée par Sadler, puis par Ridolfi, et rend à l'œuvre du Titien son vrai caractère, soupçonné déjà par M. Campori, dans son travail Tiziano e gli Estensi. Je supprime tous les incidents; la discussion de l'authenticité de l'œuvre au point de vue du maître, la recherche de l'original entre les quatre répliques de cette même toile que nous connaissons, et enfin la discussion relative à la per sonnalité représentée. Le marquis Campori voit là un portrait de Roxelane et croit retrouver, dans l'œuvre, la toile citée par Vasari comme représentant l'épouse du Grand-Turc, ou plutôt « la Cameria di lei figliola con abiti e acconcia tura bellissima ». MM. Crowe et Cavalcaselle n'acceptent point cette hypothèse, mais ne proposent point de solution; ils se refusent toutefois à la comparaison avec la médaille de Lucrèce, à cause de la différence de l'âge des deux person nages représentés. Pour nous, au point de vue iconographique, le document est absolument nul par la première de toutes les raisons: c'est que l'œuvre n'est point contemporainedu personnagereprésenté ; mais, comme l'originalvientdeModène et qu'il n'est passé à Prague qu'en 1599 (Voir la chronique Spaccini), il fallait le discuter ici. M USÉE DE DRESDE. Je ne fais que donner des conclusions au sujet de deux toiles du musée de Dresde, n° 250 et n° 244 du catalogue, et je supprime toutes les particularités qui résultent de l'enquête. La toile du musée de Dresde qui porte le n° 250y figure sous letitre suivant : La Vierge avec l'enfant Jésus et saint Joseph; Alphonse Ir duc de Ferrare, son épouse, et sonfils Hercule, leur adressent des prières,- Acquis deModène. puis à Londres, où il est vendu cinquante-deux millefrancs au comte de Suffolk; de chez ce dernier il est passé chez Edward Gray, et enfin à Richmond, chez l'amateur bien connu : M. Cook. 124 LES MONUMENTS DES BORGIA. Grégorovius ne cite même pas ce tableau; Crowe et Cavalcaselle y voient la main de Marco ou celle d'Orazio Vecellio; Morelli consent à y voir un Titien

Prétendu Portrait de Lucrèce Borgia, par le Titien.- Galerie du Régent.
Aujourd'hui en Possession de M. Cook, de Richmond.
très endommagé. Au point de vue iconographique, Julius Hübner, le rédacteur du catalogue, met prudemment entre parenthèses, à côté des noms de Lucrèce, LES PORTRAITS DES BORGIA. 125 d'Hercule et d'Alphonse, trois points d'interrogation. Ce qu'il y a de net, c'est que le costume dela femme est vénitien, qu'il porte la date de 1560 à 1580, et que le type ne soutient pas la comparaison avec la médaille. J'ajouterai que c'est la provenance de Modène qui a contribué à faire croire, à Dresde, qu'il fallait voir le duc et la duchesse de Ferrare dans cet ex voto de la fin du xvi° siècle; PLaurentad

Portrait prétendu de Lucrèce au Musée de Dresde. ― (Fragment). ― Attribué au Giorgione.
mais le marquis G. Campori a prouvé que ce tableau ne faisait pas partie de la
galerie du duc Alphonse, et qu'il n'est venu à Modène que beaucoup plus tard
(Voir Tiziano e gli Estensi.
G. Campori). Le type du modèle est si loin de
celui de la Lucrèce des médailles qu'on comprend que Grégorovius n'ait pas
voulu comprendre cette représentation parmi celles qu'il réfute.
MM.Armand Baschet et Feuilletde Conches,dans leurtrès curieux livre inti
tulé : les Femmes blondesselon lespeintres de l'école de Venise, ont constaté dans
126
LES MONUMENTS DES BORGIA.
les termes suivants l'existence, à Venise, d'un portrait qui avait pour lui la tra
dition :
<< D'après les données que nous avons recueillies sur la personne de Lucrèce
Borgia, nous sommespersuadés que cette femme lareprésente. En effet, le tableau
en question, quia été peint pour la maison d'Este,dont il porte les armes, repré
sente un astrologue assis, à droite, dans un beau paysage et y étudiant la sphère,
un compas à la main; àgauche, une femme vêtue de blanc, légèrement penchée
vers un enfant couché par terre, le montre à l'astrologue qui tireson horoscope :
c'est Lucrèce avec son fils, quifut depuis Hercule II de Ferrare et devint le mari
de Renée de France, fille de Louis XII. Le tableau, après avoir longtemps décoré
la galerie Manfrin, à Venise, a passé depuis deux ans en Angleterre. »
Nous prouverons qu'ilfaut reconnaître cette toile dans celle quifigure à Dresde
sous le n° 244 (édition 1880 du catalogue), sousla légende : Ruggiero, aïeul de la
familled'Este, estprésenté encore enfantpar lafée Logistille au magicien Atlante,
afin qu'il lui dresse son horoscope. En bas, un aigle blanc, l'emblème de la
maison d'Este. (Collection Barker, 1874, 560 guinées )
En effet, si nous ouvrons le catalogue de la vente Barker, qui eut lieu à
Londres le 6juin 1874, chez Christie et Meason, nous trouvons l'indication sui
vante :
« Lot 38. Giorgione.-A grand Landscape with Borso d'Este and Lucretia
Borgia, bringing their child, afterwards Ercole d'Este, to have his horoscope cast
by an ancient astrologer, who is dressed in an oriental costume and sits at a
table with a bracs disk and compass in his hand; behind is a ruin with a broken
figure ofVenus in a niche. »
Et si nous feuilletons les livres de Christie et Meason, nous lisons au lot 38 :
<
1
LES PORTRAITS DES BORGIA.
129
daun originale del' Dosso, di cui non abbiamo pero veruna tracia. Essò rappre
senta una dama, dalla cintura pende unventaglio a piume. AlladestraunCupido
di marmo, posato su un piedistallo, le offre un pomo; ed essa stendea sua volta
la destra, per cogliere da un cespugliò, che lo sta da sinistra, un limone. Sulpie
distallo, leggonsi queste parole : LUCREZIA BORGIA ÆTATIS SUE XL A. C. NIV Mdxx.
Al disopra des piedistallò trovase incisa una De un osso incruciato, il mono
gramma del Dosso. »
Et les auteurs de La peinture dans le nord de l'Italie ajoutent : « mais
comme Lucrèce n'atteignit jamais l'âge de quarante ans, puisqu'elle mourut en
1519, on doit conclure de là que ce portrait n'est pas authentique ». La conclu
sion est à la fois juste et sévère; et cette erreur d'une année dans la date ne
suffirait pas pour nous empêcher de croire à l'authenticité de l'attribution.
Nous n'avons pas pris facilement notre parti de la perte de l'œuvre signalée
par MM. Crowe et Cavalcaselle, et l'enquête que nous avons ouverte à ce sujet a
amenéladécouverted'unepiste qu'on pouvaitsuivre pour en constater l'existence.
Au dire de M. Robinson, dont on connaît toute la compétence, et de notre
honorable ami M. Henry Wallis de Londres, ily avait il ya quelques années en
Angleterre un « genuine portrait>> de Lucrèce Borgia par Dosso Dossi, quirépon
dait à la description de MM. Crowe et Cavalcaselle. Ce tableau venait d'Italie ;
un marchand connu, mort aujourd'hui, M. Pinti, l'avait acheté, et ce n'est qu'en
1880 que l'œuvre, apportée à Paris, a été vendue à un amateur dont M. Pintin'a
pas consigné le nom sur ses livres.
Cet amateur, nous l'avons découvert grâce à la publicité de la Gazette des
Beaux-Arts; une esquisse de ce travail publié dans cette belle Revue ayant été
lue par M. le comte d'Antas, ministre du roi de Portugal en Angleterre, l'hono
rable diplomate nous révéla la présence, chez M. Henry Dœtsche, un grand ama
teur de Londres, d'un beau portrait peint à l'huile qui répondait à la description
de MM. Crowe et Calvacaselle. M. Henry Wallis, critique anglais, bien connu
par d'intéressants travaux sur la Céramique orientale et des excursions dans toutes
les directions de l'art, s'est chargéde faire un examen sérieux de l'œuvre, etenfin
son heureux possesseur, avec une courtoisie dont nous sommes reconnaissants,
nous a donné les moyens d'en faire la belle reproduction qui accompagne cetra
vail. L'œuvre est magistrale,maisil faut renoncer àvoir là un portraitde Lucrèce :
elle est de toute évidence par le costume du modèle, par sa coiffure, le col à la
17
130
LES MONUMENTS DES BORGIA.
Médicis, enfin parl'espritetla conception,due à un maître de lafin du xvi siècle.
Elle est italienne à coup sûr, et le singulier rébus, signature de Dosso Dossi, qui
consiste en un D et un os en croix indique que le maître de Ferrare ou son pla
giaire a voulu faire une restitution. Tant de précautions pour affirmer l'identité
dumodèle,uneinscription portantle nom,puis l'âge, une signature d'artiste, enfin
les armes de Borgia sur un médaillon pendu au cou et par surcroît, les armes
pontificales ! C'est trop, ce luxe inusité d'indications nettes et décisives pour la
postérité, indique de l'après coup ; il n'a jamais été dans l'esprit du temps. Dans
une lettre qu'il nous adressait au sujet de ce portrait perdu et que nous retrou
vons chez M. Dœtsche, M. J.-C Robinson, si compétentdans ces questions, nous
disait : « Le portrait est évidemment de Dosso Dossi, mais je ne crois pas que
la peinture soit de 1520, ilfaut voir là un portraitposthumefait par Dosso vers la
fin de savie, de 1550 à 1560 (c'est-à-dire plus de quarante ans après la mort de
Lucrèce). Jepense que mon tableau était une copie anciennede l'originalperdu, et
c'est pour cela que je l'ai cédé à M. Pinti ». L'œuvre reste très intéressante et
d'une singulière saveur.
Après avoir examiné ainsitous les portraits prétendus deLucrèce, nous allons
produire une œuvre inconnue jusqu'ici qui porte une lueur dans tant d'obscu
rité ; ce document nouveau figure au musée de Nîmes, dans une collection léguée
à la ville par M. Robert Gower¹; nous proposons d'y voir non pas un original
mais la reproduction d'un portrait authentique de Lucrèce Borgia.
1.
M. Robert Gower, sujet anglais, dirigeait à Marseille une agence sous la raison sociale Robert
Gower, Estrine and Co. Retiré depuis quelques années des affaires, il vivait à Aix; il y est mort, léguant
sa collection sous certaines réserves à sa ville natale ; à son défaut, il désignait cinq ou six villes d'An
gleterre, et, en dernier ressort, la ville de Nîmes. Il instituait toutefois une usufruitière, Mme veuve
Sibourg, née Sensebruner, aujourd'hui Mme de Saint-Pons. Aucune des villes désignées n'a accepté les
réserves, Nîmes a réclamé l'héritage, la famille a plaidé; enfin, après production successive de sept
testaments différents, le litige s'est terminé à l'avantage de Mmede Saint-Pons, qui, par un acte du
23 janvier 1875, a renoncé à l'usufruit en faveur de la ville de Nimes, moyennant indemnité.
M. Perrot, l'honorable directeur du Musée et de l'École des Beaux-Arts de Nimes, dès que nous lui
avons signalé l'importance de ce panneau, a bien voulu fouiller les archives de la municipalité pour
éclaircir la question d'origine; nous avons poursuivi nous-même à Marseille l'enquête commencée, et
grâce à M. Herrente, avoué, à M. Meilhac de Fougeolles et à M. Estrine, nous sommes arrivé à cette
constatation : M. Robert Gower, collectionneur plus passionné que clairvoyant, a dépensé en achats
d'œuvres d'art plus de 600,000 francs, dont il reste trace sur les livres de sa maison. Un marchand de
tableaux et curiosités de Marseille, aujourd'hui décédé, M. Valy, avait rapporté la Lucrèce d'Italie dans
un fondde collection, et l'avait vendue, avec nombre d'autres, à son client ordinaire. M. Gower attachait
LES PORTRAITS DES BORGIA.
131
On remarquera, à droite du panneau, l'inscription mise après coup : LVCREZIA.
B... A. MVXXVII. Nous avons prié notre collègue et ami, M. G. Lafenestre, con
servateur de la peinture au Musée du Louvres, de s'arrêter à Nîmes pour
contrôler nos observations et celles du directeur du musée, M. Perrot; voici le
résultat de son examen : « Le panneau, que j'ai vu de près, me paraît bien
du xvi° siècle, la peinture aussi. Quant à l'inscription, assez lourdement refaite,
comme vous me l'avez observé, elle remplace évidemment une première inscrip
tion effacée. Ce n'est pas un original, il n'y a aucun doute; c'est même une copie
assez faible. Les vêtements seuls sont traités avecune certaine habileté mécanique
qui prouvebien à quel genre d'ouvriers nous avons affaire ».
Le directeur du Musée, M. Perrot, est plus indulgent pour l'œuvre. « Je crois
cette peinture de l'École lombarde, et, malgré un défaut dans la bouche, elle me
semble faite par un peintre d'un certain mérite. La date marquée sur le portrait
est bien certainement très ancienne, cependant elle doit être postérieure à l'exécu
tion; on distingue, dans l'intervalle, les traces d'une inscription antérieure,
mais tout à fait indéchiffrable. Les détails du costume, qui sont nombreux, sont
traités avec assurance ; d'où il résulte queje ne crois pas que ce soit une copie. »
Original ou copie, je ne m'attache point à cette discussion ; mon opinion
personnelle , toutefois , après un second examen fait à Nîmes, est que nous
du prix au panneau; il l'avait fait doubler dans son entier avec du noyer et parqueter avec des traverses
en chêne.
La seule indication dont on trouve la trace sur les catalogues du possesseur est celle-ci : « École
vénitienne. Portrait de Lucrèce Borgia. Bois. Hauteur, om, 58 ; largeur, om,42. En buste, de grandeur
naturelle. »
Il est nécessaire de commenter l'inscription. Les lettres sont lourdement repeintes en or, après coup,
sur une inscription plus ancienne. La date MVXXVII prête aux conjectures (car Lucrèce meurt en 1519).
La première hypothèse est celle-ci : On avait effacé le nom et la date ; on les aura mal déchiffrés en les
remettant un certain nombre d'années après, à moins que 1527 soit la date de l'année où on a mis la
nouvelle inscription. Enfin, dernière conjecture': cette inscription est encore plus récente, et celui qui
l'a tracée ne savait pas la date exacte de la mort de Lucrèce et a cru lire 1527. Quoi qu'il en soit, il y a
eu mutilation de l'inscription primitive, et, si on considère que la seconde ne porte que ces lettres
LUCREZIA B... A., on pourra peut-être conclure de là qu'on ne se souciait pas encore à cette époque
d'étaler publiquement le portrait d'une Borgia.
Comme il faut être très sincère en tout ceci et bien se garder de pencher de son propre côté, je dois
dire que le Z dans Lucrezia n'est pas du temps ; on écritLuchretia ou Lucrecia, et presque toujours Lu
cretia. C'est ainsi que signe la duchesse de Ferrare. Les Vénitiens seuls écrivaient alors Lucrezia. J'ajoute
qu'aucune de mes objections relatives à l'inscription n'infirme les points de contact que présente l'image
avec la médaille et avec la représentation de Ferrare appartenant à Mgr Antonelli.
132
LES MONUMENTS DES BORGIA.
sommes en faced'unereproduction même assez faible; Lucrèce avait sous lamain
des artistes considérables : et si elle a posé, elle n'a pu appeler à l'honneur de
la peindre que des maîtres sûrs d'eux-mêmes.
Le seul point important pour nous, c'est la ressemblance, disons mieux.
l'identité absolue du panneau du musée de Nîmes avec la médaille à la résille et
le portrait de Ferrare appartenant jadis à Mst Antonelli qui, après les médailles,
est la seule œuvre que, jusqu'ici, nous regardons comme une copie authentique
d'un portrait dont nous ne connaissons pas l'original. Comparons-les : mêmes
cheveux châtain clair à reflets dorés, même coiffure, même hauteur démesurée
du front, délimité nettement à la naissance des cheveux par le cercle d'or; et
même arc des sourcils en « amande ». La mode des vêtements n'a pas changé;
ce sont les mêmes crevés, le même corsage, les mêmes bijoux, la même résille.
Dans le portrait de Ferrare, la mèche de cheveux (visible aussi dans les deux
médailles) pend inerte; dans le portrait de Nîmes, elle est frisée à la lombarde. Le
petit bouillonné blanc, précieusement tuyauté, de la chemisette des Flandres, se
répète aussi, plus sommairement indiqué, dans le portrait de Ferrare.
Je crois que le lecteur, en comparant les documents, ne se refusera pas à
voir la même personne dans le portrait de Ferrare, dans les médailles et dans le
portrait de Nîmes; avec cette différence que Lucrèce est plus âgée dans cette
dernière représentation.
Je pourrais citer ici le témoignage de quelques-uns des maîtres de l'opinion
desquels on aime à s'autoriser, mais je ne veux pas les engager; les documents
seuls parleront. La peinture italienne ne compte pas deux chefs-d'œuvre de plus
(car, je le répète, nous sommes en face de deux copies), mais nous pouvons pré
tendre déjà posséder, en dehors des deux médailles, deux représentations peintes
contemporaines de Lucrèce,
l'une à Ferrare, chez Mr Antonelli,- l'autre au
musée de Nîmes, dans la collection Gower.
EUX NOUVEAUX PORTRAITS A FLORENCE ET A VENISE.
Ce n'est point
assez, notre patience longtemps exercée a été récompensée; car nous
allons pouvoir joindre au portrait de Nîmes, et les lui comparer,
deux autres portraits de grandeur nature, incontestablement faits d'après un
même original, cet original est autre encore que celui de Nîmes, et, plus que pro
bablement, de la même main.
LES PORTRAITS DES BORGIA.
133
Le premier de ces nouveaux portraits appartient à M. Spence de Florence,
grand connaisseur, grand amateur, le même qui autrefois a su mettre la main sur
le fameux fourreau de l'épée de César Borgia et l'a livré au musée du South
Kensington. Le second est, à l'heure actuelle, aux mains de M. Gugenheim, dont
le nom est si honorablement connu à Venise. Ces deux copies se distinguent
l'une de l'autre par des nuances qui font tout le prix de l'une d'elles. Désirant
livrer l'œuvre au public autant que possible avec son relief et sa vie, nous avons
choisi pour la reproduire en couleur celle qui appartient à M. Gugenheim qui a
bien voulu nous en faire exécuter un fac-similé. On retrouvera là la lourde
Lucrèce du portrait de Ferrare et celle du portrait de Nîmes, la Vénus aux yeux
de bœuf, comme une divinité d'Homère, avec des traits réguliers, ronds, sans
accents et sans caractère, assez d'ampleur, de la noblesse et de la régularité, mais
rien de vif ni de piquant, rien de ce qui constitue un caractère et une physiono
mie; une image sans flamme, sans passion et sans sensualité. Le portrait de
M. Spence, plus délicat, plus nerveux dans le dessin, ajoute à celui-ci un air
de grandeur et je ne sais quoi de plus achevé. On peut voir dans cette image
une « triomphante princesse », ainsi que le disait le chevalier Bayard, on n'y
devine ni une Messaline, ni une courtisane couronnée. Il n'y a plus à prouver
désormais l'authenticité des traits de ces images, puisque nous avons deux types
identiques dont déjà nous sommes sûrs, et la comparaison de ces deux nouveaux
portraits (d'une parité telle qu'il suffit d'en reproduire un seul) est hors de con
testation. Ces quatre Lucrèce vues par le même artiste, le même jour, portant les
mêmes ornements, la même résille, les mêmes colliers, les mêmes costumes aux
manches amples qu'on retrouve dans le dessin de Dosso Dossi du Louvre,
représentent le même personnage, et c'est bien probablement à l'un des frères de
cet artiste, lepremier qui fut peintreofficiel de lacour de Ferrare, qu'il faut encore
attribuer l'original, malheureusement perdu au fond de quelque galerie inconnue
ou, plus probablement encore, irrévocablement perdu pour nous.
UCRÈCE D'APRÈS LES DÉPÊCHES DIPLOMATIQUES DU TEMPS.
Essayons ,
maintenant que nous sommes en possession d'une représentation vraie,
de dessiner la forme et le relief de l'héroïne d'après les témoignages
des contemporains, afin de voir si le portrait physique de Lucrèce Borgia
correspond à l'idéal qu'on se peut faire de cette héroïne, que l'histoire a flétrie
134
LES MONUMENTS DES BORGIA.
et que les plus grands efforts de la critique moderne ne sauraient réhabiliter.
Le premier qui l'a vue et décrite, c'est Lorenzo Pucci, le juriste, ambassadeur
de Florence auprès du Vatican. Il le constatedans sadépêche du24décembre 1493.
Il entre chez la nouvelle maîtresse du pape, la belle Julia Farnèse; il y trouve
Lucrèce, qui ressemble d'une façon frappante au pape son père... « Adeo ut vero
ex ejus semine, orta dici possit ». Ces dames ne sont point intimidées par la pré
sence de l'ambassadeur; madame Julia déroule ses cheveuxet se faitaccommoder;
la belle chevelure tombe jusqu'à ses pieds... « Nulla di simile vidi mai... pareva
davvero un sole ¹ » . Lucrèce en a fait autant; elle avait d'abord un peignoir à la
napolitaine qui la recouvrait tout entière; elle sort, et revient richement parée.
Elle n'a que treize ans, mais elle est précoce, dejà fiancée d'ailleurs; elle porte la
fameuse résilledela médaille reproduite dans les deux portraitspeints, à la mode
du temps : « Portava una reticella leggiera come fumo, con certi profili d'oro. »
Lucrèce était brune, c'est certain ; comment pouvait-il en être autrement?
Elle est fille de la Vanozza, une Transtévérine, et de Rodrigo Borja, presque un
Maure, puisqu'il est né à Jativa près de Valence. Et pourtant les cheveux d'or de
Lucrèce sont célèbres; la fameuse mèche de cheveux, contenue dans la lettre à
Bembo, qui faisait rêver lord Byron, et qu'on montre encore à l'Ambrosiana, est
blonde commele latakié ; enfin, il faut le reconnaître, il est souvent question dans
les dépêches de ses « capelli aurei ».
La vérité est que Lucrèce est de la couleur qui lui plaît; car elle se teint tous
les cinq jours au moins, et, quand elle reste huit jours sans se laver les cheveux,
elle souffre de migraines. Les médecins d'aujourd'hui diraient probablement que
les toxiques déterminent le mal dont elle se plaint fréquemment. Nous avonstou
jours supposé que le médailleur à l'ange captif(comme l'appelle M. Armand
dans son savant catalogue) où les cheveux de la duchesse tombent sur ses épaules,
a ébauché sa cire dal vero, dans un de cesjours qu'elle consacrait tout entiers à
lavarsi il capo. On voit que ce jour-là elle recevait les intimes, les poètes, les
artistes, les familiers. Dès la fin du xv° siècle, c'est la mode pour les femmes
d'être blondes ; c'est un art de se blondir, l'Arte biondeggiante auquel MM. Bas
chet et Feuillet de Conches ont consacré tout un volume, jouera un rôle considé
rable jusqu'à la fin du xvi° siècle.
1.- Jamais,je n'aijamais rien vu de semblable, on aurait vraiment dit un soleil. »
LES PORTRAITS DES BORGIA.
135
Le livre de Vecellio est postérieur à Lucrèce; il est devenu banal, mais il est
si complet qu'on peuttoujours le citer : « Aux heures où le soleil darde ses rayons
lesplus verticaux et les plus cuisants, les femmes montent sur les logettes de bois
de leurs terrasses et se condamnent à y griller et à s'y servir elles-mêmes. Assises,
elles baignent et rebaignent sans cesse leurs cheveux avec une éponge imbibée
d'une eau deJouvence préparée de leur main ou achetée. Le soleil a-t-il séché la
chevelure? vite elles la baignent de nouveau de la même mixture, pour la sécher
encore au feudu ciel etrenouveler sans repos le même manège. C'est ainsiqu'elles
se rendent les cheveux blonds comme on les leur voit. Quand elles se livrent à
cette occupationsi importante, elles jettent par-dessus leursvêtements un peignoir
de soie très blanc d'une grande finesse et légèreté, qu'elles appellent schiavonetto.
En outre, elles se couvrent la tête d'un chapeau de paille sans fond, par l'ouver
ture duquel passent les cheveux, qu'elles étalent sur les bords exposés au soleil
pendant toute l'opération' . »
Lucrèce, quand elle part de Rome pour aller à Ferrare, où ellevarégner, met
vingt-sept jours àfairele voyage. Elle s'arrête cinqjours encinq fois, spécialement
pour « lavarsi il capo » , et ces jours-là elle suspend la marche de tout un monde
de princes, d'ambassadeurs, de dames, d'écuyers et d'hommes d'armes. Don Fer
rante, ambassadeur de la cour d'Este, avait fait ses calculs pour fixer le jour de
l'entrée triomphale; il est obligé d'écrire à son souverain : « Madame Lucrezia a
voulu un jour de repos, pour mettre en ordre ses toilettes et se laver la tête;
opération qu'elle n'a pu faire, dit-elle,depuis une semaine; ce à quoi elle attribue
les douleurs de tête dont elle souffre. »
On pourrait, à la rigueur, retrouver dans un très curieux manuscrit cité dans
les Femmes blondes de Venise, par Deux Curieux , la recette employée par Lu
crèce adfaciendum capillos aureos. Cette héroïque Catherine Sforza, la Virago
de Machiavel, mère de Jean des Bandes Noires, dont on sait, enfermée dans
Forli, la réponse shakspearienne et le geste impudique et sublime, ne négligeait
point ces féminins artifices ; et, de sa propre main, afin d'en bien garder le secret,
elle avait noté les recettes longuement élaborées par ses alchimistes. Ce précieux
I.
Ce chapeau sans fond s'appelait La solana; il faut voir à ce sujet le fameux tableau de Carpaccio
conservé au Museo civico de Venise.
2.- Aubry, éditeur. Paris, 1865.
136
LES MONUMENTS DES BORGIA.
manuscrit existe encore; voici, d'après lui, la recette qui semble courante au
temps de Lucrèce :
<< Faites une lessive de cendre de buis, et c'est bien. Prenez de la paille d'orge
et faites bouillir pendant unjour. Faites une secondelessive avec cette eau et cette
cendre. Jetez dedans de la fleur de noyer et quelques feuilles de l'arbre. Laissez
infuser pendant une nuit. Le lendemain, lavez-vous-en la tête, et vous aurez les
cheveux dorés. »
Oui sans doute, mais à la condition de vous laisser sécher au soleil, et au pé
ril des névralgies dont se plaint Lucrèce.
Nous avions pupenser que le médailleur avait saisi la duchesse de Ferrare sur
le vif, un jour de « lavage » ; mais il a pu aussi la voirpasser unjourdetriomphe :
car Don Ferrante, l'ambassadeur, nous la montre dans une de ses dépêches en
trant à Ferrare les cheveux flottants sur les épaules. C'était hardi ; mais il faut
remarquer, dans la description, qu'elle a ingénieusement combiné la résille avec
le désordre raffiné et voulu de ses cheveux épars.
« Lucrèce, dit-il, portait une robe à manches ouvertes de velours noir (c'est la
forme des manchesdu portrait de Nîmes), bordée d'unfin liséré d'or... Surla tête,
une résille en forme de voile, scintillante de diamants et d'or, sans diadème : pré
sent de son beau-père. Elle avait au cou un collier simple de grosses perles etde
rubis, qui avait autrefois appartenu à la duchesse de Ferrare (comme Isabelle
Gonzague le faisait remarquer avec un soupir). Sa belle chevelure flottait éparse
sur ses épaules.
On pense involontairement au beau carton de Léonard, la tête de profil pi
quée pour le décalque(Salle 2 des dessins du Louvre, nº 390), sous laquelle Du
pinet de Vorepierre (au nom deje ne sais quel témoignage) écrit sans façon, dans
son Dictionnaire illustré des noms propres, lenom de Lucrèce'.
Après les cheveux, voyons les bijoux; les perles surtout, car la perle était sa
folie ; onvoit commeellelesprodiguedanslesportraits de Ferrare,deNîmes,etceux
de MM. Spence etGugenheim de Venise. « Tenez, s'écriait lepape, sonpère,devant
l'envoyé d'Hercule d'Este qui venait demander Lucrèce pour sonfils, enplongeant
I.
Dans une étude publiée par la Gazette des Beaux-Arts, nous nous sommes spécialement attaché
à l'attribution de ce portrait, et l'avons rapproché de certaines lettres de Léonard de Vinci à Isabelle
ou à ses ambassadeurs, relatives à un portrait al carbone que ce dernier aurait fait d'Isabelle d'Este. Il
reste peu de doutes au sujet de l'attribution; le portrait serait celui d'Isabelle Gonzague.
LES PORTRAITS DES BORGIA.
137
ses mains dans un coffre rempli de perles : tout cela est pour elle! Je veuxqu'elle
soit, en Italie, la princesse qui ait les perles les plus belles et les plus nombreuses. »
L'ambassadeur était déjà convaincu; son maître, Hercule, l'avait chargé de
direàcelle qui allait devenir sa belle-fille, qu'il tenait à ce qu'elle portât ses joyaux
avec elle et se gardâtbien de les aliéner. « Je me réserve de lui envoyer une riche
parure. Lucrèce est leplus précieux desjoyaux et mérite d'avoir des pierres pré
cieuses plus riches et en plus grand nombre que moi-même et que ma femme ». Il
faut croire que le duc de Savoie était alors un prince fort opulent, car Hercule
d'Este ajoute : « Je ne suis sans doute pas un homme aussi puissant que le duc de
Savoie, mais cependantje suis en pouvoir de lui envoyer des joyaux non moins
beaux que ceux qu'il possède. » Cette promesse fut exécutée, et voilà pourquoi la
Gonzague était jalouse. Un envoyé spécial, un ecclésiastique qu'elle avait chargé,
comme un reporter mondain d'aujourd'hui, de la renseigner surtout ce que por
tait la fiancée, vêtements et bijoux, avait encore renchéri sur les lettres privées
du cardinal d'Este à sa sœur Isabelle. Dans une relation manuscrite qu'on con
serve aux archives de Mantoue, signée El prete, cet envoyé spécial montre
Alexandre VI recevant, des mains mêmes de l'ambassadeur d'Hercule, les cadeaux
pour la fiancée : il les fait miroiter àlalumière, appelle les cardinauxetles femmes,
essaye les parures, les met sur fond d'étoffes sombres pour les faire valoir : il se
figure déjà les voir scintiller sur les belles épaules de sa fille : « Catene, anelli,
orechini, pietre bellamente legate, e magnifico in particolar modo, un monile di
perle. »
Le même envoyé la vit un autre jour dans un costume tout blanc tissé d'or,
avec des manches ouvertes de brocard blanc relevé d'or, serrées à l'avant-bras,
avec des crevés à l'espagnole; et au cou, comme toujours, un rang de grosses
perles : Al nostro cardinale Ippolito scintillavano gli ochi : ella e donna sedu
cente et veramente grazioza. » On voit que le cardinal est sensible.
<< Séduisante et vraiment gracieuse » , c'est quelque chose déjà; mais était-elle
vraiment belle ? Les témoignages ne manquent pas, mais on s'en tient si bien à
des généralités qu'on ne la voit pas nettement. Bernardo Zambotto, le jour même
du mariage, dit d'elle : « Elle a vingt-quatre ans.- (Elle n'en a que vingt, et il
faut signaler en passant ces erreurs de témoins oculaires qui suffiraient à nous
expliquer les différences de date dans les peintures ) —Elle est très belle devisage,
elle a de beauxyeux éveillés, elle est droite dans toute sa personne, et sa stature est
18
138
LES MONUMENTS DES BORGIA.
avenante, etc., etc. » Cagnolo (qui représente Parme au mariage) la peint mieux :
« Elle est de taille moyenne, svelte; la face est plutôt longue, le nez est beau et
bien profilé, les cheveux sont dorés, les yeux sont blancs (?), la bouche un peu
grande, les dents étincelantes, la gorge ferme et blanche, ornata con decente valore
(on ne saurait mieux dire). Tout son étre enfin respire l'allégresse et le sourire. »
Tout le monde, à toutes les époques de sa vie, a insisté sur la gaieté de la
physionomie de Lucrèce; elle tient cela de son père, qui a la concupiscence
joyeuse et dont le visage exulte toujours. Traquée par le sort, toujours un pied
dans le sang, tour àtour fiancée infidèle, veuve d'un époux assassiné (et qu'elle
aimait), bientôtl'épouse d'un autreetdivorcéemalgré elle,témoinenfin du meurtre
de son frère et de son époux: on la croirait marquée au front d'une tristesse
fatale, ou poursuivie par des visions. Point du tout; elle a toujours « grazia e
allegrezza » , et il n'y a pas un seul contemporain qui ne parle de sa « giovialità. »
Mais nous ne voyons rien de tel dans ces portraits officiels où elle est grave
comme une châsse et pose pour la postérité.
La marquise de Cotrone, dame d'honneur d'Isabelle d'Este, qui accompagnait
sa maîtresse aux fêtes de Ferrare, veut rassurer le marquis de Mantoue sur
l'issue de l'assaut de beauté qui va se livrer entre les trois princesses, le jour de
l'entrée. Lucrèce, Isabelle d'Este et la duchesse d'Urbino sont en présence : « La
fiancée, écrit-elle au marquis de Mantoue, n'a rien de particulier quant à la
beauté, mais elle a dolce ciera.
(N'oublions pas que c'est une femme qui parle,
et une femme jalouse, qui assure que sa maîtresse, dans ce combat, est sûre de
remporter le prix) : Espero a tal riguardo noiporteremo ilpallio nella casa della
mia padrona. C'est-à-dire : « quant à la beauté, à nous le pompon!>>>
Ce mot intraduisible dans sa grâce : Dolce ciera- (Doux visage est bien froid)
restera le mot définitif. Après avoir tout lu, tout compulsé, fureté dans tous
les sens, interrogé les images anonymes, comparé les récits et fait la part des
circonstances et des choses , nous pensons que c'est encore la dame de Cotrone
qui aura dit le vrai mot. Je vois Lucrèce ronde (comme disent les peintres), à
face pleine, sans traits bien définis, avec de grands yeux blancs, très ouverts,
très loin des sourcils, mollement dessinés en amande; un front lisse très décou
vert, le menton fuyant (très en retraite dans les dix premières années de sa vie
de femme, plus tard arrondi et ingrassata). De tout cela il résulte, au physique,
la même physionomie qu'au moral; c'est-à-dire quelque chose dedoux, de mou,
LES PORTRAITS DES BORGIA.
139
sans volonté, sans élan, sans joies exaltées et sans colères terribles, une femme
sans nerfs, incapable de réagir contre le sort, qui fait d'elle, entre Alexandre et
César, un instrument trop docile.
ARome, enfant, on la conduit par lamain aux orgies célèbres dans l'histoire;
elle ouvre ses grands
yeux blancs et necom
prendrienàces satur
nales ; jeune fille, on
fait d'elle la rançon
d'un duché ou d'un
trône ; et cette main
ornéedel'anneaupon
tifical, qui, les deux
doigts levés, lie et dé
lie ceux que l'Église a
unis, la promènera du
lit d'Alphonse au lit
de Sforza, puis enfin
au lit d'Este à travers
une mare de sang.
Mais , le jour où
Alexandre est mort,
quandCésaresttombé
en Navarre, elle de
vient et reste jusqu'à
la mort la « perle des
épouses », la « triom
phante princesse » que
le chevalier Bayard a connue et exaltée. Alphonse d'Este, son mari, court le guil
ledou.- « Il signor Don Alfonso, ildi, va apiacere in diverse loci come giovane,
il quale, dice sua santità, fa molto bene.
Du moment qu'il a l'approbation
du saint-père, tout est régulier; maxime (dit l'ambassadeur Costabili en écrivant
au duc de Ferrare) intendendo che continuano dormire insieme la notte. A peine,
en dix-huit années, pourra-t-on reprocher à Lucrèce une amourette de poète
7
140
LES MONUMENTS DES BORGIA.
et sept billets doux, ceux au cardinal Bembo: des lettres quetoutes lesAnglaises
vont lire à l'Ambrosiana de Milan sans ouvrir leur éventail, et qui sont traduites
dans toutes les langues.
Voilà bien du bruit pour un Flirt au xvi siècle, et
après bien des années de recherches, c'est le seul dont il reste des preuves ! On
oublie que, quelques années avant, Sigismond Malatesta, le parent et voisin, se
précipitait sur les belles dames qui lui plaisaient et lestuait après les avoir violées.
Lucrèce a « dolce ciera », ellelaissefaire; voilala vérité, etelle demande lapaix
à tout prix; Catherine Sforza, à sa place, eût corrigé la destinée et violé le sort;
elle serait montée à cheval pour s'enfermer dans Nepi ou dans Gradara et couvrir
de son corps Alphonse et Sforza ses deux premiers maris. Plus douce, mais
ferme encore, la duchesse d'Urbin aurait demandé le cloître le jour du meurtre
de Gandia par César Borgia, et, sortant du lit de Pesaro, elle n'eût jamais signé
devant le Vatican le brevet d'impuissance de son mari. La brillante Isabelle
d'Este, la Gonzague,acculée à des destinées si tumultueuses, en esprit politique et
avisé, en eût appelé à l'Empereur « Rex Romanorum » et jeté les bâtons de
l'Empire dans les roues du Vatican. Lucrèce, elle, pleure ou se lamente, mais
elle a toujours dolce ciera. Le portrait physique de la fille d'Alexandre VI
répond à sonportrait moral; et ce portrait nous le connaissons désormais.
Ses origines.
― Elle vient aux mains de l'abbé Galiani. ― Son enquête sur César. ― Ses projets d'écrire
une monographie. ― Travail de M. Ademollo relatif à Galiani. ― Comment l'arme passe des mains
de Galiani à celles des ducs de Sermoneta. ― Description de l'épée ― Les emblèmes. ― Leur interprétation.
― Le Fourreau de l'épée. ― Recherches sur la personnalité et le nom de l'artiste.
― Armes du même Maître dans les diverses collections d'Europe. ― Dessins du Maître. ― Documents
qui nous révèlent sa personnalité.
L'épée, ou plutôt l'une des épées, de César Borgia, qui appartient aujourd'hui
au duc Onorato de Sermoneta, le chef de la famille Gaetani de Rome, jouit d'une
célébrité sans seconde dans le monde des amateurs, où elle est connue sous le
nom de « La Reine des épées. » Si on la considère au point de vue de l'arme en
elle-même et de l'excellence du travail, elle est supérieure par la ligne générale,
la simplicité de la conception, son unité, la richesse des compositions qui décorent
la lame, et le style de l'œuvre, d'un caractère large et grandiose. Les nombreuses
inscriptions qui nous affirment l'origine de cette arme et son authenticité, les
allusions qui se dégagent des compositions, la propriété des termes aussi bien
que l'esprit qui préside à la conception justifient le rapide jugement porté par
l'historien des Borgia, F. Grégorovius : « Le duc de Sermoneta possède une épée
de César Borgia, décorée de gravures pleines d'allusions au César antique, qui
font comprendre quelles idées bouillonnaient alors dans l'esprit du cardinal. »
1.- On verra plus loin que le fourreau de l'épée de César, que nous reproduisons sur toutes ses faces,
n'a jamais été terminé, et conséquemment, a pu ne pas être livré, il a été trouvé dans ces trente dernières années par M. Spence, un grand amateur de Florence, qui l'a cédé au South-Kensington pour la
somme de cent livres sterling.
Nous les rapprocherons l'un de l'autre afin de les
étudier dans tous leurs détails ; pas un n'est indifférent, en ce sens qu'il est personnel au héros où nous parle de lui, et nous montrerons dans tout leur relief,
avec leur étrange saveur, les emblèmes et les compositions dont on a pu tirer
des conclusions si hautes. La critique historique ne néglige plus les monuments,
et elle s'en trouve bien ; l'architecture, l'épigraphie, la numismatique, les objets
d'arts eux-mêmes, qui ne semblaient destinés qu'à charmer les yeux, parlent
souvent avec plus d'éloquence et surtout plus de sincérité que les documents
écrits ou les témoignages des contemporains que la passion nous rend suspects ;
quand on les étudie avec persévérance, il jaillit parfois de ces muets témoins
une lueur qui éclaire une époque, montre les replis d'un caractère et nous fait
mieux comprendre une personnalité.
L'arme a son histoire, curieuse à coup sûr, mais dont on ne connaît guère
que les dernières péripéties ; un écrivain italien contemporain, grand investigateur des archives, auquel on doit nombre de notices historiques sur divers sujets,
M. A. Ademollo, sous le titre La Spada del Duca Valentino en a fait l'objet
d'une description minutieuse publiée il y a quelques années dans un journal de
Rome La Fanfulla. Les diverses informations données à son sujet par M. Ademollo, complétées encore par sa publication intitulée La Famiglia e l'Eredita
dell'abbate Galiani¹ nous permettent de remonter non pas aux origines premières,
mais à 1734 seulement.
1. Roma, A. Sommaruga. Via Due Macelli, 3.
Cancellieri, dans une lettre à Sebastiano Ciampi sur les épées célèbres (Spade
celebri), a constaté le premier l'existence du glaive sans cependant l'avoir vu, puisque les quelques lignes qu'il cite à son sujet sont erronées ; il est évident qu'il a
écrit sous la dictée de correspondants mal informés, car il affirme que la devise
Aut Cesar aut nihil est gravée sur chacune des faces de la lame, alors qu'elle n'y
figure nulle part. En 1788 le père Agostino Cesaretti, dans son Histoire de la principauté de Piombino, fait à son tour une allusion avec beaucoup plus de certitude,
ayant été en relation avec le possesseur, qui n'est autre que le fameux abbé Galiani. Ami de Diderot, de Grimm, de madame d'Épinay, collectionneur, latiniste
de premier ordre, archéologue à ses heures, et secrétaire de l'ambassade de Naples
à Paris , l'abbé, disgracié, rentré dans sa patrie depuis 1769 est resté en correspondance avec la coterie philosophique, et, dans une lettre à madame d'Épinay
du 2 octobre 1773, il a fait à ses amis de Paris la confidence de sa trouvaille, sans
cependant leur en révéler l'origine 2.
2. « Je possède une pièce fort curieuse; c'est l'épée de César Borgia, duc de Valentinois, qu'il fit
travailler exprès avec des emblèmes faisant allusion à sa grandeur future et à son ambition. Il est
superflu de vous conter comment, par quels détours, cette épée est tombée dans mes mains. Je voulais
en faire un présent lucratif au pape et, selon mon usage, l'accompagner d'une dissertation érudite pour
en illustrer les emblèmes. »
(Voir à ce sujet Les Lettres de l'abbé Galiani, publiées par Lucien Perey
et Gaston Maugras). Ferdinand Galiani était né le 2 décembre 1728 à Chieti, son père était auditeur
royal et son oncle Mgr Célestin Galiani, qui avait voulu se charger de son éducation, était évêque de
Tarente et premier aumônier de Charles III. Grimm, dans sa correspondance (août 1768), a dit de l'abbé :
« Je n'ai jamais rencontré qu'un seul homme qui sut le latin, et cet homme est un italien, M. l'abbé
Galiani.>> On sait qu'il avait débuté comme officier du secrétariat d'État et de la maison royale ; nommé
le 10 janvier 1759 secrétaire d'ambassade à Paris, il y devint tout de suite à la mode par son esprit et
son érudition, le Dialogue sur le commerce des blés mit le comble à sa réputation dans les salons. Rappelé en 1769, il regretta longtemps son poste et mourut à Naples, le 30 octobre 1787, à l'âge de 58 ans
et 10 mois et fut enterré aux Célestins.
Galiani garde l'épée dix années, pendant lesquelles il fait beaucoup de bruit autour de sa découverte; s'efforce de réunir les
éléments de la biographie de César Borgia, dans le but d'écrire une monographie
de son arme, et meurt enfin en octobre 1787 sans avoir mis son projet à exécution : il a disposé de sa possession par un codicile écrit de sa propre main, la
veille même de sa mort. Le testament a été retrouvé dans les archives de Naples,
par M. Ademollo, qui a puisé dans les papiers mêmes de Galiani les documents
qui lui ont permis d'écrire le travail sur lequel nous nous appuyons : La Famiglia e l'Eredità dell'abbate Galiani.
1. Gioacchino di Montallegro, marquis de Salas, d'abord conseiller et secrétaire d'État et de Guerre
de l'infant Charles de Bourbon, puis premier ministre de Charles III.
Le duc de Montallegro aurait donné l'arme à un particulier qui, lui, l'aurait vendue à Galiani.
Comme tout bon amateur, l'abbé a fait le discret; il ne cite ni le prix qu'il a payé,
ni le nom du vendeur. On sait qu'en 1759 l'arme était encore entre les mains de
Montallegro. L'abbé, qui l'avait acquise dès 1773, prétend donc l'illustrer, et
comme nous l'avons dit, se propose de rassembler quelques renseignements historiques et biographiques sur César Borgia. M. Ademollo a cité une lettre de
Cesaretti écrite à l'abbé Galiani à la date du 20 octobre 1787, qui prouve que dix
ans après avoir demandé des renseignements à madame d'Épinay il n'a encore
rien publié à ce sujet. Les lettres de madame d'Épinay nous prouvent cependant qu'elle avait été active; elle avait mis en mouvement toute la « séquelle »
philosophique et, en dernier ressort, avait confié l'enquête à Caperonnier, un helléniste
du temps, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, qui, en
somme, n'avait envoyé que des banalités. Galiani confirme le fait avec ingénuité
quand il s'écrie dans une de ses lettres : « Je n'ai jamais pu parvenir à découvrir la date de la mort de ce gaillard-là. » Galiani mourut en octobre 1787,
disposant de la fameuse épée par un des articles de son testament et laissant dix
caisses de manuscrits, vingt-deux volumes de lettres en ordre, et beaucoup
d'autres non classées, sans compter un dossier spécial sur lequel il avait écrit :
« L'Épée du duc Valentino ». En 1884, lorsque parurent les lettres de l'abbé
Galiani qui nous apportaient des révélations directes sur l'Épée de Borgia, nous
nous mîmes en relation par l'intermédiaire de l'un des auteurs de cette publication, avec M. Ademollo, qui voulut bien nous affirmer, après examen du fameux
dossier sur lequel nous fondions des espérances, qu'il n'y avait rien à apprendre là
qu'il n'eut dit déjà dans son volume sur « La famille et l'hérédité de l'abbé Galiani » .
En effet, la récolte était plus que maigre, les auteurs de l'Encyclopédie n'avaient
pu fournir à l'auteur de la Lettre sur les blés que l'Entrée de César à Chinon,
extraite de Brantôme, tant de fois citée par les historiens, et quelques bribes de
mémoires du temps d'un caractère tout à fait banal. En cette occurrence, on se
demande comment Galiani a pu, à cette époque et dans la région qu'il habitait,
ignorer l'existence de la Biographie la plus complète de César Borgia qu'on eut
encore écrite à la fin du siècle dernier, celle de Tommaso Tommasi¹, qui
pouvait, malgré la passion qui anime l'auteur et la naïveté de certaines assertions, servir de base à un travail de la nature de celui qu'il se proposait d'écrire.
1. La Vita del Valentino in Monte Chiaro, 1665.
Cependant, à l'époque où Galiani avait fait cette belle découverte, un monseigneur Onorato Gaetani, l'un des ancêtres de l'actuel duc de Sermoneta, archéologue passionné, qui s'était épris de l'Épée de César et y pensait nuit et jour, en
vint à regarder comme une sublime revanche pour la famille des Gaetani de
posséder le glaive de celui qui avait été le persécuteur de sa famille, la poursuivant par le fer, par le feu et le poison, décidé à exterminer toute la race, et, mettant le comble à ses exactions, donnant au fils de Lucrèce Borgia et d'Alphonse
d'Aragon, le titre de duc de Sermoneta, le plus bel apanage des Gaetani. A
diverses reprises, pendant sept années consécutives, Gaetani essaya de séduire
Galiani et de lui arracher l'arme précieuse; il avait conçu l'arrière-pensée de la
placer dans la Rocca même de Sermoneta, avec une inscription qui rappellerait
les crimes des Borgia et la revanche que le sort
avait réservée aux descendants de Boniface VIII.
M. Ademollo a reproduit à ce sujet une feuille du
journal de Mgr Onorato qui est d'un haut intérêt
pour le sujet, puisqu'elle nous montre l'abbé faisant l'exhibition de l'arme devant celui qui ambitionnait de l'acquérir, et interprétant à sa façon
les emblèmes et les compositions :
« Le marquis abbé Galiani, neveu du célèbre
Mgr Galiani, étant venu à Rome, je le visitai dans
le Palais de l'ambassadeur d'Espagne Grimaldi,
où il demeurait. Je lui offris mon oraison funèbre
en honneur de l'Impératrice Marie-Thérèse, et
dans la conversation, comme nous touchions à
mille sujets, nous en vînmes à parler de l'Épée
du duc de Valentinois qui, d'après ce que j'avais
entendu dire par Mgr Borgia qui l'avait vue à
Naples, lui appartenait. A ma grande surprise
j'appris qu'il l'avait apportée à Rome. Elle était
dans un fourreau de chagrin noir¹...
1. Il est intéressant de constater que Galiani n'a jamais possédé le beau fourreau de l'arme, et que,
par conséquent, le duc de Montallegro ne l'a pas connu davantage. On n'en saurait douter, et parl'extrait
de cette lettre, et par l'absence de toute description et interprétation des compositions et des emblèmes
du fourreau qui, s'il est possible, est plus personnel encore que l'épée, étant criblé d'imprese et de monogrammes de César, comme on en pourra juger, par la reproduction des deux faces.
Suit la description de l'arme et certaines interprétations spéciales que Galiani a accompagnées
de commentaires et d'interprétations des emblèmes sur lesquels nous reviendrons quand
nous étudierons les compositions : « ... L'Épée,
dit Mgr Onorato, doit dater de 1498 ou 99, alors
que César n'avait pas encore abandonné la
pourpre... Ces figures sont de bonne école, et Galiani veut y voir la main de
Michel-Ange... Cette Épée fut donnée en Espagne à la maison de Montallegro
et le duc en fit présent à un particulier des mains duquel elle passa dans celles
de Galiani. »
1. Ces 300 ducats d'or napolitains équivalaient à 3,600 livres d'alors et pourraient représenter aujourd'hui la somme de quinze mille francs. Il n'y a point à estimer la valeur actuelle de l'épée, elle
justifierait comme arme et comme document les sacrifices les plus considérables.
Le fait accompli, l'Épée de César appartenait désormais au chef de la famille, le duc
Don Enrico Gaetani, dont Mgr Onorato, cadet de la famille, n'était que le mandataire. La grande Catherine, cependant, si le droit de préemption n'avait pas
été exercé, devait entrer en possession de l'arme ; dès qu'elle apprit la teneur
du testament, avec l'enthousiasme et le génie qui la dominaient, excitée à l'idée
de brandir le glaive de César Borgia et de le placer dans les fameuses collections
qu'elle formait alors, elle donna l'ordre d'agir à son ambassadeur; elle arrivatrop
tard. Les Gaetani pourtant craignaient de déplaire à Catherine. M. Ademollo a
produit une lettre d'Onorato écrite en français à un de ses amis à l'étranger par
laquelleillepriededéclarerdansquelquesGazettesd'Europe « qu'il se fera un devoir
de faire présenter cette épée à Saint-Pétersbourg, lorsque S. M. Impériale le voudra, prêt à montrer par là à toute l'Europe les sentiments de respect qu'il professe
pour l'Impératrice de Russie. » Il ajoutait à cette marque de déférence cette
réflexion : « C'est bien drôle qu'un abbé laisse une épée à un prélat; tout Naples
en a ri et Rome en rit encore. » Cette déclaration d'Onorato relative à l'Impératrice ne devait d'ailleurs pas avoir de sanction, la grande Catherine n'ayant pas
insisté. Il n'y a pas lieu de s'étonner de l'arrière-pensée de Galiani à l'égard de la
souveraine, car elle était en correspondance avec l'abbé qui tenait à elle par
Diderot, par Grimm et par tout son cénacle. Il avait reçu d'elle de nombreux
présents, on croit même qu'à la fin de sa vie, Catherine lui servait une pension;
ce qui justifierait la reconnaissance infinie pour tous ses bienfaits dont Galiani a
voulu lui donner une preuve dans son testament.
DESCRIPTION DE L'ÉPÉE. ― La forme de l'arme est celle d'un glaive à
quillons très recourbés, à large lame cannelée, du caractère de ceux de
la fin du xv° siècle italien, communément appelés stocchi. Ces glaives
symbolisent le commandement, la suprématie ou une haute juridiction. D'ordinaire, on ne les ceignait point ; un page, un héraut les portait en avant du chef
dans les cérémonies. La poignée est en argent doré, incrusté d'émaux de diverses
couleurs ; l'ornementation de cette partie, où l'artiste se plaît à développer tous
ses moyens, est très simple, elle ne comporte ni composition, ni figures, ni basreliefs , et le premier orefice venu a pu l'exécuter. Comme pour toutes les armes
de cette époque, la beauté, aux yeux des amateurs, réside dans le contour, dans
la silhouette, dans la proportion, l'équilibre et les courbes. Au centre de la garde ,
à l'endroit où s'appuie le pouce, et des deux côtés, on a ménagé un champ
d'émail de couleur bleue; sur l'un s'étale l'écusson aux imprese des Borgia :
le bœuf rouge et les trois bandes noires; sur l'autre, on lit écrit en lettres d'argent : CÉS. BORG. CAR. Valen. César Borgia, Cardinal de Valence. — (Voir le culde-lampe à la fin du chapitre ) C'est la date approximative de l'exécution, de
1494 à 1498. La lame cannelée mesure 1m,025 de longueur sur 0m,83 à la poignée ; elle est dorée sur untiers de sa longueur, et divisée, sur les deux faces,
en quatre compartiments, dont chacun forme le cadre d'une composition gravée
en creux au poinçon. C'est là que s'est porté l'effort del'artiste; on n'a pas craint
de prononcer les plus grands noms en face de cette œuvre ; nous avons vu que
Galiani, un peu naïvement, prononçait celui de Michel-Ange ou celui de Raphaël
enfant, le défunt duc de Sermoneta, mieux informé, parlait de Pinturicchio,
et on verra qu'il y a là une présomption intéressante; enfin une longue tradition désigne aussi comme l'auteur : Antonio del Pollaiuolo, peintre et sculpteur
florentin, né en 1429, mort en 1498. C'est même sous cette dernière attribution
que le fourreau, qui est au South-Kensington, figure au Catalogue.
Sur un fond d'architecture d'un beau caractère antique renouvelé par l'esprit
de laRenaissance, au centre même de la composition, et au-dessus de l'inscription cum numine cesaris omen, s'élève un autel sur lequel se dresse un bœuf paré
de bandelettes. On lit sur le champ : D. O. M. HOSTIA. Au premier plan du tableau
gît la victime, une femme nue, la face convulsée, coiffée de serpents, comme une
Méduse. A côtéd'elle, une cassolette et un réchaud ; à droite de l'autel se tiennent
les canéphores ; à gauche, des femmes nues aux formes élégantes entretiennent
le feu sacré ; un guerrier casqué, vêtu de la chlamyde, ferme la composition.
On a pu constater quel rapport intime lie cette composition à certains épisodes
des fresques du Pinturicchio aux appartements Borgia du Vatican.
1.
Voir lachronique de Febrer,dédiée au fils duroi Don Jayme qui chassa les Maures de Valence.
(Archives de Valence.)
J'ai dit plus haut que dans la pratique de
la vie, la rude consonnance espagnole ayant fait placeau doux parler d'Italie, les
Borja fixés à Romedevinrent les Borgia.
1.
Nous constatons que la lame a été raffermie dans sa poignée ; il est probable que dans cette
opération la garde aura légèrement mordu sur le talon.
Les trois autres compositions découlent encore de l'idée du Triomphe; elles
complètent la série des sujets qui font de cette œuvre d'art le document historique
que nous voulons y voir. « Dans un champ oval entouré de beaux rinceaux de
feuillages où se joue le bœuf de l'écusson des Borgia, deux génies ailés tiennent
le caducée. »
LE FOURREAU DE L'ÉPÉE.
Par une destinée bizarre, qui est celle des
œuvres d'art tout autant que celle des livres, le fourreau de l'épée de
César est, depuis des siècles, séparé de sa lame, ou, plus probablement,
ne l'a jamais accompagnée. Nous avons vu que Galiani ne l'a pas connu.
2.
On avait cru jusqu'ici, et nous avons partagé cette erreur, que le père de Borja avait épousé une
Lanzol, ou Llancol de Romani dont les armes sont représentées dans l'écusson parles Trois bandes d'azur
tandis que le Bœuf représentait Borja ; nous avons produit les pièces authentiques tirées des archives
de Valence qui prouvent que les bandes d'azur sur champ d'or sont l'apanage des Doms, tandis que les
Llancol de Romani ont, selon Febrer : d'azur au soleil d'argent au premier et d'or au croissant d'argent
au second.
― Voir le chapitre Les Borgia, page 24, dans César Borgia. Sa vie.
Sa captivité.
Sa
mort. ― Paris , 1889.
Il suffit de la montrer ici, dans toute sa noblesse et sa simplicité, pour qu'elle s'impose à l'admiration. On remarquera que ce fourreau n'a
jamais été terminé; toute la partie basse des trophées qui ornent le revers n'est que
tracée au poinçon et la lame n'ypourrait même point rentrer, car l'artiste n'a pas
encore coupé, à lapartie supérieure, le morceau de cuir enforme de cœur qui permettrait aux quillons recourbés de s'adapter. Ainsi s'explique que le fourreau et
la lame soient séparés l'un de l'autre; qui sait même si ce fourreau a jamais été
livré à celui qui l'avait commandé.
1.- Materiam superabat opus. — Ovide. — Metamorph. , livre II, 5. On remarquera que l'artiste modifie le temps du verbe, au lieu de superabat, l'inscription dit superabit. Cependant cette modification
qui indique une intention spirituelle et savante chez le graveur pourrait bien n'ètre que le résultat d'une
erreur. Nous montrerons plus de dix lames du même artiste où les inscriptions sont tellement défigurées qu'il faut les restituer pour les comprendre. Nous aurons à revenir sur cette particularité, les
fautes d'orthographe du maître Hercule sont pour nous une signature de l'atelier du maître tant elles
sont nombreuses et habituelles.
L'artiste en a le droit; métamorphosant la matière et, choisissant la plus vile pour lui imprimer une forme exquise,
il l'a rendue plus précieuse que l'or.
Le catalogue du South-Kensington Museum de Londres, attribue la belle
composition de ce fourreau à Antonio Pollaiuolo. Si, à la rigueur, les dates peuvent concorder (l'artiste, dans ce cas, serait mort l'année méme de l'exécution),
il n'y a cependant pas d'analogie entre cette œuvre et une quelconque du grand
orfèvre florentin; toutefois, il était assez naturel de citer son nom; il fut en
faveur au Vatican, etil aexécuté dans Saint-Pierre les beauxtombeaux de Sixte IV
et d'Innocent VIII. Mais l'idée de la collaboration de Pollaiuolo sera
nettement abandonnée si on constate que certaines des figures qui décorent le fourreau et les emblèmes et imprese qui en forment le champ se retrouvent identiques dans les fresques du Pinturicchio exécutées de 1494 à 1496 pour
Alexandre VI, dans les appartements Borgia. Et le dernier doute disparaît en
face d'une belle signature : OPUS HERCULIS dont nous constaterons la présence sur
un superbe fourreau du même caractère, du même temps, de la même matière,
placé dans une vitrine de notre Musée d'Artillerie. Nous le reproduisons ici en
face du fourreau de l'Épée de César; sur cette dernière l'artiste a écrit opvs. HERC.
sur celle du Musée d'Artillerie il grave enfin
son nom tout entier.
En associant le nom d'un grand peintre
comme le Pinturicchio à celui d'Hercule
le graveur encore anonyme, je ne veux
point préjuger ici la question d'attribution,
et ne vais pas jusqu'à prétendre que c'est
le Pinturicchio qui a fourni au graveur le
carton de l'épée; mais on a constaté que
cet artiste, cher à Alexandre, devint peintre
ordinaire de César Borgia, qu'il fut son
pensionnaire, et ne renonça à son service
que pour exécuter sa grande œuvre, la décoration de la bibliothèque de Sienne. Une
longue contemplation des monuments, des
investigations multiples, et la constatation d'analogies indéniables dont le lecteur
sera le juge, nous révèlent ici une pensée directrice, pensée une, que ceux qui
exécutent ne font que traduireet interpréter. Si les artistes de la Renaissance ont,
pour la plupart, pratiqué indifféremment tous les arts, et sous le nom d'aurefici,
furent tour à tour peintres, sculpteurs, architectes et orfèvres, en thèse générale
les arts mineurs restent plus souvent une spécialité; les listes et les statuts des
corporations en offrent la preuve. Cependant il y a des exemples de grandes per
sonnalités de la peinture ou de la sculpture qui se sont plu parfois à faire une
excusion hors de leur domaine habituel¹.
1. Ces exemples surabondent, mais pour parler de notre temps, si par hasard on perdait un jour la
notion exacte de ce que fut le peintre espagnol Fortuny, les critiques de l'avenir se trouveraient fort
embarrassés pour attribuer avec sécurité la belle épée que ce peintre exécuta à Rome, pratiquant tour
à tour tous les procédés de l'art de l'armurier. L'œuvre est hors ligne ; elle a figuré à sa vente et a été
décrite par le baron Davilliers et par M. Édouard de Beaumont. On trouverait aussi des repoussés, des
nielles, des pièces de céramique, des émaux et des cuivres ajourés exécutés par ce jeune artiste pendant
son séjour à Grenade, en collaboration parfois avec son ami Tapiro. On peut consulter à ce sujet notre
étude « FORTUNY » .
― Paris, 1885.
Si le graveur de l'épée de Borgia reste
un spécialiste, il a dû cependant connaître l'art du modelage, car on remarquera
qu'ayant déjà sa signature sur la lame de l'Épée de César, nous la trouvons plus
complète sur le fourreau de l'épée du Musée d'Artillerie, œuvre en cuir bouilli
repoussé, qui est plutôt le travail d'un sculpteur que celui d'un graveur, ainsi que
dans un grand nombre d'œuvres de ce même Hercule, la plupart des compositions que nous opposerons à celles qui décorent la lame de César sont confuses,
mal équilibrées, tumultueuses ; tandis que dans celle qui reste son chef-d'œuvre,
il se montre contenu, pondéré, il oppose ses groupes l'un à l'autre d'une façon
symétrique, et fait pyramider au centre son sujet principal, comme s'il voulait
rester fidèle au système naïf des primitifs. Nous sommes donc en droit de croire
qu'en travaillant pour le fils d'Alexandre, le graveurHercule était contenu par la
discipline imposée par un maître et ne faisait que traduire la pensée d'un autre;
ce qui revient à dire qu'il y avait un projet dessiné, sinon un carton formel de
l'épée, inspiré ou par César, ou par un de ses familiers, et dessiné par un artiste
à sa dévotion ou sous sa direction. Etjusqu'au bout de notre travail, après bien
des réflexions , des comparaisons de toutes les œuvres connues avec celle que
nous étudions ici, nous persisterons dans cette conviction dont nous pourrions
donner des preuves.
LE GRAVEUR- SA PERSONNALITÉ. SON CARACTÈRE.- Quel est donc,
parmi les plus habiles graveurs du temps, cet « Hercule » qui réclame
si bruyamment le mérite de son œuvre, et crie son nom à lapostérité.
Hercule est un nom banal, c'est la première fois que nous le lisons sur la lame
d'une épée, sur une targe, un bouclier ou une armure. Essayons de constituer la
personnalité de l'artiste, et cherchons dans les cabinets et collections d'armes de
l'Europe, quelques-unes des œuvres auxquelles il a dû l'honneur d'être choisi
par César Borgia. Comment admettre que la lame du Valentinois puisse être
unique ? Il y aura bien sans doute dans quelques cabinets d'armes, les Armerie,
arsenaux d'artillerie et musées de l'Europe, éparses çà et là, quelques autres
œuvres du même maître reconnaissables au caractère de son dessin, et empreint
de ce maniérisme bizarre qui les dénonce à première vue. Peut-être un jour,
sur une de ces œuvres, trouverons-nous une signature complète qui aura pour
nous la valeur d'un document d'état civil.
1.
Depuis le jour où nous avons publié l'esquisse de ce travail dans la Gazette archéologique et
dans les Lettres et les Arts, un document définitif nous a livré le secret du nom d'Hercule. Circonstance piquante, ce document est dû à une très âpre critique suscitée par notre premier travail et destinée à nous confondre, tandis que son résultat immédiat a été de faire de nos hypothèses des vérités
éclatantes. Mais la critique a eu raison sur un point:
le document trouvé par M. Müntz, qu'il
nous avait si obligeamment communiqué, sur lequel nous nous sommes d'abord appuyé pour ajouter
au nom d'Hercule le nom de sa ville d'origine Hercule de Pesaro, ne se rapportait point à notre
Hercule.
L'épée de César Borgia, actuellement aux mains
du duc de Sermoneta est le chef-d'œuvre de ce maître; on va voir, par des comparaisons avec ses autres travaux, combien il y est supérieur.
INTERPRÉTATION DES GRAVURES.
― Nous avons montré, dans le glaive
de César, l'objet d'art relevé par une illustre origine; étudier de près
les inscriptions et commenter les compositions et les symboles dont la
lame est ornée, c'est écrire une page de l'histoire de Rome au moyen âge et dire
un épisode de la vie de Borgia. Nous ne poussons pas l'illusion au point de
croire qu'on peut pénétrer sûrement la pensée des artistes du xv° siècle italien ;
à la fois naïfs et subtils, ils reflètent souvent des idées dont nous avons perdu le
sens ; parfois aussi ils se sont plu à poser à la postérité de malins problèmes
dont la solution est plus souvent le fait du hasard que le juste fruit de la sagacité ; mais si on se pénètre bien des circonstances et des conditions de la vie du
fils d'Alexandre VI, on peut chercher dans les faits de sa carrière et dans les
tendances de son caractère, le sens caché d'allusions et d'allégories qu'il a dû
certainement inspirer ou qui, tout au moins, étaient faites pour flatter ses penchants.
L'exécution de l'arme justifiée par ce
rapprochement, montrons quel point de contact l'histoire nous offre
entre les possesseurs actuels , les Gaetani, le pape Alexandre et
César Borgia.
1.
Voici les termes de ce curieux passage où Jules II découvre Alexandre VI : « ... Cupiditate inor
dinata et immoderata suos etiam aliena jactura postposita ditandi et locupletandi... inique et immaniter
decreta... per allusionem dolum et fraudem. » Voir pour la bulle, l'en-tête du chapitre, que le duc de
Sermoneta a bien voulu faire photographier pour illustrer notre travail.
On comprend maintenant, qu'à trois siècles de distance, quand un Gaetani,
prélat romain, lettré, habitué aux enseignements de l'histoire, brillant orateur
sacré doublé d'un archéologue, vit pour la première fois, aux mains de l'abbé
Galiani, le glaive de celui qui s'était fait, au détriment des siens, l'exécuteur des
hautes-œuvres d'Alexandre VI, il ait poursuivi avec énergie l'idée d'en devenir
le possesseur. L'épée du Valentinois rappelait aux siens l'abus de la force; la possession du trophée symboliserait la lutte, la revanche et le triomphe définitif du
droit. Nous avons vu qu'à partir de ce moment, Onorato Gaetani poussa le chef
de la famille à acquérir l'arme de Borgia, pour la placer, avec une inscription,
dans le château fort de Sermoneta jadis assiégé par César et que les Borgia lui
avaient enlevé, s'appropriant jusqu'au titre auquel donnait droit l'apanage.
Personne encore n'a
commenté ces emblèmes ;
M. Ademollo, le galianiste
fervent sans lequel nous
n'aurions jamais su de l'épée de Borgia que ce que
Galiani en ditdans sa
correspondance avec Mmo d'Épinay, ayant rencontré inopinément le sujet en écrivant : ( La famiglia e
l'Eredita dell' abbate Galiani » , nous espérions voir
l'écrivain tenter une interprétation qu'il était certainement à même de nous
donner; mais il a cru devoir se borner à une description circonstanciée de
la lame, et s'est nettement
et trop modestement récusé. « Un jour ou l'autre, dit-il, viendra quelque artiste ou quelque érudit qui
prendra à tâche de décrire et réussira à interpréter les emblèmes et les figures,
ce que je ne puis faire ni bien ni mal (Nè alla meglio nè alla peggio). Tout ce
que je puis tenter, c'est une sèche description « secca, secca, » une vraie page
d'inventaire. »
1.
Cette pyramide et celle de Cestius,à la porta San-Paolo, font partie de l'iconographiede saint
Pierre, évèque de Rome. Le saint aurait été décapité entre ces deux monuments. Giotto à la sacristie
de Saint-Pierre, Cimabüe à Assise, et le Pinturicchio aux appartements Borgia, l'ont représentée. Ce
dernier l'a mise en œuvre dans sa glorification du bœuf d'Apis, et, circonstance singulière, le graveur
Hercule, à notre connaissance, l'a représentée sur la lame d'une dizaine de ces épées courtes vulgairementappelées « langues de bœuf. »
Nous sommes ici en plein
paganisme, la tradition antique est ressuscitée ; comme au temps des César on
applique aux Borgia, représentés par le bœuf de leur écusson, les épithètes
réservées à la divinité. Ici la victime est pantelante au pied de l'autel; le réchaud,
le gril, la cassolette, sont sur le sol ; les canéphores occupent la droite de la
composition, à gauche la prétresse nue brûle les parfums, le sacrifice va s'accomplir. Borgia est divinisé, là encore nous nous sentons dans l'atmosphère créée
par Hieronimus Porcius qui s'écrie dans ses vers :
Regnat Alexander; ille vir. Iste Deus
Nous avons interprété plus haut les lettres du monogramme de César,
encadrées dans les beaux feuillages qui s'enroulent autour du bœuf Borgia, elles
remplissent le champ qui sépare le Sacrifice de la représentation du Passage du
Rubicon, et sont la marque personnelle du fils d'Alexandre, l'indice de sa possession. On verra que, par trois fois, le même monogramme se trouve répété sur le
fourreau du South-Kensington.
Le texte de l'inscription JACTA. EST. ALEA., ainsi que nous l'avons fait observer
a été interverti pour la symétrie
de l'ornementation. Nous voyons
que cette citation, à la fin du
xv° siècle, étaitdéjàusuelle et s'employait dans toute circonstance
hautement décisive. Les manuscrits de Suétone abondent dans
les bibliothèques fondées à partir
de la moitié du xv° siècle, et la
personnalitéduCésarromainavait
vivement frappéles tyransitaliens
quicopiaient volontiers leconquérant du monde; son image fut
donc multipliée à l'infini. Borgia,
qui voulait voir un heureux présage dans le nom qu'il avait reçu,
avait pris le héros pour modèle,
plusloin il célébrera le « Triomphe deCésar », ici lareprésentation du faitdécisifde
la vie politique du maître du monde n'étaitprobablement pas choisie sans arrièrepensée. Nous n'irons pas jusqu'à voir là une allusion à l'obstacle que le cardinal
de Valence allait bientôt franchir, en brisant avec effraction les liens qui l'attachaient à l'Église pour ceindre l'épée, et, par l'épée arriver au trône ; ces allusions
étant assez directes pour qu'on ne force point le sens qu'elles peuvent présenter.
Il est singulier toutefois de trouver, gravé sur l'épée de César, encore cardinal,
et dès 1498, le Passage duRubicon, alors qu'en 1501, devenu duc des Romagnes,
ayant déjà pris pour sa devise Aut Cæsar aut nihil, après avoir passé ce même
fleuve à latête de ses troupes, Borgia est venu camper sur la place d'Ariminium,
au lieu même où l'adversaire de Pompée avait harangué ses cohortes avant de
marcher sur Rome. Tous ceux qui ont visitéla ville des Malatesta, ont lu sur la
stèle antique qui se dresse au centre de la grande place du Blé (l'ancien forum),
l'inscription commémorative du passage du héros romain : c. CAESAR. DICT. RVBICONE. SVPERATO. CIVILI. BEL. COMMILIT. SVOS. HIC. IN. FORO. ADLOCVT¹.
1.
Il faut voir dans ce curieux monument de Rimini une de ces restitutions qu'aimaient à faire les
humanistes du xve siècle italien. L'inscription est gravée sur une stèle funéraire, évidemment trouvée
à Rimini même. Le choix seul d'une pierre funéraire éloigne l'idée d'une origine antique; il est contraire à l'esprit des Romains ; superstitieux comme ils étaient, les soldats de César auraient vu là un
fâcheux présage. Les souvenirs des grands faits de l'antiquité plaisaient à Sigismond Malatesta qui,
vers 1450, avait fait de sa cour une petite Athènes ; il y a bien des chances pour qu'on doive l'érection
à quelqu'un de ces personnages de la cour littéraire de l'amant d'Isotta, que nous avons tenté de faire
revivre¹. Les archéologues de la région n'ont pas résolu la question; la matière du monument est
antique dans sa partie supérieure, cela n'est pas douteux, mais une inscription, datée 1560, indique que
le piédestal étant ruiné, les Édiles le restaurèrent à cette époque. Un siècle et plus avait pu suffire
pour nécessiter cette restauration. Selon nous, le monument devrait dater du temps de l'Alberti, de
Roberto Valturio, de Matteo da Pasti, et de Matteo Nuti et autres familiers de Sigismond, c'est-à-dire
de 1450 à peu près.
Le monument n'est pas antique, on l'a attribué à l'initiative du fils d'Alexandre VI, mais
on trouve dans Broglio, le chroniqueur classique du xv° siècle à Rimini, la preuve
qu'il existait déjà de son temps. Il y fait allusion dans son récit des fêtes célébrées
pour le mariage de Robert Malatesta, fils de Sigismond, avec la fille du duc
d'Urbin ; dans son langage ingénu, le chroniqueur le désigne ainsi : El petrone
nel quale Cesare monti a fare la diceria. On remarquera la pensée idyllique
qu'exprime le graveur quand, à la gauche de sa composition d'un caractère
antique il assied sur la rive du Rubicon un pasteur qui joue de la flûte.
Le Triomphe de Cesar,
avec l'inscription BENEMERENT , ouvre la série des
compositions qui figurent
sur l'autre face de la lame.
Sur un fond d'architecture
qui symbolise une ville, au
milieu des clameurs d'un
peuple, escorté de licteurs,
de porte-étendards aux armes de laville de Rome, S. P. Q. R., César, en guerrier romain, la tête couronnée
de lauriers, tenant à la main une branche d'olivier, passe triomphant sur son
char. On lit sur la sedia: D. CES. Divus Cesar. Il est difficile de ne pas reconnaître,
dans le monument qui occupe tout le centre de lacomposition, la tour penchée
de Pise, avec son degré exact d'inclinaison. Elle est évidemment rendue d'une
façon symbolique, elle est même couverte d'une sorte de dôme et couronnée
d'une boule sur laquelle se dresse un drapeau, ce qui peut dérouter l'interprétation ; mais l'artiste chargé de la représenter ne l'a peut-être jamais vue ; la tour
carrée (une garisánda) qui se dresse à côté d'elle est certainement aussi destinée
à symboliser un horizon défini et, comme tel, rapprochée du monument principal.
On peut voir dansle choixde lavillede Pise donnée pour fond au Triomphe de
Césarun pointdecontact aveclesfaits de sa vieetune allusion transparente. On n'a
pas de preuve absolue de la présence de César à Rome pendantsa toute première
enfance (qu'il aprobablementpassée chez sa mère, la Vanozza, puis quand celle-ci
eût épousé Della Croce, chez Adriana Mila, parente et confidente du pape
Alexandre VI), mais à partir de l'âge de douze ans on ne le perdra plus de vue.
Né en 1476, en 1488 il est sur les bancs de la Sapienza de Pérouse ; nous en avons
la preuve dans la préface de la Syllabica de Paolo Pompilio,traité des règles de
la versification, imprimé à Rome en 1488 et qui lui est dédié par le poète. César
a douze ans ; il est déjà inscrit sur la liste des protonotaires apostoliques par Innocent VIII, qui a accordé cette faveur au fils du cardinal Rodrigo Borgia. Nous
savons ce que valent au xv° siècle, les éloges des poètes et leurs pompeuses dédicaces, pour César surtout, car à chaque panégyriste qui l'exalte, on peut opposer
un pamphlétaire qui l'outrage ; mais il est probable pourtant que Borgia fut un
lettré puisqu'on peut lui dire en face qu'il seplaît à l'étude des rythmes poétiques
et que c'est une raison de lui dédier le Traité des règles de la versification. « Docemus in hoc libro quemadmodum carmenfieripossit, omnibus angulis rei syllabicæ
exploratis et patefactis. Quod esse tibi jucundissimum me profecto nonfugit. »
Ce passage de la préface n'est pas indifférent en présence des inscriptions latines
gravées sur le monument qui nous occupe. A la Sapienza de Pérouse, César étudiait le droit ; en 1491, à Pise, à l'Université, il continue les mêmes études sous
le fameux Filippo Decio. C'est même au moment précis où il passe ses examens,
que le fils d'Alexandre VI apprend, chez les Pisans, l'élévation de son père au
pontificat. Le séjour à Pise était donc pour César une époque mémorable ; Paul
Jove, son ennemi, dans la Vie de Gonzalve de Cordoue, fait une allusion à la façon
brillante dont le jeune évêque de Valence subit alors ses épreuves ¹ .
1.- « Adoque profecit ingenio propositis in utroque jure quæstionibus erudite disputaret ». (Elogia
virorum illustrium).
Voilà pour l'allusion à Pise ; mais une circonstance bien singulière pourrait
donner un sens précis à cette représentation du Triomphe de César. Borgia, il
n'y aplus à en douter, a toujours les yeux fixés sur le héros antique; de son propre
temps on le représente dans l'attitude du conquérant ; il suffit d'ouvrir les devises
de Paul Jove et les Symbolica Heroica, du chanoine Paradin (qui s'est inspiré
de l'évêque de Nocera), pour s'en convaincre. Là, sous la représentation d'un
César antique tenant le globe du monde, on lit le nom de César Borgia et sa
devise : Aut Cesar, aut nihil. Sous Néron, il y avait un acteur « artifex » ; sous
le fils d'Alexandre, fils d'un valencien, il y a une « spada » et un « ballerino ».
Il aime les fêtes ; partout où il domine, dès qu'il entre, il ouvre un cirque, fonde
des jeux et consent même à guider les danses : Ipse choreas duxit, dit le Diaro
Cesenate de Braschio. A Ferrare, lejour des noces de Lucrèce, il abandonne le
siège d'une ville, arrive la nuit à la cour de son beau-frère, franchit le cercle des
invités, et, masqué, salue l'assistance et fait des passes en solo. Qui peut deviner,
sous le masque, la présence du capitaine général du Saint-Siège ? Cependant son
élégance le trahit, c'est César, l'unico Cesare ! exactement comme on dit en
Italie la Diva ! Mais quelquefois aussi, avec le secours des poètes et des lettrés,
César organise des spectacles pompeux, si à la mode alors, dont le Politien et
Laurent le Magnifique avaient donné le goût, etdontil nous reste des traces dans
les Feste e Trionfi.
Enfin, dernier rapprochement véritablement piquant et attesté encore par les
documents, dans lalistedes objets précieux qui composaient les bagages de César
et ses richesses, contenus dans les caisses séquestrées par Jules II en 1503, lors
de la fuite de César Borgia à Naples (caisses confiées par ce dernier à Ramolini,
un de ses familiers, soustraites à
la vigilance des agents du pontife,
mises en dépôt chez Bentivoglio,
et à lui réclamées par Jules II dans
une lettre en date du 10 juin 1504
que je rencontre aux archives de
Bologne), on trouve la mention
d'une chlamyde antique et d'un
casque, qui ne pouvaient être
autres que ceux qui servirent à
César le jour où il se donna en
spectacle au peuple romain ¹.
1.-- Voir la chronique manuscrite de Fileno : « Brève description des objets retenus par Bentivoglio
et rendus plus tard à Hercule d'Este » . Il est singulier de voir que Bentivoglio, dans la lettre à Jules II,
du 24juin 1504, en réponse à sa demande de séquestre, nie avoir rien reçu de César. On se demande quel
intérêt il pouvait avoir, en 1504, à ménager celui qui avait voulu le chasser de Bologne ; ces documents
aux archives de Bologne étaient encore inédits : nous les avons publiés dans notre ouvrage : « César
Borgia.
Sa vie.
Sa captivité.
Samort. »-J. Rothschild, éditeur.
Les trois dernières compositions semblent destinées à exprimerl'idéepacifiquequidécoule naturellementdecelle du Triomphe.
Dans un champ ovale, entouré de
beaux rinceaux de feuillages où
se joue le bœuf de l'écusson des Borgia, « deux génies ailés tiennent le caducée ». La discorde est étouffée; le héros triomphe, la paix règne dans le
royaume, et la prospérité publique en est le prix. Felicitas publica,
Augusta,
Felicitas
Florente Fortuna, telles sont les légendes qu'on lit d'ordinaire sous
un symbole de même forme emprunté à la numismatique antique, et dont on
voit surtout de nombreux exemples dans les médailles de Galba. La corne
d'abondance, le caducée, les trophées, empruntés aux frises des arcs de triomphe
des romains et aux médailles, sont depuis longtemps déjà des formules courantes.
Dans les Légations, tous les monuments d'utilitépublique dus à la munificence
des pontifes reproduisent ce motif d'ornementation, devenu banal, et qui n'est
rehaussé que par le goût des artistes qui l'emploient.
L'exécution du fourreau de
l'épée de César est si supérieure qu'on a cru jusqu'ici que l'auteur
des gravures de la lame ne pouvait pas être l'auteur de la composition
et des sculptures qui le décorent. Ainsi s'explique que, malgré la signature
gravée en grands caractères sur le métal : OPVS. HERC., qui désigne avec évidence
le nom de l'artiste, on ait eu la pensée, dans le catalogue de South-Kensington,
d'attribuer le fourreau à Antonio Pollaiuolo. Nous avons produit déjà la partie
essentielle du document qui prouve que cuir et métal sortent des mêmes mains,
et que ces mains sont celles du maître d'Hercule; la perfection des procédés
employés ici nous permet de mettre les monuments eux-mêmes sous les yeux
des lecteurs, sans qu'aucun interprète ait pu, en en dénaturant le caractère, les
rendre suspects et entacher nos conclusions définitives.
Le caractère dominant des
œuvres qu'on peut attribuer à ce maître Hercule, le graveur de Borgia,
que nous pouvons désormais reconnaître pour l'artiste auquel on doit
l'Épée de César et son fourreau, étant désormais bien défini dans son esprit et
dans l'ordre d'idées dans lesquelles il se meut, définissons sa manière habituelle, ses formes de prédilection, ses manies de burin, afin qu'on puisse à
jamais le reconnaître en le voyant passer; serrons-le enfin de plus près, sinon
comme homme, du moins comme artiste et groupons le plus grand nombre
possible de ses œuvres.
Qu'il se manifeste par le crayon, le poinçon ou l'ébauchoir, prêt à graver sur
le métal ou à sculpter le modèle d'un fourreau, Hercule, épris de l'antique, représente toujours ses personnages nus ou vêtus de draperies légères. Son geste est
excessif, ses divinités, ses nymphes, ses vestales , ses Renommées sont d'une
anatomie particulière ; il exagère la longueur des membres, les brise aux attaches,
leur donne des poses étranges et contournées, enfin, singulière circonstance, dans
le siècle classique par excellence, il fait penser aux Décadents, au Primaticio,
au Rosso, à Niccolo del Abbate et àl'école de Fontainebleau. Hercule aime les
fonds d'architecture, les horizons de ville, et détache souvent ses personnages sur
des perspectives de monuments. S'il fait un ciel, les nuages, qu'il amoncelle par
petits groupes sont comme déchiquetés, et de forme bizarre; ses terrains sont
indiqués comme des pavements de voies antiques et il coupe ses horizons de
larges tailles ou hachures, tracées d'un poinçon libre et rapide. Il a le goût des
devises latines (qu'il prend Dieu sait où, car la plupart du temps il les tronque et
les défigure) ; mais il a des traits plus particuliers encore, des habitudes d'esprit et
des habitudes de main, et tout un monde d'accessoires quilui sont familiers. Ses
vases de sacrifice, qu'il dépose sur le sol, toujours de même forme, sont copiés
sur des bas-reliefs antiques, comme ses cassolettes, ses cuves, ses lacrymatoires ;
il multiplie les Gorgones, les trophées antiques ; il affectionne la pyramide de
Cestius chère au Pinturicchio, qui fait partie de l'iconographie de Saint-Pierre,
et on la retrouve si souvent dans ses œuvres qu'elle est pour ainsi dire la signa
ture à laquelle on le reconnaît. Il a emprunté aux grands artistes qui l'ont pré
cédé, aux peintres des triomphes de Pétrarque, leurs allusions et leurs symboles ;
la licorne reparaît souvent dans ses compositions et l'arc d'argent de Dianebrille
souvent dans ses ciels. Son architecture aussi le dénonce; il fait grand, il a dû
voir la Rome antique et traverser Pise à une époque où la tour penchée avait reçu
un appendice en forme de dôme, à moins que, n'ayant jamais connu la vieille
cité pisane, ni vu de représentation exacte du monument qu'il reproduit si sou
vent dans ses compositions, il ait créé par l'imagination une tour penchée à son
usage. Hercule, dont le nombre d'œuvres doit être considérable, puisqu'il a
rempli l'Italie de ses travaux, a dû tenir bottega et faire de nombreux élèves; il
n'a pas apporté une grande variété dans son œuvre : il se répète plutôt dans ses
compositions et, à moins qu'il ne travaille pour un grand prince, il lâche son
exécution, se copie lui-même et il lui arrive d'entasser une foule de figures sur
un fond sans en définir la fonction ni trahir le but. Mais en tout ceci, comme il
s'agit de travail d'art industriel, il faut considérer le prix qu'on met à la marchandise, et faire la part des élèves; il va sans dire aussi que chacun est servi
suivant sa générosité et son goût. Hercule affectionne encore certaines silhouettes
qui pourraient bien ne pas lui appartenir car il en emprunte quelques-unes aux
plafonds du Pinturicchio des appartements Borgia. A cent lieues de distance,
nous voyons passer les mêmes femmes nues portant sur la tête le vase où fume
l'encens du sacrifice, figures charmantes, empruntées peut-être aussi aux basreliefs antiques, mais dont il brise les attaches à sa façon et que nous retrouverons dans des dessins à la sanguine du Musée de Berlin, dessins que nous regardons comme des cartons et modèles pour des gravures de lames.
Les amateurs comprendront qu'une fois l'attention fixée sur l'épée de César, prise pour type, étudiée dans son esprit
et dans sa forme jusque dans les plus minimes détails où se trahit
parfois l'individualité de l'auteur, tous les spécimens qui, en outre du caractère
général de l'époque, révélaient les mêmes tendances et accusaient les mêmes
habitudes d'esprit et de la main, devaient vite attirer les regards et dénoncer
le maître. Nous avons donc ouvert une vaste enquête dans toute l'Europe et
nous sommes à méme, non point d'établir le catalogue complet des œuvres du
maître Hercule, mais de fournir des éléments déjà nombreux au spécialiste qui
voudra l'entreprendre ¹.
1.-A peine avions-nous publié l'esquisse de ce travail et signalé les traits et signes particuliers qui
distinguent le maître, M. Courajod, à Rome, M. W. Bode à Berlin et à Pesth, M. Molinier à Tours,
signalaient des lames gravées du maître, et pouvaient, avec sécurité, par des rapprochements avec les
représentations que nous avons publiées, reconnaître sa main dans nombre de pièces importantes. C'est
ainsi que nous signalions autrefois à Édouard de Beaumont son épée Louis XII qu'il devait léguer au
Musée de Cluny, et que tout récemment M. Molinierfaisait entrer au Louvre l'épée courte de François
Gonzague, marquis de Mantoue.
Jusqu'à nouvelle information, Paris compte
dans ses collections publiques et privées un certain nombre d'armes du
maître Hercule, parmi lesquelles nous signalons au premier rang
Tépée Vénitienne à lame gravée sur fond d'or de M. Ressman, ministre plénipotentiaire d'Italie, dont nous publions une des compositions que nous devons
à l'éditeur, M. Lévy. Cette arme, montée à Venise dans le goût oriental,
a été trouvée à Versailles et apportée d'Italie au temps des guerres du premier
Empire. C'est une œuvre d'un haut intérêt et du plus beau style. L'autre épée,
venue au Musée de Cluny par suite du legs du peintre Édouard de Beaumont,
connaisseur émérite, avait été trouvée par M. Spitzer, le grand collectionneur :
elle rappelle par sa forme générale celle de César, mais elle n'est ornée que d'une
seule composition gravée sur chaque face.
1.- Le vrai nom de l'épée courte à large lame,à la vénitienne,est Cinque-dea; cependant l'habitude
a prévalu en raison de la forme de la lame, de nommer ces armes « langues de bœuf ». Les spécialistes
protestent avec raison contre ceux qui appliquent ce dernier nom aux cinque-dea, car l'arme dite langue
de bœuf, arme d'hast, existait auparavant et diffère de forme de la cinque-dea. Les vieux dictionnaires
français, Duez, Roquefort et Rabelais traduisent Sangdedez, et les glossaires italiens, chroniques manuscrites et livres antérieurs au xvm° siècle, disent tous Cinque-dea ou Cinquedita pour désigner l'épée
courte, large de cinq doigts ; M. Édouard de Beaumont, dans ses beaux catalogues illustrés par le graveur Jacquemart, n'emploie pas d'autre expression et proteste énergiquement contre la dénomination
langue de bœuf. Nous sommes obligé de nous conformer à l'ancien usage, suivi d'ailleurs par les directeurs d'arsenaux, musées et collections .
Nous reviendrons sur cette
lame parce qu'elle joue un rôle lorsqu'il s'agit de prouver l'identité du maître
Hercule et ses relations avec Mantoue et Ferrare.
Le Musée d'artillerie de Paris, dans la même vitrine, nous montre une cinque-dea à lame gravée sur fond d'or, œuvre de premier ordre, avec son fourreau de cuir repoussé,sculpté par le maître Hercule.A côté, un autre fourreau
sans la lame, du goût le plus élevé, est la première œuvre qui nous ait montré
l'inscription OPVS. HERCVLIS (Voir plus haut les reproductions de ces deux
fourreaux.)
La tour de Londres possède la plus belle
des épées courtes sortie des ateliers d'Hercule, encore que la lame ne
soit pas gravée sur fond d'or; les compositions sont nombreuses et
importantes, l'ordonnance générale est très belle, les riches architectures et les
inscriptions en font une œuvre importante. Il est à regretter que l'arme soit
très usée, il nous a fallu l'étudier à la loupe et grandir les images pour les restituer. (Voir l'eau-forte.)
La Collection d'armes Hertford-House (chez Sir Richard Wallace) ne compte
pas moins de cinq lames du maître, dont l'une représente un sacrifice au
bœuf Apis ou au bœuf Borgia. Ces cinq lames proviennent de la fameuse
collection Meyrik et de celles du comte de Nieuwerkerke.
L'Arsenal de Vienne et la collection Ambras possédent deux beaux spécimens du maître; une épée, la
quatrième que nous connaissions en Europe, et une cinque-dea
d'une belle ampleur.
La Collection privée de Mlle Prizbram contient aussi une cinque-dea
provenant de la collection du comte Keglevich; la lame est dorée, les compositions
abondenten motifs architectoniques, lagarde estenrichie de nielles, etchaque côté
du pommeau en argent ciselé porte les armes des Sanvitali de Parme.-Cette
lame nous a été signalée par M. Wilhelm Bode de Berlin.
M. J. Hampel, conservateur du Musée national
Hongrois nous a signalé l'existence de deux cinque-dea que M. Pulsky
a publiées dans l'Indicateur Archéologique (vol. 11 , 1882, p. 240-242).
Ces œuvres sont un peu lâchées de compositions, mais l'une d'elles a l'avantage
de nous montrer la figure, si caractéristique du maître, qui, dans le sacrifice au
bœuf Borgia de la lame de César, porte sur la tête le vase des sacrifices.
Le Musée national d'armes a reçu en héritage
du prince Frédéric-Charles trois cinque-dea du type que nous recherchons, et, ce qui est une bonne fortune pour nous, sur l'une d'elles,
l'artiste, outre qu'il répète ici cette tour penchée de Pise, qui figure déjà dans le
triomphe de César gravé sur son épée et qui équivaut pour nous à une signature,
nous montre pour la première fois, non plus son nom de baptême, mais bien
son nom de famille FIDELI, nom qui nous échappait jusqu'à présent et dont
l'authenticité sera attestée plus loin par des preuves irrécusables. Un autre détail
caractérise deux de ces lames : elles portent des inscriptions allemandes et
montrent que le grand orfèvre italien travaillait pour la cour de l'Empereur
au temps de Maximilien.
ROME possède l'arme type, l'épée de César
Borgia (au palais Gaetani) , dont on sait désormais l'histoire, et
BOLOGNE, dans le Museo Civico, garde trois cinque-dea gravées sur
fond d'or, toutes les trois aux armes de la famille Bentivoglio, c'est-à-dire avec
la scie gravée sur la poignée. Ce sont les premières œuvres du maître que nous
ayions rencontrées en Italie au début de notre enquête; elles ont été livrées à
notre observation par M. Frati, l'érudit conservateur du Museo Civico; et
quoique n'offrant que des séries de figures détachées dans les cannelures, elles
sont bien caractérisées.
Le Musée Impérial de TSARSKOÉ-CÉLO, par
suite de l'achat de la collection Basilewski, s'est enrichi d'un spécimen
de l'œuvre d'Hercule, une lame dépourvue de sapoignée, très effacée,
mais qui devait être fort riche de composition; la gaine, en cuir repoussé, peut
figurer à côté des deux fourreaux de notre Musée d'artillerie de Paris. Une
autre cinque-dea, offerte par M. Narischkine à l'empereur Alexandre II, a été
gravée dans le grand ouvrage de Kemmerer LeMuséeImpérialde Tsarskoé-Célo.
Il nous faudrait signaler encore une lame qui a passé envente à Rome en 1886
(5 avril), à la vente Alberici¹, une autre enfin était naguères chez M. Stefano
Bardini, à Florence, et une dernière est encore à Venise, au palais Balbi, chez
M. Guggenheim.
1.- M. Courajod qui l'avait vue à Rome a bien voulu nous la décrire : Épée dite langue de bœuf; au
tiers de la lame des sujets mythologiques gravés auburin et dorés ; la traverse ciselée a la forme d'un
croissant recourbé vers la lame. La poignée en os est ornée de quatre rosaces en bronze à claire-voie et
porte sur les côtés l'inscription: Auxilium a super... præbent victoriam.
— Ces diverses armes ont été signalées à notre attention par
l'honorable conservateur du Musée de Berlin, W. Bode.
Hors l'Espagne, la Hollande, la Suède et la Norwège,où nous avons poursuivi
notre enquête sans résultat, mais où nous ne doutons point qu'il ne se cache en
quelque collection discrète des spécimens qu'on pourrait joindre à ceux dont
nous avons signalé l'existence, on voit qu'un certain nombre de grandes villes
d'Europe possèdent des œuvres du maître Hercule. On s'étonnera de voir que
l'Armeria de Madrid, si riche par ailleurs, manque au catalogue; mais on sait
que, lors d'un soulèvement populaire, un grand nombre d'armes de
main ont disparu. Bruxelles et les
Flandres auraient dû nous donner
des résultats ; Dresde, Erbach, Munich, Brunswick, Nuremberg, Meiningen, Sigmaringen nous ménageaient aussi des déceptions attestées par lettres personnelles des conservateurs ou des possesseurs des
collections. Combien de bourgs, de
châteaux, de manoirs au fond des provinces lointaines, qui, malgré nos investigations répétées, doivent encore garder leur secret! On reconnaîtra d'ailleurs que
les œuvres antérieures au xvi° siècle, quand elles ont un caractère précieux par
le travail ou la matière, sont rares, même dans les arsenaux et collections d'État.
Quoique nous ne donnions ici que quelques éléments, une sorte d'essai de
catalogue des œuvres du maître Hercule, les trente àtrente-cinq pièces qui composent notre dossier suffisent à le bien caractériser. L'artiste gravait des lames
d'épées , presque toujours sur fond d'or, et sculptait les gaines en cuir repoussé ;
par conséquent, il joignait à sa qualité de graveur le talent d'un habile modeleur.
Ces lames étaient souvent marquées d'une tour (marque des épées offertes par
le pape Alexandre VI aux divers souverains de son temps entr'autres de celle
du stocco de Bogislaw au Musée Hohenzollern à Monbijou de Berlin). Parfois,
cependant, Hercule enrichissait de ses compositions des épées marquées d'un
autre signe; on lui confiait des armes de toutes provenances etil exerçait saverve
sur le métal du premier armurier venu. Le maître était aurifex ; on sait que
sous cette dénomination sont désignés les plus fins génies de la Proto-Renaissance ; il a fait de tout: des bijoux proprement dits, des poignées d'épée, de la
sculpture (car il aproduit une plaquette, celle quidécore le fourreau de Borgia, et
les autres gaines du Musée d'artillerie de Paris, dont l'une est signée de son nom
tout entier, peuvent passer pour de la sculpture ornementale de premier ordre);
nous montrerons enfin quelques-uns de ses dessins qui sont d'un maître. L'enquètea prouvé qu'il s'était fait une spécialité de l'arme appelée cinque-dea et que
sa renomméeavait rayonné audelà des limites de l'Italie, puisque nous l'avons vu
travailler pour l'empereur d'Allemagne. Quatre épées seulement, nous l'avons dit,
figurent dans son œuvre à côté de trente-une lames courtes. C'est pourtant dans
le stocco italien, l'épée d'apparat, du type de celle de César Borgia, qu'il s'est
pleinement révélé; aussi l'a-t-il signée avec jactance, en lettres monumentales.
Les considérations qui vont suivre et les nouvelles confrontations que
nous allons faire sont certainement plus hypothétiques que celles qui
ont précédé; mais, si la démonstration entraînait la conviction du lecteur, le
bagage du maître Hercule deviendrait plus considérable; et, au lieu d'un habile
ouvrier et d'un artiste voué aux Arts industriels, comme on dit aujourd'hui, et aux
Arts mineurs, comme on disait autrefois, nous aurions devant nous un de ces
tempéraments doués de facultés multiples, caractéristiques du temps de la
Renaissance, qui ont cumulé les talents et excellé dans plusieurs branches de
l'art.
Ces dessins que le hasard a fait échouer au Musée de Berlin sont au nombre
de dix ou douze. Le premier d'entre eux nous montre, sur un autel où brûle la
flamme du sacrifice, Vénus et l'Amour, debout sur le couronnement du petit
monument; derrière eux croît un palmier. Adroite du monument, deux personnages entièrement nus, Mars et Mercure, bien caractérisés l'un par le casque et
la hache enforme de hallebarde, l'autre par le caducée et les ailes au talon et au
chef, prennent part au sacrifice. Del'autre côté, deux femmes debout, nues aussi;
la première porte une haste, elle n'a pas d'attribut spécial qui permette de la
reconnaître ; elle active le feu sacré ; la seconde est Minerve sans doute, puisqu'elle
porte le bouclier. Le parallélisme est complet dans la composition; l'autel forme
l'axe, et les deux parties symétriques s'équilibrent jusque dans les accessoires que
portent les personnages. C'est la composition telle que l'entendaient les artistes du
xv° siècle, peintres ou sculpteurs, et on dirait qu'il y a là une réminiscence de
l'antiquité, rajeunieparle goûtpersonnel aux artistes de la Renaissance. Si l'on considère le groupe de Vénus, la forme de ladraperie qui fait berceau au-dessus de sa
tête, la longueur des personnages nus, leur pose, les coiffures hérissées et désordonnées à la façon des Gorgones, la forme bizarre des accessoires, caducée, hallebarde, hastes en forme de vase d'où s'échappent des fleurs, pour les comparer aux
dessins figurés sur les lames gravées par Hercule, il nous semblera bien difficile de ne pas voir là une œuvre du maître. (Voir la planche horstexte, ci-jointe.)
Continuons nos recherches en passant des musées aux archives et voyons si, pour donner
plus de réalité encore à celui dont nous avons rassemblé les œuvres,
nous pourrions faire sortir de la poussière quelques documents ignorés.
Votre Excellence, dans ces derniers temps, m'a commandé des travaux que j'ai commencés
immédiatement et auxquels j'ai donné tous mes soins, désirant grandement satisfaire votre
Excellence et lui faire une belle chose qui lui plaise, je n'ai pas d'autres soucis à l'esprit que
ces travaux, mais j'ai été si occupé d'autres choses urgentes, que je n'ai pu arriver à les livrer, et
MM. Hieronymo Zilliolo et Barone saventbien etvous peuvent dire qu'il n'y a pas là de ma faute ;
la vraie raison de ce retard c'est que j'ai dû satisfaire à qui a le droit de me commander. Quand
une fois j'aurai l'occasion de voir Votre Excellence, je lui ferai comprendre de vive voix comment
cela s'est passé, elle saura que si je n'ai pu faire davantage, c'est que je n'ai que deux mains et
mon fils deux autres !... Que Votre Excellence soit sûre que ni jour ni nuit je n'abandonne la
chose et elle sera servie... Sur le conseil de Votre Seigneurie, j'ai mis mon fils Ferrante à l'œuvre
et je crois qu'il suivra mes traces et que je n'aurai pas à rougir de lui...
Le lendemain 15 octobre, Hieronymo Magnanini, qui est chargé par la princesse de Mantoue de surveiller le travail, écrit de son côté à Isabelle, et il encarte
dans sa lettre celle que nous venons de citer :
Hier, je me suis rendu chez maître Hercule pour voir les bracelets de Votre Seigneurie ;
j'arrivai à l'improviste et je trouvai au travail non seulement le maître, mais encore ses fils ; déjà
l'œuvre commence à prendre figure, le contour est fini, des deux côtés le travail de filigrane est
soudé et les huit tableaux (quadri)¹ étaient là, terminés, devant maître Hercule et devant ses fils,
qui tous travaillaient.
A Hieronymo Zilliolo, notre apprécié et très cher ami.
Nous avons reçu votre lettre en
même temps que les bracelets ; ils sont tellement beaux et d'un travail si supérieur, que nous
oublions les retards de l'orfèvre ; nous louons beaucoup maître Hercule et ses fils de l'œuvre
si élégante sortie de leurs mains, et nous vous louons vous-même de toute la diligence dont
vous avez fait preuve. Quant à notre illustrissime frère, vous lui rendrez des grâces infinies
nous reconnaissons que c'est à lui que nous devons ces bijoux ; sans lui, en effet, sans son autorité et le parti qu'il avait pris de mettre l'artiste en prison dans le Castello, je crois que de sa vie
il n'aurait livré son œuvre² .
2.
Ces façons d'agir sont toutà faitdans le goût du temps ; dans une autre lettreà un artiste, Isabelle
le menace de le faire enfermer dans le Batti-Ponte du Castello de Mantoue s'il persiste à ne pas livrer
le travail commandé.
Quant au prix du travail qu'il demande, véritablement il ne mérite
pas un bolognin de moins que les vingt-cinq ducats3.
3.
Il s'agit ici de la monnaie de Bologne qui a cours dans toute cette région.
Mais comme, ily a des années déjà, nous
lui avons donné d'avance vingt-cinq ducats pour nous faire des boutons d'or qu'il n'a jamais
exécutés, vous pourrez lui dire que l'un compensera l'autre. Cependant, afin qu'il reconnaisse
à quel prix nous estimons son travail et son talent, vous lui donnerez en sus dix ducats, plus
deux autres pour le prix de l'or qu'il prétend lui être redû, ce qui fera douze ducats ; enfin, vous
retiendrez les cinq ducats que vous avez déboursés, et, à cet effet, nous vous envoyons par le
courrier Polidore dix-sept ducats dans une sacoche pour ledit paiement. Quand vous aurez
l'occasion de voir le seigneur duc, vous me recommanderez à son Excellence. Bene valete.
Mantoue, 21 Août 1505.– Isabelle.
Ces lettres lues, examinons dans quel milieu évoluent les personnages : nous
sommes à Mantoue, d'où Isabelle écrit, puis à Ferrare, d'où celui qui signe Hercule Aurifex Illmi Ducis Ferrarie, date sa lettre à la marquise. Or, on n'a pas
oublié que notre dossier contient une arme de choix faite pour Hercule d'Este, seigneur de Ferrare, ou pour Alphonse d'Este, son fils (puisqu'elle porte les armes
de la maison de Ferrare), et si on la recusait comme venant de lui, il sera du
moins absolument impossible de nier que la cinque-dea récemment achetée
par le Musée du Louvre, qui porte les armes et les emblèmes du marquis de
Mantoue, ne soit de la main de celui qui a gravé l'épée de Borgia. Donc il y a
identité entre le graveur de Borgia et le graveur d'Este et celui de Mantoue,
et nous n'avons plus à prouver que l'Hercule, aurifex du duc de Ferrare, est
le même que celui qui a signé OPVS HERCULIS les œuvres primitivement
citées qui leur sont identiques, que celui qui fournit à Isabelle d'Este des bracelets « tellement beaux et tellement supérieurs » qu'elle en oublie ses retards,
grave aussi des épées, travaille avec ses fils, dirige un ateliér, une Bottega, et
a travaillé pour un grand nombre de souverains italiens et étrangers. Mais, de
cet artiste, nous ne savons pas encore le nom de famille.
Nous nous approprierons ici quelques
documents nouveaux publiés parM.Angelo Angeluccidepuis le jouroù
nous avons donné les premiers essais du travail sur le Maître Hercule ;
ils nous serviront à établir que ce graveur, qui s'intitule orfèvre, était originaire
delaprovince de l'Emilie où sa famille habitait Sesso, fraction de la commune de
Reggio. Né vers 1465, dans la religion juive,Hercule s'appelait d'abord Salomone
da Sesso ; venu de bonneheure à Ferrare pour exercer son art, il avait su, par son
habileté, gagner les bonnes grâces du duc Hercule, dont il était devenu l'aurifex¹ .
1. Voir les documents à la suite.
Encore désigné le 21 mars 1491, dans le document n° 2, sous le nom de Salomon
da Seso et qualifié d'Ebreo , on le trouve le 25 novembre de la même année mentionné sous celui de Mastro Erchule da Seso Orevesce. Il a changé à la fois de
nom et de religion, et comme cette circonstance assez imprévue, qui tout d'un
coup fait d'un orfèvre Salomone un maître Hercule demande à être prouvée,
pour s'en convaincre, il faudra jeter les yeux sur la liste des dames et demoiselles d'honneur de Ferrare nommées par le duc Hercule de Ferrare pour
accompagner Lucrèce Borgia qui vient à sa cour épouser Alphonse l'héritier du
trône. Dans cette liste, Eleonora, la fille d'Hercule, est désignée : « La Figliola
che fu d'Hercule Orevesce gia hebreo ». ― Voilà la conversion bien établie. Au
moment oùle ci-devant Salomone entre au service du duc, il avait déjà plusieurs
enfants : l'aîné, Alfonso, qui faisait aussi partie de la suite de Lucrèce, travaillait avec son père comme orfèvre et devait lui succéder dans sa charge. Nous
l'avons montré, dans les lettres que nous avons extraites des archives de Mantoue, assis à l'atelier près du maître Hercule; il apprend son art et donne déjà
des preuves de vaillance. La famille de l'orfèvre était nombreuse : outreAlfonso,
elle comptait deux autres fils, Ercole et Ferrante (ce dernier fait aussi partie de
l'atelier et son nom est cité
dans la lettre ci-dessus), et
trois filles, dont on ne connaît
qu'un seul nom, Eleonora. On
remarquera quetousces noms
sont empruntés à la famille
ducale, ce qui indique un patronage exercé au moment de
la conversion, quiadûse faire
sous les auspices des souverains,-ce qui est de tous les
temps, mais qui l'est plus encore à l'époque du xv° siècle
en Italie. Alfonso l'aîné épousa
Sapuncia; en 1521 , cetAlfonso
ayant abusé delaconfiancede
la marquise de Mantoue, Isabelle d'Este, en engageant des
objets d'orfèvrerie commandés par elle, avait été mis en
prison, et Sapuncia, avec
Eleonora, veuve d'Hercule,
et ses trois filles encore
demoiselles , adressent une supplique à la souveraine afin de faire relâcher le coupable, sous peine de voir eux
et leurs six enfants mourir de faim. La supplique de la veuve, des trois filles
et de la belle-fille du maître Hercule en faveur d'Afonso leur frère, désigne ainsi
le coupable : Alfonso fils du Maître Hercule de Fideli, orfèvre. L'annotateur
du catalogue de Turin, qui a produit ces documents dans un but complètement
opposé à celui quenous poursuivons en nous les appropriant, ajoute une grande
importance à ce dernier parce que, pour la première fois, on y voit apparaître
le nom de famille du maître Hercule, ce cognome, si rare à rencontrer dans les
textes du xv° siècle relatifs aux artistes en Italie, presque toujours désignés par
leur prénom auquel s'ajoute celui de leur père précédé du mot italien de, c'està-dire descendant de.
Sachant désormais qu'il y a eu à Ferrare un Hercule de Fideli orfèvre, si
nous rencontrons sa signature bien clairement exprimée, bien lisible, incontestable, sur une arme gravée, surtout sur une cinque-dea, et si cette signature
s'applique à une série de compositions du même caractère que toutes celles
que nous venons de faire passer sous les yeux du lecteur; le problème de
l'identité comme artiste, d'un individu du nom d'Hercule qui s'appliquait à ce
genre de travaux, qui était aurifex et travailla à la fois pour César Borgia, pour
Ferrare , pour Mantoue, pour Bologne, Parme, Vienne, etc., etc., étant déjà
résolu, le mystère qui enveloppait son nom sera dissipé. Or, cette signature,
nous venons de la produire écrite en toutes lettres, en bonne lumière, au juste
endroit, là où les maîtres se plaisent à signer leurs œuvres quand ils les jugent
dignes d'eux, sur la magnifique lame du Musée de Berlin léguée par le prince
Frédéric-Charles. Elle était dans nos dossiers depuis longtemps, mais la signification du mot Fideli nous échappait ; il a fallu l'attentive lecture des documents
de M. Angelucci pour la reconnaître. FIDELI est le nom de Salomone da Sesso
devenu plus tard, par sa conversion, Ercole da Fideli, orfèvre de l'illustrissime
duc de Ferrare, puisque son fils Alfonso, dans la supplique à la marquise de
Mantoue est dit : Fils du Maître Hercule de Fideli. Pour que personne ne
doute plus de l'identité du maître avec l'Hercule de l'Épée de César (dontj'avais
fait à tort autrefois Hercule de Pesaro), voici sur la même lame une signature
toute aussi valable pour nous que le nom : la fameuse tour de Pise, interprétée à
la façon de l'artiste. Rapprochons l'une de l'autre les deux lames pour bien
montrer les points de contact, qui vont sauter aux yeux, et saluons dans Hercule
de Fideli le graveur des cinque-dea de Hertford-House, de la tour de Londres,
du Musée de Pesth, de la collection Ambras et de l'Arsenal de Vienne, le
plagiaire ou le graveur docile du Pinturicchio, qui reproduit sur ses fourreaux et ses lames les figures et les emblèmes des appartements Borgia, le
fournisseur du Bentivoglio, l'orfèvre d'Eleonore ; celui d'Isabelle d'Este, l'auteur des lettres et des dessins par nous publiés, et en dernier lieu enfin ,
le graveur de l'épée du marquis FrançoisGonzague qui vient d'entrerau Louvre,
et que M. Molinier avaitreconnu aux divers caractères quenous avions dénoncés.
Concluons rapidement et résumons les faits : l'arme de
César Borgia, qui est un monument d'art en même temps qu'un document historique, est l'œuvre d'un artiste qui gravait des lames d'épée,
composait et modelait des gaines exécutées le plus souvent en cuir repoussé et
quelquefois décorées de compositions à figures. Une enquête faite dans un grand
nombre de villes d'Europe a permis de réunir trente à trente-cinq armes qui
peuvent lui être attribuées, parmi celles-ci on compte quatre épées et toutes
les autres sont des lames courtes dites « cinque-dea ». On a défini au cours
de cette étude le caractère de ce genre d'œuvres, la manière et les tendances de
l'homme qui, probablement, a été le traducteur des inventions d'artistes supérieurs, dont il a gardé l'empreinte. Hercule de Fideli évoquait de grands souvenirs et des idées hautes ; il était tout imprégné de l'idée antique et, s'étant
frotté aux humanistes , il se dégageait de ses œuvres un parfum littéraire; aussi,
au milieu de productions de pacotille desinées au commerce et de bijoux et colliers , a-t-il laissé quelques compositions d'un goût si élevé, et des fourreaux
d'épées d'une architecture si noble, qu'ils sont dignes de figurer à côté des
œuvres des grands maîtres de la Renaissance. L'orfèvre avait le goût des
inscriptions, il les empruntait aux poètes et aux historiens de l'antiquité, et
souvent aussi aux dictons en langue vulgaire. Parfois il les estropiait, soit qu'elles
fussent abandonnées à de grossiers ouvriers qui ne les comprenaient pas, soit que
le patron de la bottega n'en connût pas lui-même le sens. Ce maître Hercule
représente bien, par ses facultés multiples, un tempérament du temps de la
Renaissance; quand il se met à la disposition du passant, il fabrique sans passion
et met en œuvre, sans ordre et sans discernement, les éléments qu'il a emprun
tés à l'antiquité. Ondoyant et divers, il est aurifex, et, tenant boutique dans une
spaderia de Ferrare, il travaille pour qui le paie et ses fils travaillent avec lui et
prennent sa manière. Quelquefois aussi il lui est arrivé de prendre l'argent sans
livrer la marchandise (c'est le cas d'un grand nombre d'artistes du temps) ; mais
quand il a l'honneur d'être appelé par un grand personnage ou un de ces princes
souverains qui ont laissé dans l'histoire un sillon sanglant ou lumineux comme
César Borgia, François Gonzague ou Este, Hercule se redresse, et il parle haut.
Documents extraits des archives de Modène et de celles de Gonzague à Mantoue, prouvant l'identité entre
Salomone de Seso et Hercule de Fideli, orfèvre de l'Illme duc de Ferrare ¹.
1.
Ces documents sont extraits d'une note au catalogue de l'Armeria de Turin, publié par M. Angelo Angelucci.
Le 11 novembre 1487, Salomon da Seso, israélite, orfèvre, travaille à Ferrare pour Eleonore
d'Aragon.
Document montrant, entre le 21 mars 1491 et le 25 novembre 1491 Salomon da Seso converti, ayant pris le nom
de Hercule de Seso.
3.
MCCCCLXXXX E a 25 de Novembre lire Unna soldi diexe di Marchexana e per sua
Signoria a Mastro Erchule da Seso Orevexe controscripto per dorare uno fornimento di libro
fato de filo per suo S. (même source c. 250).
Preuve de la conversion de Salomone da Seso par l'extrait de l'inscription de sa fille sur la liste des demoiselles
d'honneur de Lucrèce Borgia.
4.- ..... La Figliola che fu d'Hercule, Orevese già hebreo- (Casa Ducale. Docum., Lucrezià
Borgia, Archº Stato Modena 1502 c. 39.
Mention du nomde famille du ci-devant Salomon da Seso devenu Hercule da Seso dans une supplique adressée
à la marquise Isabelle d'Este en faveur d'Alfonso, fils d'Hercule, par Eleonore sa mère, par Sapuncia sa
femme, et ses six enfants (2 mars 1521) .
5.
Alla Marchesa Isabella d'Este Gonzaga a Mantova :
Illa Ecca. A pedi di V. Ex.
piissima recureno li poveri etinfelici servitori di quella, Eleonora Madre et Sapuncia mogliere de
Alfonso de M° Hercule de Fideli, orevexe, et sei filioli inutili de dicto Alfonso, et anche tre
sorelle de dicto Alfonso da mandare ecc... (Archivio Gonzaga Correspond... con Ferrara).
Confirmation du même nom par un extrait de document cité par Cittadella, concernant un autre fils d'Hercule.
6.
Ferdinandò del Fu Ercole Fedeli di Ferrare, pure orefice
― (CITTADELLA ― Notizie
relatives à Ferrare, p. 694).
PORTRAIT de Lucrèce BORGIA.-Fac-similéde la peinture à l'huile
appartenant à M. Gugenheim àVenise.
LASALLE DES SAINTS.- Projection de l'une des travées de la voûte
(Histoire d'Isis et d'Osiris). Fresque du Pinturicchio. Dessin
d'après une photographie du prince Ruffo, à Rome .
LA SALLE DES PONTIFES .
Projection du plafond.- Décoration de Jean
d'Udine et de Pierino del Vega. D'après le Pistolesi.
SAINTE CATHERINE DEVANT L'EMPEREUR MAXIMIN.- (Salle de la Vie des Saints) .
D'après une photographie du Prince Ruffo, à Rome.
FUITE ET MARTYRE DE SANTA BARBARA. (Salle de la Vie des Saints). D'après
une photographie du Prince Ruffo, à Rome.
VISITE DE SAINT ANTOINE ABBÉ A SAINT PAUL.
(Salle de la Vie des Saints).
D'après une photographie du Prince Ruffo, à Rome
Les Planches La Description
se trouvent
placées
en face.
LeTitre
Page 32
Page 36
Page 4S
Page 60
Page 64
des Planches se
trouve
àlaPage
133
52
40
49
61
61
212
AUTOUR DES BORGIA.
PLANCHES HORS TEXTE
Prétendu PORTRAIT DE CÉSAR BORGIA.
PORTRAIT D'ALEXANDRE VI.- D'après la Fresque du Pinturicchio, dans les
Appartements Borgia au Vatican; copie faite par M. Pinta (ancien pension
naire de la Villa Medicis).
Portrait de CÉSAR BORGIA (?).- Galerie Borghèse, à Rome.
(Musée Correr de Venise). D'après
une photographie.
Portrait prétendu de César Borgia. (Ancienne galerie Castelbarco Albani).
D'après l'original .
Portrait de CÉSAR Borgia.
Comte Codronchi, à Imola.
D'après une Copie du temps appartenant au
..
Portrait de LUCRÈCE BORGIA(?) . — Collection de M. Henry Dœtsche, à Londres.
LUCRÈCE BORGIA.
D'après un Portrait du temps.
POIGNÉE DE L'Épée de César Borgia.
Musée de Nîmes.
(Palais Gaetani, à Rome). Communi
quée par le duc de Sermoneta.
(Musée de South Kensington). Communiqués par M. Armstrong.
Partie inférieure et Revers du FOURREAU
Les Planches La Description
se trouvent
placées
en face.
Page 72
Page 88
Page 92
Page 104
Page 112
Page 128
Page 132
Page 144
Fourreau de L'Épée de César BORGIA (Musée de South Kensington à Lon
dres) ; fig. 2 et 3. FOURREAUX de Maître Hercule (Musée d'artillerie à Paris). Page 156
Épée de MaitrE HERCULE (Collection de M. Ressman).
CINQUE-DEA DU MAI
TRE HERCULE (Tour de Londres) .
Dessins pour LAMES D'ÉPÉES attribués à Hercule (Cabinet des Estampes de
Berlin). Communiqués par S. M. l'Impératrice Frédéric
Études pour Lames d'épées (Cabinet des Estampes de Berlin). Communiquées
par S. M. l'Impératrice Frédéric.
Page 176
Page 184
Page 200
desPlanches se
trouve
àlaPage
72
89
108
105
108
129
131
144
156
189
197
201
N- TÊTE.
Cul-de-lampe .
Frise dans le Palais de Ferrare
Prison de César Borgia en Espagne (la Mota de Medina del Campo)..
La Forteresse de Spoleto
Palais de Pesaro
Porte dans la Salle de la Sécurité publique (Palais de Pesaro)
Sceau personnel de César.
Sceau de César Borgia, à Rimini
La Bibliothèque de Cesena
Catarina Riario-Sforza (Médicis).
Armes de César encastrées dans la muraille de la Forteresse de Forli
Edicule faisant partie de la Valentine (Fondation de César Borgia à Imola) .
Entablement et chapiteau de l'église de Piratello (fondée par César Borgia à Imola) .
Château du Piratello (Fondation de César Borgia à Imola)
Personnages de la Cour de Ferrare (Fresques du Palais de Schifanoia)
Le Palais des Ducs de Ferrare (Ferrare)
Armes des Borgia (Cul-de-lampe)
Chapiteau aux Armes et aux Emblèmes du pontife Alexandre VI (Salle de la Vie des Saints
Les Appartements Borgia avec un Fragment du plan du Vatican
Plan de la salle des Pontifes, avec projection du plafond
Jupiter, Salle des Pontifes
Apollon
Diane
Mars.
Mercure
Frise de la cheminée de la salle des Pontifes..
Vue perspective d'une travée de la salle de la vie des Saints .
La Naissance du Sauveur..
Pages.
VII
VIII
3
4
5
8
9
13
13
14
16
18
20
22
23
25
26
28
31
33
38
41
41
42
1
44
48
53
43
43
214
L'Adoration des Mages..
Les Apôtres et la Vierge.
AUTOUR DES BORGIA.
Plan de la salle de la Vie des Saints..
Sainte Catherine d'Alexandrie devant l'Empereur.
Médaille du sultan Mahomet II, père de Djem, communiquée par M. Aloïss Heiss.
La Visite de saint Antoine abbé à saint Paul,
Salle de la Vie des Saints. Martyre de saint Sébastien .
La visitation de la Vierge..
La Vierge et les Anges.
Mariage d'Isis et d'Osiris .
Salle de la Vie des Saints.
Mercure tue Argus..
La Grammaire..
La Musique..
La Rhétorique
La Géométrie.
La Dialectique
Cul-de-lampe (Le Bœuf des Borgia).
En-tète de la Bulle de Jules II rendant auxGaetani les Biens enlevés par Alexandre VI. — Archives
des Gaetani..
Médaille d'Alexandre VI.
Commémorative des Travaux du Môle Adrien (Fort Saint-Ange).
Anonyme. Communiquée par M. Aloïss Heiss.
Le Pape Alexandre VI (Fac-similé d'une gravure ancienne) .
Alexandre VI. — Panneau du Pinturicchio au Musée de Valence. Communiqué par Don Francisco
de Madrazo, directeur du Musée de Madrid.
Alexandre VI présente à saint Pierre, Pesaro, capitaine général de l'Eglise.(Tableau du Titien au
Musée d'Anvers) ..
Buste de Paul II au Musée de Berlin
Alexandre VI (Frontispice de l'ouvrage de A. Gordon).
Médaille d'Alexandre VI.
Commémorative du Jubilé de 1500.
César Borgia d'après Paul Jove.
La Frise est tirée d'une gravure de Maître Hercule.
Image de César, d'après Guillaume Roville (Promptuaire des Médailles)..
César Borgia, capitaine général des troupes pontificales. D'après l'illustration de Paul Jove .
César Borgia. — Copie du portrait du Museum Jovianum (Côme, au Musée des Offices de Flo
rence) .
Prétendu portrait de César Borgia au Musée de Bergame. — Communiqué par M. Monetti, con
servateur..
Portrait prétendu de César Borgia (Musée de Forli)
Portrait prétendu de César Borgia.
Pages.
53
54
55
60
57
61
62
62
63
65
66
67
68
68
69
69
76
79
81
83
84
85
86
87
87
88
96
100
101
104
107
Provenant de la Galerie du Régent de France. Aujourd'hui
à Deep-Deen, chez M. Hope .
Aut Cesar, aut nihil (Cul-de-lampe).
Le Bœuf Borgia. Frise d'Épée du Maître Hercule.
Lucrèce Borgia, duchesse de Ferrare. Médaille communiquée par M. Aloïss Heiss.
Médaille de Lucrèce Borgia, communiquée par M. Aloïss Heiss.
Revers de la Médaille de Lucrèce dite « à l'Amour captif » .
Lucrèce Borgia, conservé à Ferrare (Provient de feu Mgr Antonelli).
Majolique à reflets métalliques.
Collection Édouard André (Paris). Citée par Rawdon-Brown
et par Gregorovius .
Prétendu Portrait de Lucrèce Borgia, par le Titien.
session de M. Cook, de Richmond
Portrait prétendu de Lucrèce au Musée de Dresde.
Alphonse d'Este, Duc de Ferrare. D'après le Titien.
Cul-de-lampe.
Devise de César Borgia.
L'Épée de César Borgia .
Frise de son Epée
Galerie du Régent. Aujourd'hui en pos
(Fragment )
Attribué au Giorgione
112
114
115
117
118
118
119
121
124
125
139
140
143
148
TABLE DES ILLUSTRATIONS.
L'Épée de César Borgia (Face et Revers).- Communiquée par le Duc O. de Sermoneta.
Palais Geatani
Signature d'Hercule sur un Fourreau de Cinque-dea (Musée d'Artillerie de Paris)..
Le Sacrifice au Bœuf des Borgia
Le Passage du Rubicon.
Le Triomphe de César
La Pax Romana
Sacrifice au Bœuf Borgia.- Cinque-dea de la Collection de Hertfort-House
Stocco Italien xvº siècle du Maître Hercule. Collection Ambras de Vienne. (Communiqué par le
Dr Schneider.).
Cinque-dea à l'Arsenal de Vienne. (Communiquée par M. le Dr Schneider, Conservateur du
Cabinet I. et R. des Antiques.) .
Cinque-dea du Maître Hercule au Musée de Pesth.(Communiquée parM. Hampel, Conservateur )
Cinque-dea. Collection du Musée National de Pesth. (Communiquée par M. Hampel, Conserva
teur.)..
Frise d'une Cinque-dea du Maître Hercule (Musée de Bologne)..
Études pour des lames. D'après un album de dessins conservé au Musée des Estampes de Berlin.
(Documents communiqués par S. M. l'Impératrice Frédéric.) .
Cinque-dea aux armes du Marquis de Gonzague (Face). Cinque-dea aux armes du Marquis
François Gonzague de Mantoue (Musée du Louvre).
Cinque-dea du Maître Hercule au Musée de Berlin, portant le nom de famille du Maître (Fideli).
Inscription sur la fusée de l'Épée de César (César Borgia, Cardinal de Valence) .
En-tête
Cul-de-lampe.
En-tète
Cul-de-lampe.
En-tête
Cul-de-lampe.
?
215
Pages.
Rome,
152
157
170
172
176
180
189
190
190
192
192
193
197
204
205
209
211
212
213
215
217
220
0
۱۸
0000
0
TABLE ALPHABÉTIQUE'
Pages.
100
A
CUTO, Giovanni.
Ademollo, 145 .
17 Bajazet
Pages.
Baillet
96
58,
59
Borghèse .
Pages.
29
Borgia-Alonzo, pape Callixte,
Agnello (le Pro
tonotaire)
Alberti
Battista).
(Léon
14,
Albret (Charlotte d'), 5, 90, 94
Albret (Jean d' )
Aleson (le père) .
•4,
Barbier de Montaut.
64 Barbo (Paul II)
Bardini
32 Baroul .
Basilewski
Batti-Ponte .
5
5
Bauffremont (Courtenay)
76
86
193
200
183, 192
201
101
III , 153
12, 18, 58, 100, 101 , 104, 107,
111 , 114, 143 , 147, 155, 170,
176, 180, 209. Borgia César
.88 à 114
Borgia (Francesco de)
Borgia (Gioffre)
83,
84
117 à 124. 153
Alfonso da Sesso.
Alessandretti
32, 81 à87. Alexandre VI,
de 81 à 87, 151
Allegres (Yves d' )
Altissimo (L') .
Alvisi (Odoardo) ..
Ambras (Collection) .
André (Édouard)
Andrea del Sarto.
Angelo Angelucci.
264
20,
23
165
17
101
113, 179
162, 190
116, 120
92
204
Antonelli (Monsignor) . 116, 119
Apis (Le Bœuf) .
64,171, 195
38 à 69. Appartements Bor
gia.
Bayard (Le chevalier) .
Beaumont (Édouard de), 158,
139
162, 184, 187
Behaim (Laurent de)
Borgia (Lucrèce), de 117 à 148
Borgia (Rodrigo) ..
Bosso (Matteo).
97 Botticelli (Sandro).
102
Belleforest
Belvédère (Le) ..
Bembo (Le cardinal)
34, 35
140
Bourbon (cardinal de) .
Bourbon (François de) .
153
60
61
73
ΙΟΙ
Bourbon (le connétable de) .. 56
Bentivoglio (Giovanni) , 13 ,
162, 180
Bergame
203. Berlin.
Bernaerts
Betti (Bernardino)
Biaggio (San) .
38 à 70 Bisceglie (Alph. de)
Appia (La Voie) .
Boccaccio ..
167
96, 103
205
187
34
16
.166, 168
Brantôme.
147
Braschi (Angelo, pape Pie IV) 149
Braschio..
Briconnet (Guillaume)..
Brienne (Aube) .
Broglio (Chronique de) .
Bronzino (Le) .
Bucci (de Ferrare) .
94 Builder (The)..
Aragon (Alphonse d') .
Aragona (Gaetani d')
Buonfigli (Le) .
100
169
205 Bode (Wilhelm), 86, 92,
187, 190, 193, 196
178
46
173
92
119
52
70
Burckardt (Son Diarium) 36, 39
Arazzi.
Ariminium
Armand (architecte) .
Armstrong
Aurefici
Azzariti (Don Francesco)
0
1.
43
172
96, 117
56.74,
75
65, 157
149
197 Bologne (musée de).
Bonafede (Nicolò)..
Bonaïni.
Bonfigli (Benedetto) ..
Bongy (Mr de) .
Boniface VIII.
193
11,
12
114
Burckardt (Jacob), 59, 64, 93,
97, 113, 179
Burman.
69 Bussolanti.
59
167
Cabelly (S. Ν.) .
102
73
85
Les Chiffres qui précèdent les Articles de cette Table indiquent les Pages où se trouvent les vignettes placées dans le texte.
Ceux qui suivent se rapportent aux pages où se trouvent mentionnés les articles.
28
00
218 AUTOURDES BORGIA.
Pages. Pages.
Cagnolo (ambassadeur)..
Calendars (LeRecueil)
138 Dozza. 23
116 Dresde 116
CalistodeLodi 103, 104
Pages.
Gordon (Alexandre) . 79, 87
Gregoriovius (Ferdinand) 26,
89,95, 115, 116, 118, 144, 182
Callixte III . 155 EleonoradaSesso. 204 Grevio (LeTesorodel).. 102
Calmeta(Vincenzo) 14 Epicédium (L') . 159 Grimaldi. 148
Caminazzi (Lorenzo). Epinay (Med') 145, 146, 149, Grima. 145
Campi (Sébastiano).. 169 169, 170 Guarini (Antonio). 16
Campori (Guiseppe) . 115 Este (Albert d' ) . 26 Guevara. 4
Cancellieri. 145, 169 139. Este (Alphonse d') 119, Guggenheim. 193
Caoursin (Guillaume) . 59 120, 139, 159, 200 GuillaumedeSaint-Malo, 98
Capello (Francesco).. 36 Este (Herculed') . 137, 204
Capello (Paolo).. 82
Caperonier (Helléniste).. 146
Este (Isabelled') 25, 137, 201,
Estouteville.
202
Hampel (de Pesth). 191
168 Hébert (Lepeintre).. 55
Cappello(Antonio) . 95 Heiss(Aloíss) 60,82, 96, 117
Carrara(Académie).. 96, 103 Faënza. 19, 20
45, 157, 193, 198.Hercule
Caserta. 167 Fanfulla. 145 (Lemaître). 157, 161, 163,
Castelbarco Albani 103 Farnėse(Julia) . 72, 178 184, 185, 197, 198
Catanei (Vanozza) 94 Febrer (sa chronique). 153, 156 Hérodote(Livre) . 153
Catherine (l'Impératrice).. 150 Ferrante (daSesso) . 205
Ceresada.. 5
189.Hertfort-House. 163,183, 189
Holbein. 113
2, 26. Ferrare . 25, 26, 200
César (Romain) . 176 204. Fideli (Herculede) 192, Homenajé(Latourde l') . 9
Cesaretti. 145, 146 204,à 208 Hope(Galerie) 103
Cestius. 195
Charles III.. 145
Fileno (chroniquede).. 64,
FiorenzodiLorenzo.
180 Imola. 20, 21
170 InnocentVIII. CharlesVIII. 45, 58, 98, 165, Fondi. 167 Isis 63 167, 194 Forli. 16
Chigi (Lorenzo) . 37, 38 Fornoue. 165 Jayme(Don). 153
Chinchilla.. 5, 90 Fortuny(Lepeintre)... 157, 158 Jovianum (Museum) . 99, 102 Cimabuë 171 Francesca (Piero Della). ΙΟΙ Jovio (Paolo).96,99,101, 104, 113 189, 191, 193. Cinque-dea.. 193 Francesco. 27 Jules II. 12, 35, 72, 79, 169, 180 Cisterna. 167 Francia (Francesco) . 91 JustodiConti. 176 Citadella (Napoléon) . 26 Francia(Giacomo) . 103 Justolo (P. Francesco) . 14
Clément VII 23 Frank (Allemanni). 65
ClémentXIV.. 149 Frati (deBologne). 100 Keglevich (comte). 190 Codronchi(Lecomte). 20, 113 FrédéricIII . 58 Kemmerer (son ouvrage sur
Colonna(Antonio) . ΙΟΙ Frédéric-Charles(prince) 183, lemuséeImpérial) 192
Como. 99 192, 195, 208
Condotta (La). 167 198. Frédéric (S. M. l'Impé
Consolari. 75 ratrice) 197, 198
LaurentleMagnifique.
Laurentiana(La)
178
14
Corella (Michelotto). 10, 11 , 39 Friedlænder. 82, 96, 117
Corio (Bernardino) 64 Froehner. 175
Correr(LeMusée) . 103, 175
Cosenza. 84 Gaetani 143, 144, 148, 149,
Lautrec (maréchalde) .
Lazari (Vincenzo) .
Lenormand(archéologue)
LéonX.
101
175
.
175
41
Costabili (L'ambassadeur) . 139 150, 152, 159, 166, 167, 169 LéonXIII . 74
Cotrone (Lamarquisede) 138 Galiani (Célestin) 145à149, Leopardi (Giacomo). 11
Courajod.. 187, 192 196 159, 166, 170, 174, 183 Léopardi (Manaldo) II
Credo (Lasalledu).. 69 Galiani (Ferdinand) . 145 Lévy(éditeur).. 188
Crowe 93, 103 Gambara (Bernardinus). 59 Llacer (DonFrancisco). 85
CroweetCavalcaselle. 89, 115 Gandia(ducde) 58, 59, 60,61, LlancoldeRomani. 155, 156
95, 166, 168 Lippi (Filippino) . 117, 118
Decio (Filippo) . 177 Garisanda (Latour). 177
Della Croce. 177 Gattamelata. 21, 100
Lochis (Lecomte) .
Loges (Les) .
103
40
Deep-Deen.. 103 Gazettearchéologique. 163 Londres (Tourde) . 189, 194
Diario Cesenate. 178 Genga-Bartolommeo. 9 Longperier 175
Diderot . 145 Ghetti(Giovanni).. 37, 38 Lotti (Pampilio) . 102
Dittamondo(Le). 176 Gonse (Louis) 100 203.Louvre(Muséedu) 203
Djem (Zizim) 58à61, 164 203. Gonzague. 101 , 165,
Donis. 153 187, 200, 203 MadonedesFièvres . 85
DossoDossi. 103 GonzalvedeCordoue. 177 Madrazo(DonFr. de) . 83, 85
TABLEALPHABÉTIQUE. 219
Pages. Pages. Pages.
Maffei. 175 Orsini. 10, 167, 174 Romagnes (Les) . 151
Magenza 168 Osiris 63, 65 Rosselli (Cosimo) . 97
Magnanini 200 Ovide(Livre) 153, 156, 175 Rossellino (Bernardo) 32
MahometII . 60 Rossi-Scotti (Le comte Lem
Maiano (Benedettoda). 20 Paladino (médailleur) 82 mo) . 57, 74
Maioliché 76 Pallavicini (Antonio) 37 Rovere (Della).. 6, 8
Majolique . 120 Palmegiano. 17 Roville (Guillaume) . 96, 102
Malatesta(Les). 12, 13 Pampelune 5 172. Rubicon (Le) . 154, 179
Malatesta (Novello) 14 Pamphili (Doria).. 92, 116, 117 Ruffo(Le prince).. 75
Malatesta(Sigismond) . 140, 173 Panciatici (Les) . 92
Malatestiana (La) . 66 Pandolfaccio. II, 12, 13
Manfredi(Astor) . 17, 19, 24 Papagallo 33, 36, 39 Saint-Ange(LeFort) 32, 40, 81
Mantegna. 113 Salazar (Franciscode) . 73 Paradin (Le chanoine) . 178
Mantoue.. 25, 202 SalomondaSesso. 204, 208, 209 Paridede Grassis. 72 San-Damaso. 73 Marie-Thérèse (Impératrice). 148 Parmegianino . 93 Sandedei. 162, 183 Marietti (Francesco). 104 84. Paul II 12,84, 86
SanDonato. 167 Marsi (Lecomte).. 10 PaulV(Borghèse) 32 SanFelice. 167 Matarazzo. 39 Pepi (Francesco) 39 Sanvitali 190 MatteodePasti 80, 174 Perey(Lucien) 145 Sansovino. 43 MatteoNuti. 174 Perez (Giorgio) . 93
Maugras (Gaston) . 145 Perugin (Le) 61 Sapienza (La).. 160, 177
Savelli 167 Maximin(L'Empereur) . 49 Peruzzi (Baldassar) 70
Mazzuchelli. 175 Savoie(Leducde).. 137, 145 6. Pesaro. 8,87
Medicis (Hippolythede) . 41, Schedel(Hartman) . 45 ΙΟΙ 191. Pesth (Muséede) . 191 25. Schifanoia . 25à
6.MedinadelCampo.. 6, 90 27 PhilippedeSens 98 Schmarsow
Merlini (Lemarquis). 16 •70, 83
Piccinino . 101, 208 Schneider (de Vienne) . 190 Meyrik 189 PieIII 97, 114 Sesso. Michel-Ange. 151 204 Pie IX 74 SediaGestatoria. 166
Mila (Adriana) . 177 Pierino del Vega 41,42, 43
Milanesi. 82, 117 Pinturicchio (Le), 41, 44, 46, Serafino(daBrescia) . 208
Minghetti (Marco) . 89 47, 49, 50, 59, 60, 74, 82. Sermoneta(Onorato de), 143,
Molinier 187, 188 83, 97, 153, 157, 160, 162, 167 144, 148, 150, 152, 163, 167, 168
Monbizon. 193 Piombino. 145 Sesso (Sapunciada) . 205
Moncade (Ugode) . ΙΟΙ Piratello(Le) 23 16. Sforza(Catherine), 17, 21 ,
Monteallegro(Leducde).146, 148 139, 140 Pisanello 15, 80
Montefeltre 8, 101 Pisano (dit le Pasanello) 175 Sforza (Giovanni) . 8, 9
Simancas. 6
Morelli. 89, 92, 93, 103 Pistolesi (Erasmo) 41
Moret 4, 5 Sinigallia. 10
Pittigliano 98
Mosca (Simone) . 43 Sixte-Quint. 74 Poliphile (Le songede) . 176
Mota(La) . 6 Pollaiolo (Antonio) . 151, 156, 182 Sixtine(La) . 73
Mundler. 93 Pompilio (Paolo) 160
South Kensington Museum,
Müntz (Eugène) . 86, 89, 163 56, 75, 144, 151, 156, 163, Pontormo (Le) 92 172, 183 Muséed'artillerie (Paris). 188, 199 Porcari . 160
Portius(Hieronimus),64,171, 176 Spagna(Le). 8
Najera (L'abbéde).. 73 Poyane 168 Spence (amateur) 144
Narischkine. 192 PrimaticeetlesDécadents 185 Sperandio. 80
Nieuwerkerke(Lecomtede). 189 Primoli (LecomteZ.) . 75 Spitzer.. 163, 183, 188
Spoleto. 3, 7 Ninfa. 167 Stanze (Les) 33, 34, 53, 66,
Nocera 96 Quadriuim (Le) . 66
74, 75
Norma 167 Strozzi (Hercule) . 159
Nuremberg 98 Ramolino 180 Suetone. 158
Nutti (Matteó) 14, 15 Raphaël(Sanzio), 88, 91, 92, 93 Sulmona.. 175
Ravenne 20 Syllabica (La). 177 Oberdank. 15 Rawdon-Brown 116, 120
Offices(Muséedes). 101, 102 Ressman 187, 194, 195
Olozaga(Juande). 4 Rignano 168 Taro(Batailledu) . 203
Ordelaffi 17 Rimini 12, 173, 174 Tauzia (Levicomtede).. 113
Orefici. 151 Riquetti. 116 Thuasne (Léon) 59, 60
Orfino (Battista). 14 Rodrigues (fils deLucrèce) . 168 Timoteodelle Vite...... 91
220
Titien (Le).
Tivera.
Teano.
Terence (Livre) .
Tommaso Tommasi
Tonini (L'historien)
*
*WIEN
Torentini
Traetto .
Trivium(Le)
Tsarkoe-Celo (Musée de)
AUTOUR DES BORGIA.
Pages.
79, 85, 86. ΙΟΙ Urbinate (L')
167
84, 167 Valence.
Pages.
92
190. Vienne (Musée de) .
Villa (Rodriguez) .
79, 85 Vinci (Leonardo da) .
153 Valentine (La) .
147 Valentino.
12 Valentinois.
99 Vailardi.
167 Valturio (Roberto) .
21, 22 Vittoria(Alesandro)
145, 146
148
113
Volpini (Salvatore)
Pages.
190
73
17, 113
II
69, 74
Wallace (Sir Richard) 162,
14, 174
66 Vanozza (La) .
192 Vasari.
33. Vatican
LIOTHEK
Uberti (Francesco) 14, 15, 64, 66 Venturi (Adolfo).
Udine (Jean d') . •
41, à 43
Urbin (Frédéric d')
Vexillum (Le) .
174 Woodhouse
46, 50,
97
33
115
87
189, 195
52, 74
Zambotto (Bernardo)
Zeit.
137
75, 76
76
Viana
12
Zilliolo (Hier.) .
4,
FIN
87 5
K
200, 20
F
BUCHBINDERE
W.WOBER
F
WIEN VI Stiegendasse 9.
2023年9月19日

LUCRECE BORGIA (2)
Collection de M. Henry Doetsche à Londres

LUCRÈCE BORGIA
D'après un Portrait du Temps. ― Musée de Nîmes.

Alphonse d'Este, Duc de Ferrare. D'après le Titien.
TROISIEME PARTIE
L'ÉPÉE DE CÉSAR BORGIA

Devise de César Borgia. ― Frise de son Épée.
Ce point de vue seul, incontestablement justifié par les sujets gravés sur la
lame, fait de cette arme un document considérable, en ce sens qu'il exprime,
selon une expression à la mode aujourd'hui « un état d'âme » de César Borgia à
l'époque de sa vie où, enchaîné par les liens ecclésiastiques, il rêvait de rentrer
dans le siècle pour ceindre une couronne et se tailler un royaume à coups d'épée.
Le document est important aussi au point de vue de l'esprit qui anime l'époque
et de l'atmosphère dans laquelle on vivait au Vatican ; les influences de l'antiquité,
le retour au paganisme engendré par l'étude et l'intimité des contemporains avec
les grecs et les latins se lisent clairement dans ces compositions qui éveillent nos
souvenirs, excitent nos pensées, nous portent à retourner en arrière ; de sorte
que l'arme que César a portée, un des seuls témoignages de son passage ici-bas, se
lie étroitement à l'histoire du héros que nous avons étudié, et devient l'illustration la plus intime et la plus indispensable à sa biographie.
Par une fatalité qui s'attache au nom des Borgia, la lame est séparée de son
fourreau aujourd'hui conservé dans les vitrines du South-Kensington de Londres.
Des lois inéluctables font regretter qu'il n'en puisse plus jamais sortir, comme le
fer, conquête précieuse pour la famille des Gaetani, ne sortira jamais non plus
des archives de la famille¹.

PARTIE INFÉRIEURE DU FOURREAU

POIGNÉE DE L'ÉPÉE DE CÉSAR BORGIA
Palais Gaétani, à Rome.

REVERS DU FOURREAU
Musée du South Kensington.
Avant de décrire le monument nous résumerons les notices que M. Ademollo
a réunies à son sujet. Nous avons dit qu'on ne soupçonnait point l'existence de
l'arme en Italie avant l'époque où Cancellieri, qui s'était donné la tâche d'écrire
une notice sur un certain nombre d'armes célèbres, la fit figurer dans sa publication Spade celebri. L'épée de César, au dire de l'écrivain, était, au moment où
il écrivait, en possession du duc de Montallegro¹, qui l'aurait apportée d'Espagne à Naples en 1734; cependant Cesaretti dans son Histoire de la principauté
de Piombino, substitue à celui-ci un duc de Montalbano, et il y a tout lieu de
croire qu'il a fait erreur à ce sujet et confondu les deux noms.

L'Épée de César Borgia.
Ceci se passait en 1781 , nous voyons que l'abbé Galiani sut résister à la tentation puisqu'il mourut en possession de l'arme; on sait d'ailleurs qu'il avait son
idée ; il s'est dévoilé dans la lettre à madame d'Épinay par ces mots : « Je voulais
enfaire un présent lucratif au Pape et, selon mon usage, l'accompagner d'une
dissertation érudite pour en illustrer les emblèmes. » Le projet avorta à cause de
l'avènement au trône pontifical d'Angelo Braschi, sous le nom de PieVI. Galiani,
au dire de M. Ademollo, était loin d'être persona grata vis-à-vis du nouveau
pontife; il l'avait tout simplement traité de « laquais. »
Quoiqu'il en soit, Galiani mort, on constata qu'il avait disposé de l'arme par
ce paragraphe de son testament :
« Mes exécuteurs testamentaires savent quej'ai promis de céder pour le prix
de trois cents ducats napolitains à Monseigneur Gaetani d'Aragon, qui està Rome,
une célèbre épée du duc de Valentinois, avec les mémoires que j'ai recueillis sur
ce précieux objet. Je les prie donc de l'offrir au prélat pour le prix indiqué. Mais
s'il ne désirait plus l'acquérir,je veux qu'on offre respectueusement, en mon nom,
la susdite épée à S. M. I. l'Impératrice de toutes les Russies, comme souvenir
de ma reconnaissance infinie pour tous ses bienfaits. » — 14 octobre 1787. —
C'était, en faveur des Gaetani, un droit de préemption, dûment établi par la
volonté du défunt. Immédiatement averti, Mr Gaetani, qui voyait se réaliser le
vœu qu'il avait formé depuis sept années, écrit en ces termes à l'exécuteur testamentaire Don Francesco Azzariti : « L'Abbé a été assez bienveillant pour se rappeler la promesse faite à ma famille, incitée par moi à acquérir ce monument,
l'Épée de César, afin de la placerdans laforteresse de Sermoneta assiégée et ruinée
par le duc de Valentinois, l'ennemi mortel de notre maison... Je vous supplie de
faire remettre entre les mains du porteur et sous scellés tous les mémoires manuscrits que l'abbé a recueillis sur cet important monument, mémoires dont je connais l'existence. »
― Et ici Mgr Gaetani rappelle la visite faite à l'abbé au Palais
de l'ambassade d'Espagne. « Ce monument acquis par nous, ajoute-t-il, sera pour
mafamille un souvenir impérissable de l'amitié qui meliait à l'abbé;je l'avais rencontré pour la première fois en 1769 au Conclave de Clément XIV, à son retour
de Paris, et depuis nous nous sommes souvent regardés l'un l'autre comme deux
amis qui avaient un fondsd'idées communes sur l'archéologie, les médailles et l'antiquité. »
A cette lettre était joint l'envoi de trois cents ducats napolitains¹.
L'arme en possession du duc de Sermoneta, celui-ci renonça àla placer dans la
forteresse ; elle a été conservée jusqu'ici dans le Palais Gaetani de Rome, résidence habituelle de la famille, où nous avons pu l'étudier à loisir, grâce à la bienveillance du duc actuel qui a voulu nous en faciliter la reproduction dans ses
moindres détails par les nombreuses photographies qu'il a fait exécuter.
CUM NUMINE CESARIS OMEN : Telle est la première devise que César écrit sur
son épée ; c'est le frontispice qui régit la pensée générale des diverses compositions. Ce nom d'un conquérant devenu àtravers les siècles le titre même de ceux
qui exercent le pouvoir suprême, le fils d'Alexandre VI l'a reçu à sa naissance ;
il y veut voir un heureux présage. Avec l'assentiment de César, sous ses auspices,
il s'élancera dans la vie, les yeux fixés sur son héros. Plus tard, celui qui est
encore cardinal de la Sainte-Église, devenu duc des Romagnes, portera un vrai
défi à la destinée et lui mettra, pour ainsi dire, le marché à la main en prenant
cette devise qui renchérit encore sur l'inscription et révèle son impatience de
régner : Aut Cesar aut nihil.
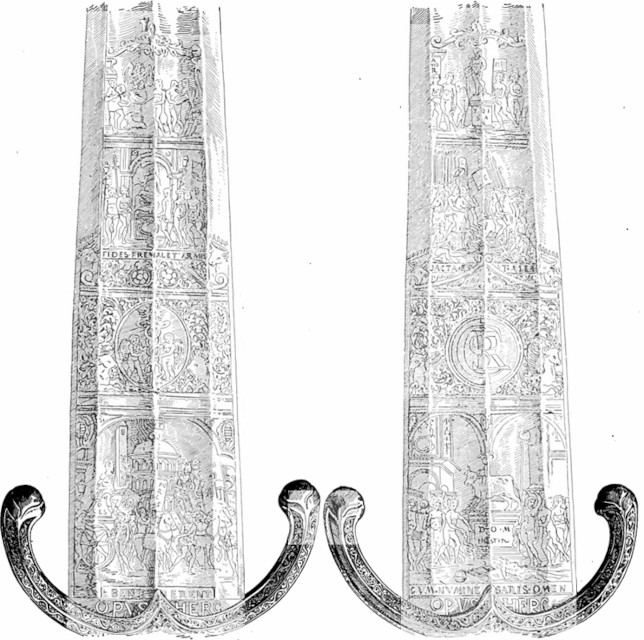
L'Épée de César Borgia (Revers). L'Épée de César Borgia (Face).
Communiquée par le Duc O. de Sermoneta. ― Rome, Palais Gaetani.
Un parti pris purement ornemental occupe le deuxième compartiment de
l'épée. Au centre, dans un cadre circulaire, s'enlacent, enfermées dans l'initiale
C, toutes les lettres qui forment le nom de César. Tout autour du monogramme,
le champ est rempli de feuillages d'un beau caractère qui sortent du tronc du
bœuf héraldique de l'écusson des Borgia. Cette partie de l'ornementation rappelle
beaucoup, par la forme et le parti pris, celle des typographes vénitiens, et notamment la page initiale de l'Hérodote de 1494, le Térence de 1499, et l'Ovide
de 1497.
On sait que l'illustration de la famille des Borgia date d'Alonzo de Borja, né
en 1378 à Jativa dans la province de Valence. Alonzó était d'église, secrétaire
intime du prince d'Aragon qui allait fonder une dynastie dans le Napolitain, il
était venu à sa suite dans le royaume; nommé d'abord évêque de Valence, il fut
élu cardinal en 1444, et, ayant formé dans le Sacré-Collège un parti qui s'appuyait
sur Aragon, il ceignit la tiare en 1455, sous le nom de Callixte III. Une sœur de
Callixte, restée à Valence, dona Isabel de Borja y Doms, y avait épousé don
Jofre de Borja y Doms, riche gentilhomme de Jativa; elle en eut deux fils, Pier
Luigi et Rodrigo ; on sait que c'est ce dernier qui, devenu le pape Alexandre VI
en 1492¹, fut le père de César Borgia.
Une frise sépare le second compartiment de la lame, de celui qui contient la
troisième composition, sous laquelle on lit : JACTA EST ALEA. « Une troupe de
guerriers nus, des fantassins tenant le javelot et formant avant-garde,traversent le
gué d'un fleuve; derrière eux, en phalange serrée, s'avancent des cavaliers nus. Le
premier d'entre eux tient une enseigne flottante; d'autres fantassins ferment la
marche. Un enfant, la tête couronnée d'un laurier, vêtu d'un justaucorps, joue de
la flûte, assis sur la rive du fleuve. » C'est le passage du Rubicon, caractérisé par
l'inscription empruntée à Suétone (Vie de César, chapitre 32). L'artiste, évidemment pour des raisons d'équilibre et de pondération, a interverti, dans la citation
empruntée à l'écrivain, l'ordre des deux derniers mots. Les manuscrits de Suétone et ceux de Lucain sont ceux qu'on a le plus reproduits sous la Renaissance,
etplus souvent encore, on les a interprétés et commentés. La personnalité de César
avait vivement frappé les seigneurs des petites républiques italiennes, fervents
admirateurs de l'antiquité, et la représentation, sur la lame de son épée, du fait
décisif de la vie de celui que Borgia avait pris pour son héros, devait avoir dans
l'esprit du cardinal de Valence quelque haute signification.
Le dernier sujet gravé sur cette face présente une véritable énigme aux épigraphistes. « Au centre, sur un piédestal, se dresse la statue de Cupidon, un bandeau sur les yeux, avec la flèche etle carquois. Disposées sur trois lignes, et bien
séparées les unes des autres, on lit sur le socle de la statue les lettres : T. Q. I. S.
A. G. De chaque côté du monument, se tiennent les mêmes femmes nues dont les
compositions sont partout criblées, et tout à fait à gauche, à la partie supérieure
du cadre, un demi-piédestal engagé porte les lettres : A. M. O. R. » .
Retournons l'arme et examinons l'autre face; divisée aussi en quatre compartiments. « Le premier sujet représente Le Triomphe de César, et là, sur l'application directe au César romain, il n'y a nulle indécision; car son nom, D. CESAR,
Divus Cesar, est écrit sur le char antique, à une seule roue, traîné par quatre
chevaux, dont la forme est empruntée aux médailles romaines. Revêtu d'une
armure, la tête ceinte d'une couronne, portant les cnémides, letriomphateur tient
à la main une branche de laurier. Devant lui, onporte les aigles; sur les enseignes
déployées, on lit la devise antique : S.P.Q.R. SENATUS.POPULVS. QVIRITES. ROMA.
Tousles personnages qui forment lecortège sontnus, commedans toutes les autres
compositions. Par unpartipris qui nous sembletoujours singulier,mais quiestfami
lier aux artistes du xv° siècle, au lieu de donner pour fond à la scène du triomphe,
ou le Capitole ou le Forum, le graveur a nettement représenté une tour comme
celle de Pise, visiblement hors de son axe, et avec son même degré d'inclinaison.
Près de là se dresse un de ces observatoires du moyen âge italien, tour carrée,
étroite, dont on voit encore tant d'exemples à Bologne, à Sienne et autres villes
d'Italie. Sous le sujet, on lit le mot : BENemerent. A ceux qui ont bien mérité.
Au-dessus même du mot Benemerent, séparée par une ligne malheureusement
engagée sous la garde, mais encore très visible, même dans notre reproduction,
on lit la signature de l'artiste en grandes lettres qui dépassent de beaucoup la
dimension des autres inscriptions : OPVS. HERC : ces mots sont répétés à la
même place sur l'autre face¹.
Dans la frise qui sépare ce compartimentde la composition supérieure, on lit :
FIDES. PREVALET. ARMIS., singulière devise pour celui qui a ordonné le guet-apens
de Sinigallia. « La bonne foi (Fides) est représentée sous la forme d'une statue
assise dans la niche d'un petit édicule; de chaque côté, des personnages nus semblent lui rendre hommage. »
Une dernière composition sans inscription ferme le cycle. « Un globe terrestre
repose sur une colonne brisée, un aigle étend ses larges ailes sur le monde ; une
biche repose, paisible, au pied du petit monument. Tout autour des personnages
nus dansent et jouent des instruments de musique ».
Trois monogrammes de César, identiques à ceux gravés sur la lame, des langues de feu, imprese qu'on retrouveparfois dans les armes desBorgia, qui y ont été
ajoutées au xIII° siècle et que Callixte III portait aussi dans son écusson², criblent
tout le champ; des aigles, des cornes d'abondance, des trophées y sont disposés
avec un goût exquis; à la partie supérieure, une belle composition qui semble la
reproduction d'une de ces élégantes plaquettes du xv° siècle, si à la mode dans les
collections d'aujourd'hui, fait de ce fourreau de cuirbouilli une œuvre d'art abso
lument supérieure.
Sur l'une des faces, au-dessus du petit bas-relief qui en décore la partie supérieure, l'artiste a gravé dans la frise, en beaux caractères antiques, les mots :
MATERIAM. SUPERABIT. OPVS. Tout à l'heure, celui qui acomposé l'épée, citait Suétone ; ici il appelle Ovide à son secours'.

1. FOURREAU DE L'ÉPRE DE CÉSAR BORGIA ― Musée de South Kensington à Londres
2 et 3 FOURREAUX DE MAITRE HFRCULE ― Muséed'Artillerie àParis.
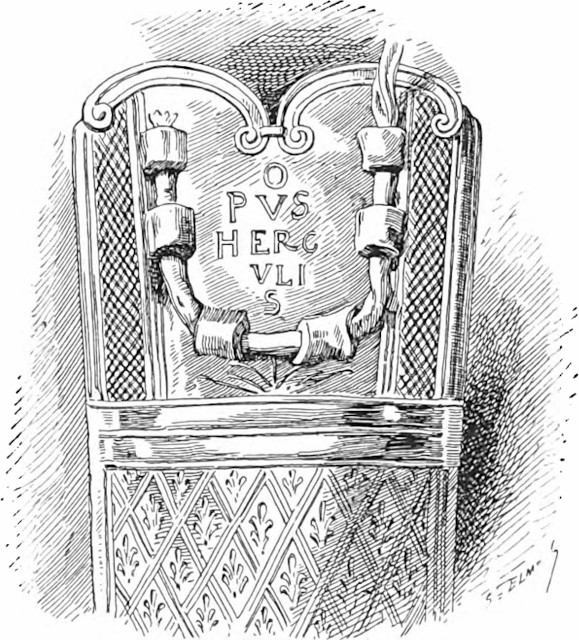
Signature d'Hercule sur un Fourreau de Cinquedea. (Musée d'Artillerie de Paris )
Le simple examen des compositions qui ornent la lame, ces allégories, ces
citations des classiques latins, Suétone, Ovide, ces vers latins de poètes ignorés
(probablement des contemporains), ce monde de nudités, ces sacrifices, ces emblèmes, tout ici révèle l'intervention d'un humaniste, d'un lettré hanté par le souvenir de l'antiquité. Si, au lieu d'être à Rome aux dernières années de la proto-Renaissance, nous étions à Florence au temps de Laurent le Magnifique, dans le
voisinage de Léon Battista Alberti, de Brunellesco, de Donatello même, où, plus
haut, dans la région du peintre Mantegna, nous pourrions nous résoudre à ne
point chercher, à côté de l'artiste qui exécute, de cet inconnu qui signe Hercule,
l'humaniste qui l'inspire. Tout artiste de ce groupe est plus ou moins lui-même
un humaniste, et ses fréquentations habituelles doublent les ressources de son imagination. Ici, ce n'est pas le cas ; un poète, un lettré (César peut-être) a suggéré
l'idée et inventé l'épée; un artiste, probablement un peintre, qu'il faudra chercher
parmi les familiers du Vatican, a réalisé les sujets inspirés par César, encore
cardinal, mais déjà hanté par des rêves d'ambition; et le graveur d'épées le
plus en vue de la région, assez habile pour être à la foi graveur, sculpteur,
dessinateur, les a gravés en creux, à l'acide, sur la lame, martelée et cannelée
par un fourbisseur ou forgeron d'épées. Un orfèvre enfin est venu, habile à
combiner les matières, à sertir dans les fines cloisons les émaux aux couleurs
variées ; et celui-ci, emmanchant la fusée, l'a fixée enfin dans une poignée digne
de la lame. Du concours de toutes ces forces diverses qui peuvent pourtant se
concentrer dans une seule main ou dans un seul atelier, — et c'est ici le cas, — est sortie l'arme qu'on a proclamée « la Reine des Épées. »
L'abbé Galiani, dans les rares notes qu'il a laissées et dans les confidences faites
a Onorato Gaetani, avait eu l'intuition de cette collaboration ; il allait même plus
loin que nous dans cette voie; car, sacrifiant l'exécution tout entière à l'invention ,
il voulait que les mots opvs. Herc. révélassent, non pas le nom du graveur, ou
celui de l'orfèvre, mais celui du poète qui avait imaginé l'arme. Partant de cette
idée, il attribuait l'invention à Hercule Strozzi, le poète ferrarais. Mais Galiani
mal renseigné sur César (nous en avons la preuve par la correspondance publiée
par MM. Lucien Perey et Maugras) et le meilleur latiniste de son temps (au dire
de Diderot et de Grimm), avait dû lire l'Epicedium de Strozzi, poème funèbre
écrit à Ferrare pour Lucrèce Borgia, à l'occasion de la mort de César. Rapprochant alors l'inscription OPVS. HERC. du nom de l'auteur, et mêlant au souvenir de
César celui de sa sœur Lucrèce et du poète favori de la cour de son mari, il avait
cru trouver là le secret de l'énigme, comme si l'inventeur avait ici le droit de primer l'exécutant. Sans parler de la rencontre de la signature de l'artiste sur un
fourreau de cuir, circonstance qui met fin au débat, ily a un point fixe : c'est la
date de l'exécution de l'arme, attestée par l'inscription César cardinal de Valence.
Or, la dernière année du cardinalat de Borgia, Hercule Strozzi n'a que dix-huit
ans, et il n'est pas à Rome, mais bien à Ferrare, où, le 6 juin 1508, on le trouvera
mort au coin d'une rue, percé de vingt-deux blessures, et probablement victime
de la vengeance d'Alphonse d'Este, le mari de Lucrèce.
Ainsi, non seulement les dates ne concordent pas, mais le milieu n'est plus le
même; si on veut trouver à côté de l'Hercule qui a gravé, le poète ou l'humouriste qui a fait l'Invenzione, il faut rester au Vatican où, nous l'avons montré
surabondamment dans notre étude sur les appartements Borgia, à défaut de
Strozzi, il ne manquait pas alors de poètes et de lettrés capables d'inspirer les
artistes . César est encore écolier à la Sapienza de Perouse quand Paolo Pompilio lui dédie son Traité de versification, et, dans la préface, fait allusion au goût
du jeune protonotaire apostolique pour la poésie. Plus tard à l'université de Pise
où il prend tous ses grades, les poètes célèbrent sa libéralité, et la caractérisent
ainsi : « Liberalitas cæsarea », enfin, lorsque son père est nommé pontife et que
lui-même, promis à de hautes destinées, vient prendre rang à sa cour, il trouve
tout un groupe de poètes et de familiers inscrits sur la liste des bénéfices ou celle
desAuditeurs de rote et des rédacteurs des brefs apostoliques,j'ai ditqueparmi eux
on distinguetout spécialementle Porcari,fanatiquedesBorgia; leur séide, le grand
prêtre et l'inventeur du culte du bœuf Borgia, celui dont le Pinturicchio illustrera
pour ainsi dire le poème dans une des chambres du Vatican, qui va dédier
son épître au jeune cardinal Ad bovem Borgia en le désignant ainsi : Dom C.
cardii Valentino. Benefactori meo primario. Après avoir lu le recueil des poésies
latines de ce Hieronimus Portius et tout en restant circonspect en matière d'affirmation, je crois doncque si on doit chercher le latiniste qui a dicté les inscriptions
gravées sur la lame et donné les sujets, c'est à lui qu'il faut s'adresser. La
pensée conçue, la forme trouvée, il faut réaliser l'exécution; si elle exige un
cerveau moins meublé, il faut que la main soit preste, et accomplie la connaissance des procédés qui permettent de dompter la matière; le rôle de l'inventeur,
du poète et de l'humaniste est fini; le rôle du graveur ou de l'aurifex (puisque
c'est même chose ici) va désormais commencer.
Le fourbisseur ou forgeron d'épées a livré la lame cannelée, bien martelée,
et de nobles proportions; poinçonnée à sa marque - une tour. -
C'est le signe
qui nous servira à le reconnaître. Le graveur d'épées (qui peut être aurifex) donnera tout son prix à la lame. Il enduit d'abord le fer d'une couche légère d'un
vernis gras, la tamponne jusqu'à ce qu'elle offre un champ bien uni, décalque sa
composition, très arrêtée, saisit la pointe acérée, égratigne la surface, et, du même
coup, entame légèrement l'acier. Les figures évoquées profilent bientôt leur élégante silhouette, les fonds sont indiqués par une série de larges hachures; quand
il incline sa lame, elles brillent déjà sous le rayon de lumière comme dessinées
par un filigrane d'argent. Il n'y a plus qu'àfixer le trait et à appliquer la dorure.
L'acide qui corrode est versé; contenu tout autour du cadre par un bourrelet de
cire vierge soigneusement relevé, il bouillonne et mord le métal en sa partie mise
à nu; voilà le trait devenu ineffaçable. Fier de son œuvre, le graveur la signe en
lettres monumentales : OPVS. HERC.; puis il essuie sa lame, la dore en plein,
au feu, avec l'or de sequin : et César passe triomphant sur son char, ceint du laurier, autour de lui on porte les aigles. Tout à l'heure c'était une lame d'acier,
l'artiste a transformé la matière : Materiam Superabit opus.
Al'orfèvre maintenant à emmancher la fusée dans la garde, afin de donner à
l'épée de César une poignée digne d'elle. Partageant les quillons au centre, là où
la main presse le fer pour mieux assurer le coup qu'elle va porter, l'habile
ouvrier réserve un champ et l'enduit d'émail bleu; en fines lettres d'argent, il écrit
d'un côté le nom de son noble client, et, de l'autre, étale l'écusson des Borgia :
les trois bandes noires sur champ d'or, et le bœuf rouge paissant l'herbe. Autour
de la fusée il fixe les plaques d'argent, les maintient par une bague de renfort, et
dispose ingénieusement dans leurs alvéoles et leurs cloisons les brillants émaux
qui vont diaprerle champ. Voilà l'œuvre achevée ; jamais arme ne fut plus personnelle et n'a mieux mérité son nom : c'est bien « la Reine des Épées ».
Voici d'abord notre Hercule gravant une lame de même module, de même
forme et de mêmes cannelures que celle de César; épée de la même région et
du même temps : une des plus belles pièces du genre; à Paris même, autrefois
appartenant à un artiste distingué, peintre et écrivain, M. Édouard de Beaumont, et classée aujourd'hui au Musée de Cluny auquel il a légué ses armes par
testament. Nous rencontrons encore Hercule à la collection Ambras, de Vienne
(Gewehrkammer-Kasten A Nº 10 du catalogue), avec une troisième épée d'un
caractère identique à celui des deux autres.
Le voici encore à Bologne, sur les tablettes d'une vitrine du Musée de la ville,
décorant trois lames portant les armes des Bentivoglio. Si on compare ces longues
femmes nues aux cheveux dénoués, aux canéphores qui offrent le sacrifice au
bœuf Borgia, dans l'épée de César, et aux longs personnages de l'épée de Beaumont, la démonstration est faite. Ici ou là, l'artiste pourra s'abandonner plus ou
moins ; lâcher son rendu ou le serrer davantage, mettre plus ou moins de tumulte
dans sa composition; mais partout le même esprit l'anime, il met en œuvre les
mêmes éléments, les mêmes emblèmes : les chevaux antiques, lafoi, lajustice,
les Flabelli, portés par les mêmes personnages nus des Triomphes. Ici et là, le
S. P. Q. R. reparaît; nous sommes à Rome dans l'antiquité, et cette couronne en
forme de trident (la même qui crible toutes les nervures des arcs doubleaux du
plafond de Pinturicchio aux appartements Borgia), portée comme un trophée par
des licteurs, reste pour nous comme une signature de cet « Hercule » encore
inconnu, dont nous rencontrons encore une autre langue de bœuf à Vienne au
Musée de l'Arsenal (N° 2077 du catalogue), lame gravée sur fond d'or et criblée
d'inscriptions latines.
Nous avions trouvé, d'un seul coup, trois de ses œuvres, à Bologne; en voici
cinq autres à Londres, fixées aux murs de l'Armeria de Sir Richard Wallace, à
Hertford-House. Ces cinq lames de Sandedei- c'était décidément sa spécialité —
avec leurs faces richement décorées, gravées sur fond d'or, portent l'empreinte
indéniable du poinçon d'Hercule, et on en jugera. L'ornementation, les sujets,
les imprese, la manière, les qualités et les défauts sont les mêmes. Partout, sur
plus de trente armes que nous avons réunies, le bœuf reparaît, partout on porte
les étendards; les acteurs sont toujours héroïques, les personnages, toujours
nus, sont toujours trop longs ; ce sont les mêmes divisions, les mêmes procédés de rendus, les mêmes médaillons dans la même architecture. Au pied du
même autel, voici le même sacrifice, le bélier, renversé sur le dos, prêt à être
égorgé. Mais , circonstance remarquable, encore qu'on ne puisse plus douter
que la gravure soit due au même artiste : ni à Paris (où il figure encore dans
la collection Spitzer et au Louvre dans les vitrines des collections des objets de
la Renaissance), ni à Bologne, ni à Vienne, ni à Hertford-House, ni à l'Armeria
de Turin, où nous le retrouvons gravant une arme pour le mari de Lucrèce
Borgia, nous ne constaterons la signature d'Hercule. Une seule fois nous l'avons
rencontrée gravée sur un fourreau de langue de bœuf, dépourvu de sa lame,
digne pendant de celui du South-Kensington , au Musée national d'Artillerie,
aux Invalides.
Un fait néanmoins est déjà acquis ; et il importe de faire approuver les conclusions premières par le lecteur qui a sous les yeux les preuves de l'identité :
Il est établi qu'à la fin du xv° siècle, il y avait, dans les environs de César Borgia,
un graveur habile (dont on connaît désormais la manière), qui de 1494 à 1498
exécutait son épée lorsqu'il n'était encore que cardinal de Valence. Cette épée,
l'artiste l'a considérée comme son chef-d'œuvre-puisqu'il l'a signée avec ostentation ;
il s'en est souvenu toute sa vie puisque, en vingt compositions
différentes il a répété quelques-uns des traits gravés sur la lame du Valentinois) ;-et enfin nous savons que ce graveur s'appelait : « Hercule ». Ces faits acquis,
jusqu'à ce que nous puissions préciser davantage, en présentant nos preuves, on
nous permettra de qualifier simplement l'artiste : « Hercule, le graveur de
Borgia » . Nous ignorons encore son vrai nom, nous ne connaissons point son
origine et nous renonçons définitivement à l'identifier avec Hercule de Pesaro
aurifex, attaché au Vatican sous Jules II dont M. Eugène Müntz a trouvé la trace
en étudiant les registres du Vatican qui lui ont fourni les éléments des volumes
Les Arts à la Cour des Papes¹.
Avant d'aborder l'interprétation des sujets gravés, voyons comment, et à
quelle occasion, César Borgia, cardinal de la sainte Église, quels qu'aient été
d'ailleurs ses goûts, l'indépendance de ses allures et son mépris de la discipline
ecclésiastique, a pu ceindre officiellement l'épée. Nous rechercherons ensuite les
raisons qui déterminèrent les Gaetani, ducs de Sermoneta, à poursuivre avec
tant d'ardeur l'acquisition de l'arme du Valentinois, et ce qu'elle représentait à
leurs yeux.
César, sorti de l'Université de Pise où il a fait ses études, et rappelé à Rome
par son père le cardinal Rodrigo, qui vient d'être élu pape (11 août 1492), constitue sa maison, on pourrait même dire sa cour. Avec plus d'assurance et plus
de droit qu'un prince neveu puisqu'il touche le trône de plus près, il s'annonce
comme une personnalité ; il faudra bientôt compter avec ce cardinal de dix-sept
ans qui reçoit les ambassadeurs, correspond avec les souverains, signe les lettres
qu'il leur adresse « Tanquam Frater », comme un prince régnant, et, encore adolescent, forme déjà un État dans l'État. L'ambassadeur de Ferrare, qui l'a vu
précisément à cette époque, et qui se sent fier d'être dans sa familiarité, nous a
laissé un croquis à la plume du jeune cardinal.
César a treize ans, s'habille en gentilhomme et porte déjà la dague de chasse,
nous pourrions le montrer portant le cimeterre oriental, et, toujours cardinal,
figurant dans une procession habillé en turc à côté de Djem ou Zizim, frère du
sultan, otage du Vatican. Se rendre en grande pompe à Santa-Maria-Della-Pace
dans un tel attirail, et dans un cortège pontifical, c'est afficher peu de rigueur
à l'égard des usages ecclésiastiques et cela prouve une fantaisie sans limite
chez le fils d'Alexandre, mais l'usage d'un glaive d'apparat fait spécialement pour
César, à ses armes, avec ses imprese, ses devises, et la mention spéciale de son
titre de cardinal n'est pas encore justifié.
Le monument que nous étudions est daté approximativement, puisque César
y est désigné parson titre de cardinal de Valence.Élu, dans sadix-septième année,
il répudiera la pourpre à vingt-deux ans, en août 1498; c'est donc aux dernières
années de son cardinalat, alors que par son âge il peut être mêlé aux affaires
publiques, qu'il faut rattacher l'exécutionde l'arme. Or, une seule occasion de sa
vie a pu jusque-là permettre au jeune cardinal de revêtirles insignes du pouvoir
temporel et spirituel. En 1497, le 10 août, à Capoue, légat du Saint-Siège, il a
procédé, aux lieu et place d'Alexandre VI, au couronnement de Frédéric d'Aragon, roi de Naples, dans des circonstances qui intéressent notre propre histoire
et qu'il faut brièvement rappeler. Charles VIII a envahi l'Italie; arrivé sous les
murs de Rome, il a réclamé la reconnaissance de ses droits sur le Napolitain.
Alexandre VI, impuissant à l'arrêter dans sa marche, lui a ouvert les portes du
Vatican. Le roi a prêté obéissance le 15 janvier 1495 ; en retour de cet hommage,
il a reçu du Saint-Père l'investiture du royaume qu'il convoitait et est parti pour
le conquérir. Bientôt cependant, une ligue puissante s'est formée derrière lui ;
Maximilien, l'Espagne, Venise et le duc de Milan, se sont unis au Saint-Siège :
dans le Nord de l'Italie, Gonzague, à la tête des alliés, peut d'un jour à l'autre
fermer les passages ; Charles VIII revient sur ses pas et entre à Rome pour la
deuxième fois. Alexandre, pour échapper à une entrevue devenue difficile à cause
de sa duplicité, a quitté sa capitale cinq jours auparavant pour se réfugier à
Orvieto d'abord, puis à Pérouse; s'il le faut, il ira jusqu'à Ancône, et demandera
même un asile à ses alliés de Venise. Lajournée de Fornoue vient rendre au pontife toute sa sécurité : Charles VIII a percé leslignes des alliés qui l'attendaient sur
les bords du Taro, désormais il marche vers le Nord, Alexandre VI peut rentrer
à Rome et lever le masque ; ses alliés les rois catholiques, avec Gonzalve de Cordoue pour capitaine, vont même reconquérir pied à pied le royaume napolitain
laissé aux mains des gouverneurs français. Le pape Borgia, dont toute la politique
se borne à enrichir les siens, conclut un marché avec Frédéric d'Aragon; en
retour des plus beaux fiefs du royaume de Naples et des plus riches bénéfices, il
accordera au roi légitime de ce pays l'investiture qu'il avait donnée hier à Charles VIII. Son fils aîné, Giovanni, déjà duc de Gandia, aurale duché de Bénévent
avec droit d'hérédité ; Lucrèce Borgia, mariée au seigneur de Pesaro, mais qu'il
vient deforcer à divorcer, épouseraun princedelamaison deNaples, Alphonse de
Bisceglie; quant à César, il recueillera de riches prébendes. Comme gage de ce
marché, le jeune cardinal de Valence ira sacrer le nouveau souverain dans sa
capitale.
On a le bref du 9 juin 1497 qui conféra à César les pouvoirs nécessaires pour
couronnerFrédéricd'Aragon; il lui enjoint de mettreun terme à tant de désordres,
d'apaiser la furie de la guerre dans le royaume ruiné par de longues discordes,
et d'y apparaître comme l'ange de la Paix « tanquam pacis angelum ». César, en
effet, couronna Frédéric à Capoue, au mois d'août de l'année 1497 (la peste régnait alors à Naples). Il remplit sa mission avec la gravité qu'il apportait dans les
cérémonies publiques et déploya ce luxe et cette libéralité qui devaient devenir
célèbres dans toute l'Italie, « Liberalitas Cæsarea » , dont plus tard nous eûmes
le spectacle à Chinon. Devant le représentant du Saint-Siègeinvesti desplus hauts
privilèges réservés au successeur de Saint-Pierre, on dut porter pour la circonstance les insignes du pouvoir spirituelet temporel ; les Flabelli, la SediaGestatoria,
le globe et l'épée. L'épée de parement que nous étudions ici, a probablement été
exécutée pour la circonstance, elle reflète dans quelques-uns de ses symboles la
pensée pacifique d'Alexandre; mais César, qui a certainement inspiré l'artiste, y
a mêlé les images de la guerre, inséparables du nom qu'il portait, etcomme le dit
l'historien de Lucrèce Borgia,il y alà comme une explosion hardie et involontaire
des secrets désirs qui l'animaient déjà.
LES GAETANI ET LES BORGIA.
Le prélat romain désigné dans le testament de l'abbé Galiani, sous le nom de
monseigneur Onorato Gaetani, appartenait à l'une de ces grandes familles de barons, originaires du Latium, qui représentaient au moyen âge le pouvoir féodal
et qui occupaient encore, au temps des Borgia, les fiefs de la campagne de Rome
et du royaume de Naples. Leurpuissance datait du temps où l'Empire était entré
en lutte avec le Saint-Siège ; depuis la soumission du César romain, ils avaient
perdu une partie de leur pouvoir, mais leurstours féodales se dressaient toujours
dans la campagne et leurs biens étaient considérables. Ils avaient des clients, des
soldats et des vassaux, de véritables armées dont ils étaient les chefs et qu'ils
mettaient souvent au service des puissances de la péninsule et même des princes
étrangers, faisant ce qu'on appelait alors la Condotta, comme capitaines mercenaires. Aux jours de conclave, leurs hommes d'armes agitaient la ville éternelle par de tumultueuses démonstrations; ils pénétraient parfois jusque dans la
cité Léonine, et leurs chefs, par leurs relations dans le Sacré-Collège, influençaient
les conclaves. Ces barons romains, quand ils n'étaient point de fidèles alliés,
étaientpour la plupart du temps de dangereux rivaux; comme il leur était indispensable de s'appuyer sur un grand pouvoir, quelques-uns d'entre eux, privés
désormais de la protection de l'empereur, s'étaient tournés vers Aragon qui régnait à Naples; d'autres, lors de la descentede CharlesVIII en Italie, s'étaientjetés
dans le parti français. Un certain nombre enfin oscillaient entre les deux puissances et se rattachaientparfois au Saint-Siège. A la fin du xvª siècle, les Colonna,
les Orsini, les Savelli et les Gaetani, étaient les plus redoutables ; et tous étaient
rivaux entre eux.
Maîtresse, dès le xm° siècle, de fiefs étendus dans la campagne de Rome et le
royaume de Naples, la famille Gaetani était divisée en plusieurs rameaux; dans
la campagne, son centre était Sermoneta, dont la tour féodale s'élève encore aujourd'hui sur les premiers étriers des Volsques bien conservée et reste l'apanage
et parfois aussi la résidence des Gaetani; ils allaient de là jusqu'à la mer et
régnaient alors sur les marais Pontins. La voie Appia traversait leurs domaines ;
ils joignaient au titre de duc de Sermoneta ceux de prince de Téano, seigneur de
Ninfa, Norma, Tivera, Cisterna, San-Felice et San-Donato. A Naples, feudataires et grands dignitaires de la maison d'Aragon, ils s'appelaient : duc de Traetto , comte de Fondi, de Caserta et de vingt autres lieux. Enfin, pour ajouter à
leur puissance militaire et à leur prestige politique, ils avaient fourni au Saint-Siège, dans la personne de Benedetto Gaetani (Boniface VIII, 1294-1303), un des
pontifes qui avaient le plus vigoureusement lutté contre l'Empire. Alexandre VI,
qui cachait toujours les projets d'agrandissement de sa famille et son népotisme
effréné sous les dehors des visées politiquesles plus hautes, déclara solennellement
dans un consistoire tenu le 1er janvier 1496, qu'il était décidé à punir l'attitude
des barons qui avaient pris parti contre l'Église lors de l'invasion du Napolitain
par Charles VIII, et, par une bulle papale, il les déclara proscrits et déchus de
leurs biens féodaux. A l'égard des Gaetani, le pontife procéda par la ruse avant
d'employer la force; depuis longtemps déjà, avec une duplicité qui était dans son
caractère, il avait attiré à lui le chef de la famille, Onorato duc de Sermoneta.
Trois de ses fils, Nicolo, Giacomo et Guglielmo, s'étaient fixés à Rome à la fin
du xv° siècle; de Giacomo, il fit un protonotaire apostolique, et lejour où celui-ci
devint chef à son tour, sous prétexte de lèse-majesté, il le fit enfermer au château
Saint-Ange où il mourut par le poison. Le fils de Nicolo fut étranglé à Sermoneta
même; quant à Guglielmo, prévenu à temps, il se réfugia à Mantoue, près des
Gonzague, et resta à leur cour épiant l'heure de la vengeance et de la revendication. Alexandre donna à ces persécutions la sanction d'une sentence juridique, et
la chambre apostolique fut autorisée à vendre les biens et les titres des Gaetani,
exécutés pour cause de rébellion. Lucrèce Borgia, par un contrat en règle passé
devant ladite chambre, fut reconnue comme ayant versé la somme de 80000 ducats
pour l'acquisition d'une partie desdits biens. Alexandre disposa aussi des terres
confisquées aux Colonna, aux Orsini, aux Savelli, aux Pojano, aux Magenza et
aux d'Estouteville. Le petit Rodrigue, fils de Lucrèce et de son second époux
Alphonse de Bisceglie, fut investi à l'âge de deux ans du duché de Sermoneta,
auquel on réunit Ninfa, Norma, Albano, Nettuno et Ardea; vingt-deux cités formèrent son domaine. Un autre enfant, Giovanni Borgia, qu'on avait fait passer
un instant pour un fils de César, mais qu'un document désigne nettement comme
le propre fils d'Alexandre VI (il était né de Julia Farnèse qui avait succédé à la
Vanozza comme maîtresse en titre), eut pour lui Népi, ancien apanage de sa sœur
Lucrèce, Palestrina, Rignano et enfin trente-six villes prises indifféremment
dans les diverses possessions baronnales. Giovanni, duc de Gandia, frère aîné de
César, eut Sessa et la principauté de Teano.
Les Borgia ne devaient pas jouir longtemps du fruit de leurs rapines; en
août 1503, à peine la nouvelle de la mortd'Alexandre VI parvint-elle à Mantoue,
Guglielmo Gaetani, chefde la famille proscrite, accourut à Rome, réunit ses partisans de la campagne et ceux du Napolitain, réoccupa Sermoneta et reprit peu à
peu les villes et châteaux qui constituaient l'ancien apanage de sa famille. Une
bulle pontificale d'Alexandre « Dudum iniquitatis filii », datée du 20 août 1501 ,
avait dépouillé les Gaetani; une autre bulle du 24 janvier 1504, adressée par
Jules II à Guglielmo, confirma dans ses mains la légitime possession des biens
qu'il avait repris par la force. L'original de ce document, conservé dans les archives du palais Gaetani, présente un certain intérêt au point de vue de la diplomatique, à causedu portrait deJules « avantlabarbe»qu'on peut opposerà l'image
connue peinte par Raphaël. Il offre aussi cette particularité qu'on voit un pontife accuser formellement son prédécesseur de cupidité, de vol et de fraude¹ .
L'arme entre leurs mains, un autre membre de la famille, Massimiliano
Gaetani d'Aragona, fut chargé de composer l'inscription et on lui remit à cet effet
le dossier trouvé dans les papiers de Galiani ; mais sa déception fut grande,
lorsqu'au lieu d'une monographie complète ou du moins des éléments nécessaires à la rédiger, il ne trouva là que trois ou quatre lignes énigmatiques et des
extraits de la « Vie des hommes illustres » et ceux de Brantôme, envoyés de
France par Mmo d'Épinay. Massimiliano eut recours à Cancellieri, auteur des
lettres à Sébastiano Campi qui plus tard ont été réunies sous le titre « Spade
celebri » , comme vers l'homme le plus apte àlui venir en aide.
« Je me suis vu, lui dit-il, dans la nécessité de demander une inscription
sur l'épée du Valentinois, si intéressante pour nous, les Gaetani, contre lesquels,
ainsi que contre les Orsini et les Colonna, cet homme pervers a employé la force,
assiégeant Sermoneta et assassinant nombre de membres de notre famille..., je
vous prie donc de jeter un coup d'œil sur ce queje vous envoie. » L'inscription,
banale et peu renseignée, ne fut jamais gravée; le successeur du duc Francesco,
au lieu de déposer l'arme dans la Rocca de Sermoneta qu'il visitait rarement,
préféra la garder à Rome où les générations qui se sont succédé l'ont conservée jusqu'à aujourd'hui.
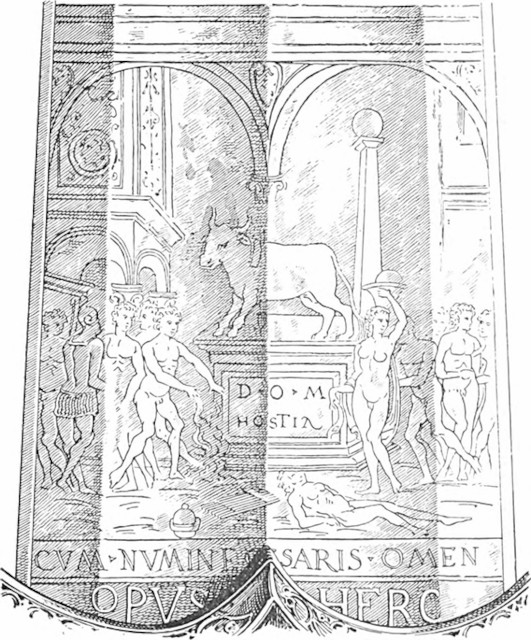
Le Sacrifice au Bœuf des Borgia.
Sans interpréter ce qui prête au moins au doute sinon à l'erreur, nous nous
attacherons à commenter les compositions et les emblèmes, et, pour permettre au
lecteur de nous suivre sans effort, nous allons faire passer devant ses yeux, dans
une dimension qui lui permettra d'en étudier le détail, chacune des compositions
dont nous avons déjà montré l'ensemble. Au-dessous de la devise cum numine,
Cæsaris omen, qui sert de frontispice à tous les sujets, on lit, sur le piédestal où
se dresse le bœuf Borgia : D. O. M. HOSTIA, sacrifice à Dieu très bon, très grand.
C'est une formule qui est encore appliquée de nos jours ; à la fin du xvº siècle,
en Italie, elle était une application toute récente à la divinité, de l'invocation
adressée par les païens à Jupiter Capitolin : Jovi. Optimo. Maximo. Ce n'est
guère que dans la seconde moitié du xv° siècle qu'on a substitué Deo à Jovi, dans
les inscriptions; les chrétiens, dès lors, empruntèrent leur formule aux païens et
la gravèrent au front des temples. Cette singulière confusion d'idées, créée par le
retour à l'antiquité des poètes et des humanistes de la Renaissance, a son parallélisme dans les représentations plastiques du temps. Au-dessous du sacrifice de
la messe et des Pieta des peintres italiens, sur les Baisers de paix, sur les Plaquettes, œuvres délicates des sculpteurs de cette admirable période de l'art, on
représente souvent un sacrifice antique, l'égorgement de la victime, les aruspices
interrogeant les entrailles ; ici, sur l'autel dédié à Dieu immortel, au lieu du symbole religieux qui pourrait rappeler le Dieu des chrétiens, l'artiste dresse le bœuf
héraldique de l'écusson des Borgia, et, pour mieux caractériser le milieu, il
représente, derrière l'autel, la pyramide détruite par le pontife pour ouvrir la
grande voie qui va du Môle d'Adrien à la Basilique¹.
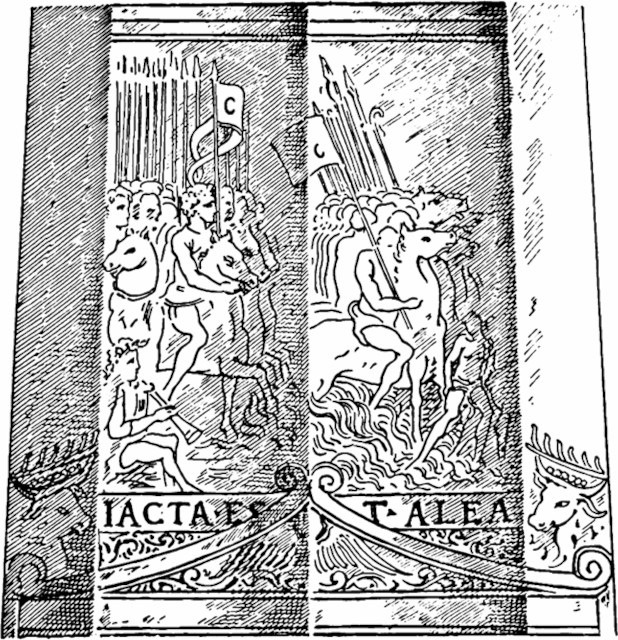
Le Passage du Rubicon.
1. Dans le volume : RIMINI.- Les Lettres et les Arts à la Cour des Malatesta.- Un Condottiere auXVe Siècle.- J. Rothschild, éditeur, Paris.
Au-dessus du passage du Rubicon, le graveur de Borgia a dessiné la statue de
l'Amour, un bandeau sur les yeux. Sur le socle on lit les lettres :
T. Q. I.
S. A.
G.
De chaque côté du petit monument se tiennent des femmes nues qui semblent
rendre hommage à Cupidon; à gauche, à la partie supérieure des cadres, on
remarque un piédestal engagé portant les lettres :
A
M O
R
L'Amour est le sujet familier de la Renaissance, et il n'y pas de conclusion à
tirer de la présence du dieu qu'on invoque ici ; le problème est évidemment dans
l'interprétation des six lettres qu'on lit sur le piédestal de la statue. On a trouvé
dans le dossier laissé par l'abbé Galiani une feuille volante où sont tracées les
lignes suivantes : Tibi. Quem. Ille. Sextus. Alexander. Genuit... c'est probablement la dédicace de celui qui a fait le don de l'épée et qu'on suppose avoir été... »
Ici s'interrompt le manuscrit, et c'est dommage. Encore que ces lignes trouvées
dans le dossier ne soient pas de la main même de Galiani, il est évident qu'elles
prétendent offrir une solution et reflètent sa pensée. L'abbé sera parti de cette
idée que leTsignifiait Tibi, et que l'inscription cachait une dédicace; il appliquait
dès lors à chaque initiale le mot qui pouvait compléter le sens qu'il entendait
donner : A toi fils d'Alexandre VI. Mais, sans parler du peu de concordance
qu'il y aurait entre l'idée de l'amour et le sens dédicatoire, le Ille est suspect, et
surtout l'apostrophe est trop directe et trop dépouillée d'artifice. On sait bien que
les scrupules d'Alexandre à l'égard de l'opinion ne l'embarrassent guères, mais
nous ne pouvons pas oublier que si César, devenu duc des Romagnes, est désormais son fils avoué, le jour où il lui conférait la plus haute dignité de l'Église, le
pontife réclamait des cardinaux Orsini et Pallavicini la rédaction d'un acte destiné à faire disparaître la tache originelle, et où le nom de sa mère, la Vanozza,
est cité comme celui d'une femme régulièrement mariée.
Ces cinq lettres initiales resteront pour nous une énigme; elles cachent certainement une pensée qui hantait le cerveau de l'artiste et qu'il croyait aussi présente à l'esprit de tous qu'au sien propre, au moment où il l'exprimait. Le secret
de l'interprétation est perdu pour nous qui ne vivons plus dans le même milieu,
et l'allusion, transparente alors pour tous, devient aujourd'hui un problème.
L'Antiquité, le Moyen Age et la Renaissance nous offrent des analogies très nombreuses dans les marbres, les bronzes, les médailles et les miniatures, et on peut,
parmi tant d'autres, citer deux exemples de solutions célèbres parmi les archéologues et les épigraphistes. La première estempruntée à la Renaissance, la seconde
s'applique à l'Antiquité.
Au revers de la médaille due au plus célèbre des médailleurs et peintres
de la Renaissance italienne, médaille qui représente ses propres traits ; Vittore
Pisano, dit le Pisanello (1380-1455), a écrit les lettres suivantes : F. S. K. J. P. F. T.
Depuis Maffei et Mazzuchelli jusqu'à nos jours, on avait vainement cherché
l'explication de cette inscription, et cela sans doute parce que, d'accord avec la
raison, on la demandait au cercle des faits, des circonstances et des idées qui se
rapportaient au peintre et médailleur véronais. Un savant archéologue français,
M. Froëhner, partant de ce point que toutes les légendes des trente-six médailles
qui sont incontestablement dues au Pisanello, sont en langue latine, fut frappé
de voir que le K (lettre qui n'existe point dans cette langue) constituait ici une
anomalie et une exception, — à moins que le mot dont cette lettre était l'initiale,
signifiât, dans l'esprit de l'artiste : Karus, Karitas ou Kalendæ (trois mots que
les copistes des manuscrits latins du xv° siècle ont écrit habituellement de la
sorte). Or, si on appliquait à la troisième des sept lettres initiales le sens karitas,
le chapelet se défilait sans effort : Fides. Spes. Karitas. Justicia. Prudentia. Fortitudo. Temperantia. Ici, l'artiste faisant acte de foi, avait donc voulu désigner les
sept vertus cardinales.
Le second exemple est plus piquant encore et la solution qu'il offre est plus
inattendue. Une monnaie de la ville antique de Sulmona porte, à son revers, sur
le champ, les lettres suivantes : s. M. P. E, dont le sens, évident alors pour tous
les latins et toute la région, s'était perdu avec le moyen âge et restait hier encore
une énigme. Le docte directeur du Musée Correr de Venise, Vincenzo Lazari,
enlevé trop tôt à la science, relisant un jour dans Ovide l'hémistiche Sulmo
Mihi Patria est..., fut frappé de l'analogie, et, rapprochant le passage du revers
de la monnaie, fit jaillir la solution. Ces bonheurs-là n'arrivent qu'aux archéologues de race; Longpérier et Lenormand les ont aussi connus. L'artiste, cette
fois, ayant à graver une inscription sur une monnaie de la ville qui fut le berceau
du poète des Métamorphoses, avait eu la pensée de lui rendre hommage, et son
allusion retentit encore dans la postérité.
Pour revenir à notre sujet, c'est probablement dans les citations courantes
alors, les vers en vogue, vers classiques ou poésies latines contemporaines,
dans les anthologies, les chansons d'amour et les inscriptions en l'honneur des
Borgia, qu'il faudra chercher la solution de ce problème. Quelques années
auparavant on l'aurait demandé au « Songe de Poliphile », au « Dittamondo »,
au chansonnier de Justo di Conti « La Bella mano » . A la fin du xvº siècle, à
Rome, dans l'entourage d'Alexandre VI et de César, il nous semble encore que
c'est à Hieronimus Portius, l'auteur de l'épître « Ad Bovem Borgia » ou à quelqu'un des lettrés qui hantaient le Vatican, qu'on devra s'adresser.
Une soudaine inspiration, lehasard
d'une lecture, une longue
pratiquedumilieu ambiant
et la puissance del'idée fixe
appliquée au sujet,peuvent
un jour ou l'autre amener
leur révélation ; elle nous
échappe encore.
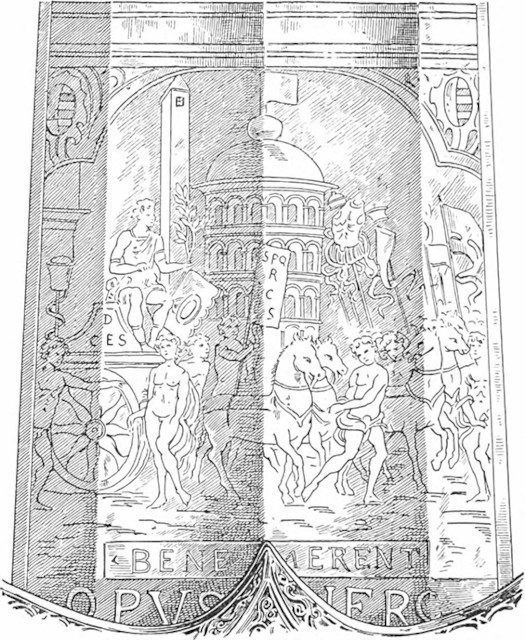
Le Triomphe de César.
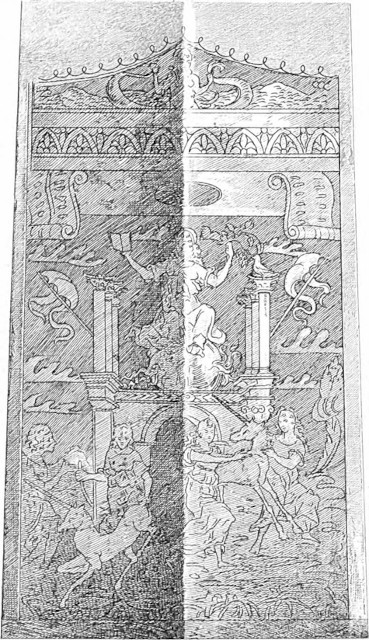
ÉPÉE DE MAITRE HERCULE ― Collection de M Ressman
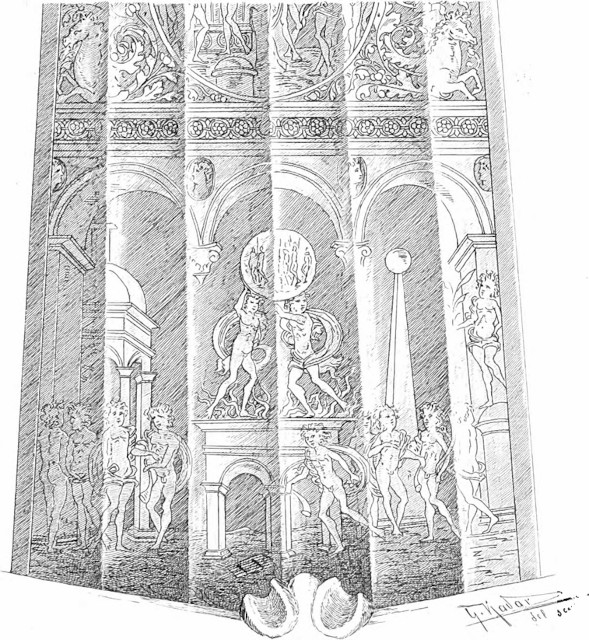
CINQUEDEA DU MAITRE HERCULE ― Tour de Londres
Disons donc dans quelles circonstances, le 17 mars 1500, César, se donnant en
spectacle à la ville de Rome tout entière, représenta « le Triomphe de César », en
une série de tableaux vivants où il figura lui-même, sous les traits du héros
romain, reproduisant plastiquement la composition gravée sur son épée quelques
années auparavant; si bien qu'on serait presque tenté de dire qu'il y a de l'après
coup dans la représentation elle-même.
Depuis deux années, le fils de Borgia a renoncé à la pourpre pour ceindre
l'épée ; son coup d'essai comme capitaine fut un coup de maître ; il a accompli le
premier acte de la soumission de ces seigneuries des bords de l'Adriatique qui,
peu à peu, avaient échappé à lasuzeraineté du Saint-Siège, et chacun de ces États
formera un des fleurons de sa couronne de duc des Romagnes. Le26 février 1500,
il rentre à Rome en vainqueur. Si on lit les dépêches qui rendent compte des
fêtes données à cette occasion, on sent, sous la joie du pontife dont la politique
triomphe, l'ivresse du père de famille qui voit dans son fils un capitaine vainqueur
Les cardinaux Farnèse et Borgia ont reçu César tête nue, en dehors de la porte
del Popolo, suivis des ambassadeurs des puissances. En avant du cortège marchent deux hérauts, l'un aux armes de France (il a déjàépousé la sœur du roi
de Navarre, Jean d'Albret), l'autre aux armes du duc de Valentinois ; mille
hommes de pied, cent estafiers et cinquante gentilshommes lui servent d'escorte:
sa cavalerie, commandée par Vitellozzo, ferme la marche. Le duc a donné la
droite aux cardinaux ; il traverse la ville, inaugurant la voie nouvelle qu'Alexandre VI vient d'ouvrir du pont Saint-Ange au Vatican. « Ilportait cejour-là, dit
une dépêche, une jaquette de velours noir qui tombait jusqu'aux genoux avec un
simple collier d'or au cou, l'ordre de Saint-Michel qu'il avait reçu tout récemment
et dont il était fier. Blond et beau, ilfaisait l'admiration des heureuses mères et
des belles jeunesfilles accoudées aux hautesfenêtres. » Le pape attendait son fils,
assis sur le trône ; celui-ci s'avança gravement jusqu'au seuil, faisant unerévérence
cérémonieuse; Burckardt, qui l'accompagnait, en raison de ses fonctions de
maître des cérémonies du Vatican, l'entendit remercier son père de toutes les
faveurs qu'il lui avait accordées pendant son absence ; il s'exprimait en langue
espagnole, selon l'habitudedes Borgia quandils parlaient entre eux : Alexandre VI
lui répondit dans la même langue. En face l'un de l'autre, le Saint-Père et le
capitaine général destroupes de l'Église gardaient une attitude pleine de solennité,
mais quand Alexandre vit son fils s'incliner pour lui baiser les pieds, ses entrailles de père s'émurent ; « la carnalita lo vinse, dit Alvisi, » dans son César
Duc des Romagnes, etle pape, le relevant avec une sorte d'emportement, le pressa
sur son cœur.
L'ambassadeur vénitien rendant compte de cet épisode au Sénat, écrit que le
pape pleurait et riait en même temps : Lacrimavit et rixit a uno tracto. Le
17 mars, on fit César gonfalonier et il reçut dans Saint-Pierre, des mains mémes
du pontife, les insignes du commandement, le berret, le bâton et le gonfalon. Il
eut aussi la rose d'or ; par un privilège de sa charge, le maître des cérémonies,
l'historien du Diarium, reçut même en don ce jour là, la veste de brocard d'or
que César avait portée. Le soir du même jour, onvit partir de la place Navone,
où ils s'étaient groupés, douze chars dont l'ensemble figurait le Triomphe de
César et le Passage du Rubicon. Borgia siégeait en César romain sur le dernier
char. Le cortège, escorté de troupes de cavalerie et d'infanterie, arriva jusque
devant les fenêtres du Vatican en prenant la voie nouvelle et, comme le pape « se
repaissait merveilleusement de toutes ces chimères » , il voulut qu'il repassât une
seconde fois sous ses yeux; de sorte que son fils « afin que la copie n'allât point
sans son modèle, » dit un historien du temps, parut une seconde fois devant la
foule.
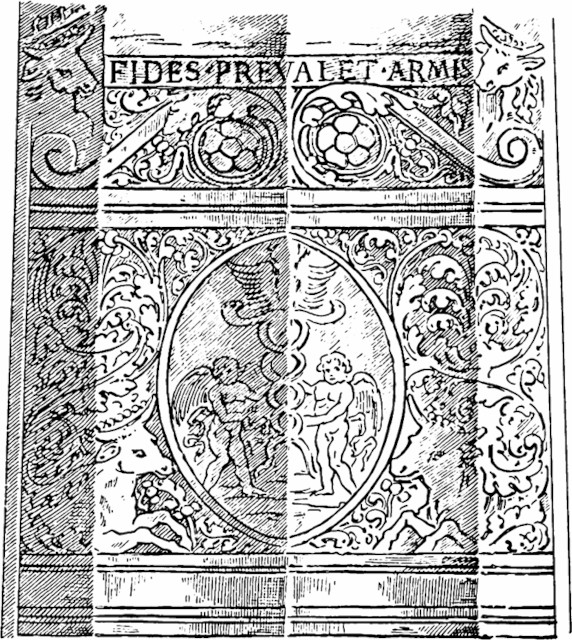
La Pax Romana.
Dans la frise qui sépare ce compartiment de la composition supérieure, on
lit : FIDES. PREVALET. ARMIS. « La bonne foi est représentée sous la forme d'une
statue assise dans la niche d'un petit édicule; de chaque côté, des personnages
nus semblent lui rendre hommage ». C'est une devise qu'on ne s'attend guère à
voir figurer sur l'épée de celui qui, ayant convié ses capitaines à Sinigallia sur
la foi destraités, les fera tous mettre à mort ; mais César, dans sa correspondance,
invoque souvent la bonne foi, et ici, au couronnement de Frédéric, il faut se
rappeler qu'il cimente l'alliance avec Aragon.
Une dernière composition ferme le cycle, etquoiqu'elle soit dépourvue d'inscription, sa signification n'est pas douteuse. « Un globe terrestre repose sur une
colonne brisée, et l'aigle symbolique de l'Empire et du pouvoir étend ses larges
ailes sur le monde. Une biche est couchée au pied du petit monument. Tout
autour, des personnages nus dansent etjouent des instruments ». La biche, image
de la douceur etde l'innocence, rapprochée de l'idée du pouvoir et de la domination du monde, symbolise la paix romaine, PAX. ROMANA... Sous le règne de la
paix et de la concorde, on se livre à la culture des arts, à l'allégresse et à lajoie
exprimées par les joueurs d'instruments.
C'est encore un symbole de paix et d'alliance que nous offre la composition
qui orne la partie supérieure du fourreau, sous la forme d'une plaquette pleine de
caractère, au-dessus de laquelle l'artiste a gravé la citation d'Ovide : Materiam
superabit opus.
La figure nue qui se dresse sur le piédestal tient à la main une branche fleurie, et on immole un bélier au pied de l'autel. Le sacrificateur a lié la victime, le
vase destiné à contenir le sang est renversé sur le sol, les canéphores pratiquent
les rites. Autour de la statue on porte les hastes et les attributs. Toute la partie
ornementale qui décore les deux faces de la gaine s'inspire encore de la personnalité de César ; le monogramme gravé sur la lame est répété trois fois sur son
fourreau, un semis de quatre flammes renversées, une des imprese des Borgia,
couvre tout un côté du champ, et des trophées guerriers, suspendus à des masques de Gorgone ailée, affirment encore l'idée belliqueuse.
Après de tels développements, on reconnaîtra qu'il ne fallait pas séparer ici
la question d'art et d'exécution de la question historique et documentaire, qui
font l'une etl'autrele prix du monument que nous venons d'étudier. S'il n'y a
pas une logique rigoureuse dans la disposition des sujets, la forme s'ajuste parfois exactement à la pensée, et quelques-uns des maîtres de l'histoire contemporaine n'ont pas hésité à le reconnaître. Comme dans toutes les œuvres du xv° siècle italien, l'artiste passe des idées les plus étroitement liées au sujet à l'expression
personnelle de sa pensée du moment; à peine vient-il de citer cette grande parole
qui retentit àtravers les siècles : ALEA. JACTA. EST., qu'on le voitinvoquer l'Amour
et mettre en œuvre un cliché banal de la Renaissance. Nous persistons à dire qu'il
y a là un écho directde la pensée de César Borgia, de Borgia jeune, prédestiné
par la force de son idée fixe et son génie infernal, au rôle extraordinaire qu'il se
croyait capable de jouer unjour, et qu'il n'aurapas rempli jusqu'au bout. Quand,
selon le mot de F. Gregorovius, le fils de Borgia exprimait sur son épée « les
pensées qui bouillonnaient déjà dans son cerveau », cadet de famille, voué à
l'Église, il puisait la certitude de sa grandeur future dans son audace démesurée,
dans sa confiance invincible en lui-même , et dans la pensée nettement arrêtée
d'aller jusqu'au crime pour supprimer tous les obstacles. C'est ce qui donne à
quelques-unes des inscriptions et des représentations gravées sur cette lame, un
caractère de fatalité qui fait de « la Reine des épées », un document historique
qui pourrait être l'œuvre d'un voyant, si on ne sentait César lui-même derrière
l'artiste qu'il inspire.
PREUVE DE L'ATTRIBUTION DE L'ARME.
Du simple rapprochement des trois gaines de cuir repoussé que nous sommes
parvenu à réunir, et de leur comparaison avec l'épée de César, jaillira la solution
vainement cherchée depuis l'abbé Galiani. Cette solution, nous la devons au
parti que nous avons pris d'interroger les monuments du même temps et du même
genre dans la plupart des cabinets d'armes de l'Europe, et nous ne regrettons
point ceslongues investigations ; maisnous étions allé chercher bien loin, àVienne,
à Pesth, à la tour de Londres, dans les collections de Hertford-House et jusqu'à
Tsarskoé-célo, les preuves que nous devions rencontrer à Paris même, dans une
des vitrines du Musée national d'Artillerie, aux Invalides.
Si on rapproche les gaines que nous publions ici du fourreau du Kensington
et de sa lame, et si on scrute avec soin, pour les comparer, les sujets gravés ou
sculptés et les détails de l'ornementation de ces mêmes œuvres du même maître,
dont nous sommescertainsdésormais, puisqu'ellessontsignéesd'unefaçon éclatante,
OPVS. HERCVLIS, l'identité entre la pièce signée et celles qui ne le sont pas semblera
incontestable. Sur ces trois gaines d'épées courtes ou Sandedee, deux figurent au
Musée d'Artillerie, et celle du milieu (non terminée comme on s'en convaincra en
regardant la partie supérieure simplement esquissée) appartient à l'épée de César.
Nous aurions même pu en produire une quatrième qui figure à notre dossier et
provient de la célèbre collection Basilewski, aujourd'hui installée à l'hermitage
de Saint-Pétersbourg. Ici et là, on retrouvera les mêmes éléments (appropriés
naturellement selon le but et la place), le même Triomphe et, aux mains du même
guerrier sur le même char, traîné là aussi par des licornes, la même branche
d'olivier d'une dimension démesurée. Sur ces deux fourreaux de différentes
origines, figurent deux sacrifices, et, sur les mêmes autels, s'élèvent deux
statues nues, autour desquelles s'agitent les mêmes personnages nus aussi, toujours trop longs (ce qui est pour tous les amateurs la vraie signature de l'artiste) et portant les mêmes attributs antiques, des cornes d'abondance, des
hastes, des trophées et des drapeaux. Et ces mêmes sujets, ces mêmes symboles,
ces mêmes personnages, on en constate aussi laprésence sur les lames de Bologne, celles d'Hertford-House, celles de Vienne, celles de Turin, celle de
M. Spitzer, celles de la collection du prince Frédéric-Charles à Berlin, comme
sur l'épée de M. E. de Beaumont aujourd'hui au Musée de Cluny et surcelle de
Borgia.
L'aigle impériale de César s'étale sur le fourreau de son arme, les ailes
ouvertes entre deux flambeaux (les flambeauxallégoriquesdu poème de Lucrèce);
dans celui du Musée d'Artillerie, l'artistey substitue le bucrane, et dans les autres
il remplace le symbole impérial (qui chez César avait une signification directe)
par le phœnix encadré ici dans des cornes d'abondance pour avoir la même
silhouette et le même motif. Sur trois fourreaux enfin, on retrouve à la même
place (à la pointe de la gaine) les mêmes trophées, le même chapiteau faisant
console, destiné à porter, dans la même pose, dans la même fonction, un personnage, différent d'âge et d'allure, mais qui ramène les mêmes enroulements de
feuillages. A défaut de la circonstance définitive de la signature qui dispenserait
d'insister davantage, comme dernière preuve d'identité nous signalerons parmi
tant d'autres, le masque de Gorgone ailée qui, figurant sur le fourreau du Musée
d'Artillerie de Paris, reparaît deux fois, identique, sur la gaine du South-Kensington où l'artiste accroche, comme à une patère, les beaux trophées d'armes
qui terminent la gaine.
Partout c'est le même goût, le même esprit, le même temps, les mêmes éléments ; et comment pourrait-il en être autrement, puisque c'est la même main
qui exécute : en effet, si nous retournons le fourreau du Musée d'Artillerie de
l'hôtel des Invalides de Paris, nous y lirons la signature de l'épée de César, non
plus mutilée cette fois, cachée sous la rouille et engagée sous les quillons ; mais
gravée avec une insistance visible, s'étalant dans un cartouche spécial, à la place
d'honneur, et proclamant que l'œuvre est bien celle d'Hercule : OPVS. HERCVLIS.
Ce qu'il fallait démontrer. Ce beau fourreau de cuir repoussé, un
des plus beaux qui existent avec celui de l'épée de César, qui nous a fourni la
preuve de l'identité du maître Hercule, est entré dans les collections du Musée
d'Artillerie au commencement du siècle; il a été rapporté des guerres d'Italie par
un simple soldat qui, l'ayant trouvé vide, en avait fait son fourreau de baïonnette.
TRAITS CARACTÉRISTIQUES DU MAITRE.
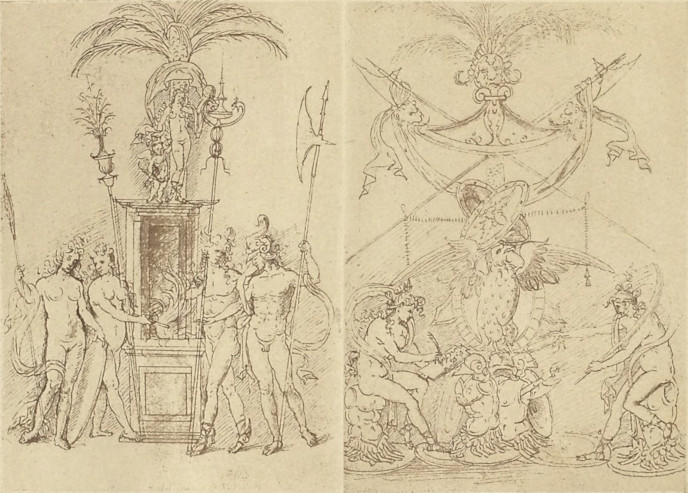
DESSINS POUR LAMES D'EPEE ATTRIBUÉS A HERCULE
Cabinet des Estampes de Berlin
Voici pour le peintre et le sculpteur , facilement reconnaissable à tant de
traits caractéristiques; l'ornemaniste est plus simple, plus vraiment classique, et
on le reconnaîtra facilement encore alors même qu'il bannira la figure humaine
de sa composition, car ses éléments sont peu variés : la feuille d'acanthe, le lierre
antique, la ciguë, l'ache et le persil, ramenés à la forme sculpturale concrète, sont
ses éléments préférés. Les consoles, les cartouches, les écus et les médaillons
imités de l'antique, jouent un grand rôle dans ses dispositions avec les guirlandes, les aigles, le phénix, la corne d'abondance, les flambeaux, image de la
vie, empruntés au poème de Lucrèce, et les trophées pris aux parois des arcs
antiques ; il ne manquera même jamais de décorer de ces emblèmes l'extrémité
d'une gaine dont le champ va en se rétrécissant suivant la longueur de la lame.
Unpoint capital estànoter : ila dû connaître aussi les grands typographes vénitiens,
et on serafrappé si on compare telle ou telle planche de ses œuvres à la première
page de l'Hérodote de 1494, imprimé à Venise par Jean et Gregorio de Gregoriis.
Tous les traits que nous signalons, propres à tout un ensemble d'œuvres
éparses çà et là dans les Musées et les collections d'Europe, serviront au lecteur
à reconnaître le maître, à grouper ses œuvres, à lui constituer son individualité,
comme ils ont été un guide infaillible pour nous-mêmes. Il n'y a plus lieu pour
nous de continuer l'enquête à ce sujet; elle est loin d'être complète, elle est
cependant concluante; le lecteur, dans le milieu où il évolue, pourra la poursuivre
dans la mesure de l'intérêt qu'il attache à un tel sujet; il nous suffit d'avoir
groupé une trentaine de lames et quelques fourreaux, offrant plus de cent compositions dues à coup sûr au même artiste. Nous croyons qu'en présentant ici les
plus importantes d'entre elles et en nous appuyant sur ces reproductions pour la
démonstration de leur identité réciproque, aucun doute ne subsistera plus sur
leur attribution au même maître.
Désormais, en quelque point du monde que parvienne cette démonstration
qui aura sa destinée, comme tout ce qui est écrit, le lecteur pourra à son tour
fixer une attribution aux autres œuvres restées anonymes, et compléter ainsi le
catalogue du maître que nous allons établir d'une façon sommaire.
ESSAI DE CATALOGUE.
COLLECTIONS DE PARIS.
Le Musée du Louvre s'est enrichi en 1890 d'une cinque-dea à lame gravée
sur fond d'or¹ aux armes du marquis de Mantoue; elle figurait à l'Exposition
rétrospective de la Ville de Tours où elle a été reconnue par M. Molinier, attaché
à la conservation des collections de la Renaissance.
La Collection du baron Adolphe de Rothschild possède une cinque-dea à lame
gravée sur fond d'or aux armes des Brancaleoni avec la devise TVITVR.
La Collection Spitzer si riche par ailleurs compte aussi une épée courte du
maître avec inscriptions et compositions multiples.
COLLECTIONS DE LONDRES.
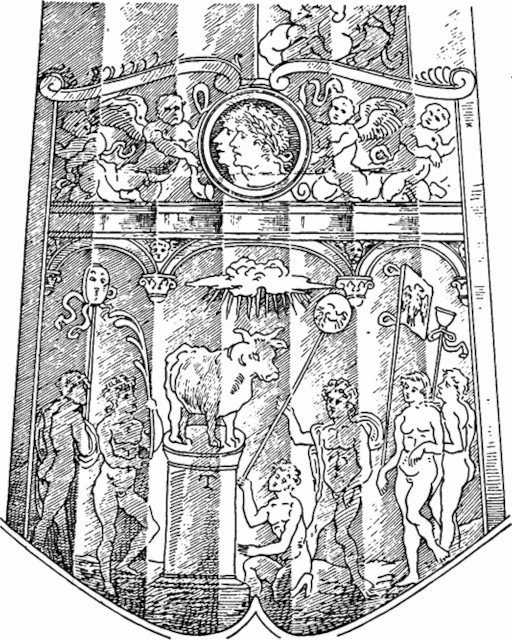
Sacrifice au Bœuf Borgia.- Cinque-dea de la Collection de Hertford-House.
COLLECTIONS DE VIENNE.
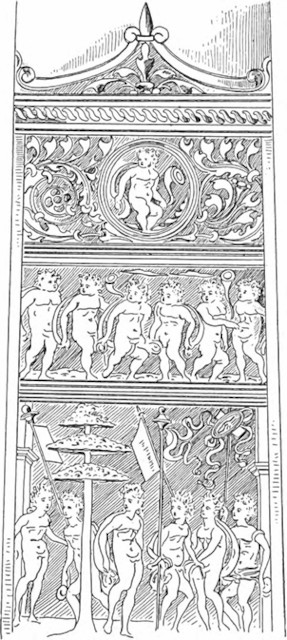
Stocco Italien xve Siècle du Maître Hercule.
Collection Ambras de Vienne.
(Communiqué par le Dr Schneider).
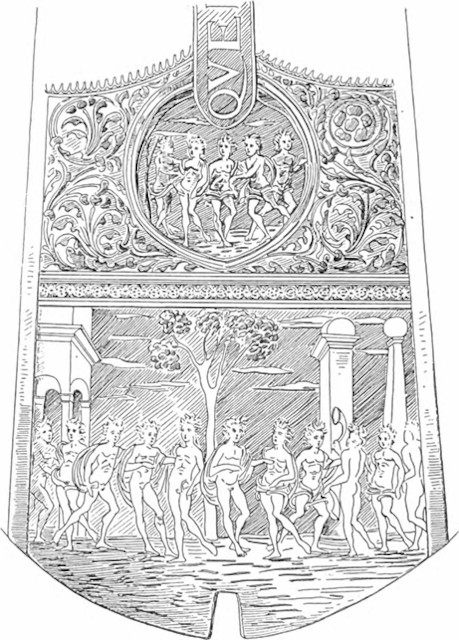
Cinque-deaà l'Arsenal de Vienne.
(Communiquée par M. le Dr Schneider,
Conservateur du Cabinet Il et Rl des Antiques.
COLLECTIONS DE PESTH.
COLLECTIONS DE BERLIN.
COLLECTIONS D'ITALIE.
La célèbre Armeria de TURIN, au milieu de trois lames courtes gravées en
possède certainement une de l'atelier du maître; celle dont la poignée est ornée
de nielles aux armes d'Alphonse, duc de Ferrare, le mari de Lucrèce Borgia.
COLLECTIONS DE LA RUSSIE.
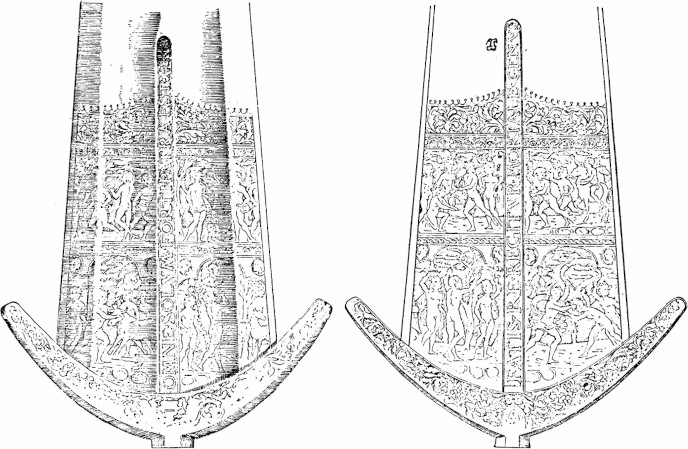
Cinque-dea du Maître Hercule au Musée de Pesth.
Cinque-dea. Collection du Musée national de Pesth.
(Communiqué par M. Hampel, Conservateur )

Frise d'une Cinque-dea du Maître Hercule. (Musée de Bologne)
Parmi les nombreuses compositions dont sont ornées les lames que nous attribuons au maître Hercule, nous avons choisi pour les reproduire celles qui nous
semblent les plus caractéristiques de sa manière, et celles dont les allégories, l'esprit, la forme et les éléments décoratifs confirment mutuellement leur authenticité. Dans une de nos planches hors texte, nous avons rassemblé l'une des
faces de chacune des deux œuvres suivantes : la belle épée vénitienne de la collection Ressman, et celle de la Tour de Londres.
Il est singulier que quelques-uns des plus grands collectionneurs de ce
temps-ci, les mieux informés au sujet des riches spécimens des dépôts de
l'Europe, ayant tenu dans la main l'épée de Borgia, n'aient jamais établi de comparaison entre cette dernière et le caractère de l'ornementation de la lame de
l'épée vénitienne de M. Ressman. L'attribution nous est personnelle; ceux-là
mêmes qui ont manié l'arme, et le collectionneur qui la possède aujourd'hui, ont
pu regarder notre affirmation comme gratuite ou aventurée; mais tout doute va
s'effacer en face de la confrontation qu'il nous est permis d'établir, et dont le
lecteur sera le juge. Outre que les sujets allégoriques, les architectures, la forme
allongée des figures, les détails et éléments de l'ornementation sont identiques en
bien des points avec ceux des compositions de l'épée de César, on verra se
dresser au milieu du champ sur lequel l'artiste a gravé Vénus et Vulcain, cette
sorte de Tempietto, guérite bizarre surmontée d'un dôme, qui revient cinq fois
dans les compositions dont sont ornées les lames qui figurent au catalogue.
Adroite de ce monument, nouvelle preuve, s'élève la pyramide allongée surmontée d'une boule, qui semble être encore l'une des signatures du maître, tant elle
revient fréquemment dans ses œuvres. (Voir notamment l'épée de César. ― Voir
la lame de la tour de Londres. ― Voir celle de l'Arsenal de Vienne et celle du
Musée de Berlin). Les nuages étranges, en forme de dents de scie, particuliers à
Hercule, se découpent sur les hachures qui forment le fond du ciel, et la frise
qui ferme le champ est butée aux deux tranchants de la lame par deux consoles
en saillie tout à fait caractéristiques du maître. Sur la face de l'épée Ressman que
nous avons reproduite, la licorne, les étendards, l'architecture, la facon d'indiquer les terrains et le ciel : tout nous révèle encore la manière du graveur,
l'identité est complète.
La cinque-dea du prince Frédéric-Charles,signée déjà par latour de Pise, nous
montre encore la pyramide de Cestius, les motifs d'architecture familiers au
maître, sa façon de détacher les lettres d'une inscription qu'il emprunte aux stèles
et aux autels antiques, et enfin, les dispositions habituelles de son médaillon
central porté par des petits génies, autour duquel s'enroulent des feuillages.
La lame de la tour de Londres, elle, se signe par ses architectures, ses longues
femmes nues auvisageeffaréportant des cornes d'abondance, ladisposition de ses
trois arcs suspendus dans le vide, reliés les uns aux autres par des chapiteaux et
par cette éternelle pyramide de Cestius qui, sous le poinçon du maître, devient
un élément dontil abuse, mais qui nous sert à affirmer son identité. Les preuves
abondent encore dans les huit compositions réparties sur les quatre divisions de
ces deux faces ; il n'y en a pas une qui ne porte un ou plusieurs des éléments essentiels caractéristiques ; ils s'entassent, se superposent, et crient le nom du maître,
sans parler encore d'unTriomphe analogueà celui d'un des fourreaux du Musée
d'artillerie de Paris, et d'un signe particulier dont la signification m'échappe
toujours : les trois lettres ET Q, que je retrouve cinq fois dans cinq lames différentes
disposées de la même façon, et qui ont longtemps exercé sans succès la patience
de l'abbé Galiani.
Parmi les nombreuses lames decinque-dea qui figurent dans les collections de
Sir Richard Wallace, l'une de celles que nous reproduisons a unprix particulier
pour nous, car elle nous montre encore (hors de propos d'ailleurs) le sacrifice au
bœufBorgia ou au bœufApis de lalame de César.
Nous n'insisterons pas davantage; toutes ces compositions émanent du même
cerveau, toutes ces lames sont de la même main; ce sont les mêmes éléments, le
même esprit, les mêmes défauts et les mêmes qualités, les mêmes manies et les
mêmes habitudes; cela se passe dans le même monde, dans la même région, dans
le même milieu et dans le même temps; personne ne se refusera à voir là des
œuvres du même maître.
LES DESSINS DU MAITRE HERCULE AU CABINET DES ESTAMPES DE BERLIN.
A l'époque où, préoccupé de découvrir à quel artiste on pouvait attribuer
l'arme de Borgia, nous visitions les musées et collections d'Europe qui pouvaient
nous présenter des armes similaires, M. Louis Courajod, conservateur adjoint
du Muséede la Renaissance au Louvre, auquel on doit tant d'ingénieux travaux
de restitutions basées sur des observations d'une rare acuité et sur un diagnostic
très sûr, nous signala au Cabinet des Estampes de Berlin un album où, au milieu
d'un grand nombre de dessins attribués au Bambaja, le célèbre artiste du tombeau de Gaston de Foix, figuraient quelques autres dont la forme, le caractère
et la nature des compositions rappelaient, selon lui, les gravures des lames du
maître Hercule dont il connaissait le dossier. La comparaison de nos photographies, envoyées à l'honorable docteur Wilhelm Bode, vice-directeur du musée
de Berlin, avec les dessins signalés, leur a été favorable; plus tard, nous avons
jugé nous-même de l'identité en découvrantdans ces mêmes dessins quelques-uns
des traits spéciaux au maître, traits qui auraient pu passer inaperçus pour ceux
qui n'en ont pointfait comme nous une étude spéciale. La conviction une fois faite
dans notre esprit, un don précieux de S. M. l'impératrice Frédéric,-dont on
connaît la passion pour les arts duxv° siècle italien,-la collection complète des
fac-similés des dessins du maître, nous a permis d'en détacher ceux qui nous
semblent devoir être restitués à Hercule, ce qui permettra aux lecteurs de les
comparer aux pièces de notre dossier.

Études pour des Lames.
D'après un Album de dessins conservé au Musée des Estampes de Berlin.
(Documents communiqués par S. M. l'Impératrice Frédéric.)
La composition qui fait pendant à celle-ci dénonce la même main et révèle le
même esprit. Le palmier s'élève encore au centre de la composition symétrique;
en haut du tronc l'artiste a suspendu une panoplie formée d'une targe antique
surmontée d'un masque, et deux hallebardes croisées, auxquelles pend un voile
en guirlande. A la base de l'arbre sont amoncelés des cuirasses, des boucliers, des
casques, des haches, des chlamydes foulés par un aigle dont les ailes se déploient
sur un large bouclier. De chaque côté du trophée, deux grandes figures allégoriques, Muses robustes, assises sur des cuirasses antiques et des cnémides, semblent rendre hommage à la Victoire. La première, portant à la main gauche la
palme des triomphes, couronne le trophée; laseconde écrit sur la tablette de l'histoire la devise romaine chère au maître Hercule : S. P. Q. R.
D'autres séries de compositions divisées en bandes étroites semblent autant
d'études pour la gravure au poinçon sur le métal, ou pour des frises. Les sujets
sont toujours empruntés à l'antiquité : ici,les Vestales entretiennent le feu sacré;
là, les prêtres vont procéder au sacrifice et traînent à l'autel les béliers ou le porc
immonde. On remarquera, dans l'un de ces sujets, le bœuf conduit au sacrifice,
qui présente encore des analogies avec le bœuf Borgia ou le bœufApis, si souvent représenté dans les œuvres du maître. Partout les analogies abondent, les
vases destinés au sacrifice sont de même forme ici et là, et la figure de Vénus, dont
le voile flottant affecte toujours la même silhouette, semble échappée d'une des
lames du maître Hercule.
Enfin, nous mettons sous les yeux du lecteur quelques médaillons tirés de la
même collection de dessins, qui sont très caractéristiques, en ce sens que deux
d'entre eux sont des pièces à conviction. Dans le premier dessin à la plume, l'artiste a représenté un char traîné par deux licornes, sur lequel se dresse une figure
drapée portant à la main la palme de la paix; derrière elle, un personnage courbé
semble prendre les rênes. Dans le second médaillon, une femme drapée tenant
d'une main une fleur, de l'autre, un arc(?), s'avance pour porter secours à un cerf
au repos, le corps percé d'une flèche. Deux devises latines, difficiles à déchiffrer,
mais qui toutes deux sontune allusion à chacune deces compositions, sont écrites
au-dessous de chacuned'elles et devaient, dans l'exécution définitive, être gravées
en exergue ou sur la banderole. La feuille sur laquelle ledessinateur a cherché ses
compositions contient douze tondi ou circonférences destinées à enfermer le sujet
cherché. Sept d'entre elles sont restées vides; dans la cinquième, qui n'est
qu'ébauchée, l'artiste a représenté, voguant sur les flots, une barque à voile qui
porte un passager, et, en exergue, il a écrit cette devise : Non vuol sapere a chi
fortuna e contra, variante en langue vulgaire peu correcte du Quos vultperdere,
qui est tout à fait dans le goût des devises du maître Hercule.
Nous sommes ennemis des affirmations hautaines, mais les procédés de reproduction qui sont à notre disposition nous permettant d'opposer aux gravures du
maître Hercule les dessins originaux que nous venons de décrire, et que nous
croyons pouvoir lui attribuer, le lecteur sera juge de la vraisemblance de notre
hypothèse. Ces dernières études de médaillons surtout présentent de telles ana
logies qu'elles laissent peu de place au doute; de telles études ne sont pas faites
pour la peinture; elles n'ont pas non plus le relief propre à la sculpture, et les
inscriptions écrites en légende sont singulièrement affirmatives. Si l'on se refusait
à adopter nos conclusions, il faudrait admettre qu'il y avait, entre 1500et 1524 (car
cette date se trouve au bas des dessins), un artiste qui cherchait les inventions
pour le maître, et celui-ci, qui ne faisait que les traduire le poinçon àla main, se
les serait appropriées. En effet, il faut remarquer que l'artiste signait ses armes
OPVS. HERCVLIS., confondant ensemble le graveur, l'inventeur, le forgeron
d'épées et le sculpteur des beaux fourreaux en cuir repoussé, si fièrement reven
diqués par une belle signature sur la gaine du Musée d'artillerie de Paris.
HERCULE DE FIDELI ORFÈVRE DU DUC DE FERRARE.
En feuilletant le Carteggio encore inédit d'Isabelle d'Este, qui comprend sa
correspondance avec les artistes de son temps, au « Copie de lettres » et dans les
dossiers des lettres elles-mêmes conservées en originaux à l'Archivio Gonzaga de
Mantoue, qui forment une correspondance énorme, nous en rencontrons quatre
relatives à un certain Maître Hercule. Parmi ces quatre lettres, une est de la
main du maître lui-même, elle est adressée à la marquise Isabelle Gonzague,
femme de Francesco Gonzague, seigneur de Mantoue, datée « Ferrare, 4 octobre
1504 », et signée « Servus Hercules Aurifex Illmi Di Ducis Ferrarie. »
Voilà donc un aurifex du nom de maître Hercule, à la solde du duc de Ferrare, qui vit au même temps que le graveur de Borgia. Avançons avec prudence
et voyons si c'est bien le nôtre. Isabelle, fille d'Hercule d'Este comme le duc
Alphonse d'Este, et qui a épousé son voisin de Mantoue, a commandé à l'artiste
des travaux (qu'on ne définit point assez pour que nous soyons encore sûrs de voir
en lui le même personnage). L'œuvre traîne; Hercule ne la livre point, il est
excédé de commandes, et il s'excuse :
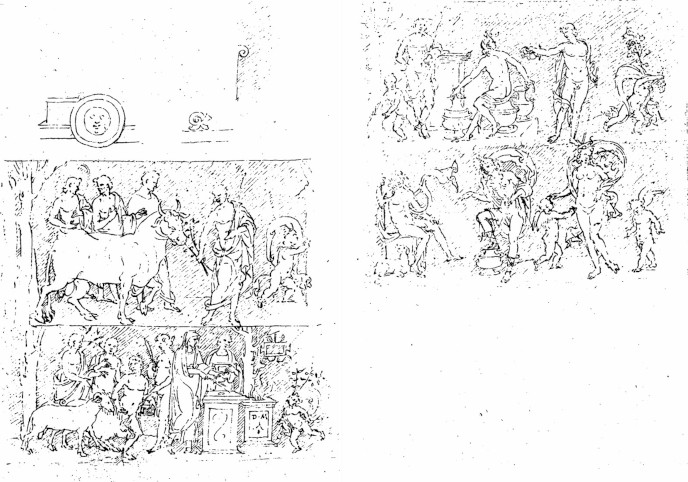
ÉTUDES des LAMES d'ÉPÉE POUR ― Cabinet des Estampes Berlin
1.- Quadri doit, je crois, s'entendre dans le sens de médaillons,peut-être des nielles sertis dans des
filigranes .
Selon moi, Votre Seigneurie peut vraiment s'attendre à avoir là une chose
beaucoup supérieure à celle qu'elle espérait. J'ai vu le dessin d'ensemble et entre l'exécution et
lui, ily a la même différence qu'entre un portrait et l'homme vivant. J'aurai garde de ne pas les
quitter de l'œil; hier soir j'ai fait porter le travail à notre seigneur duc pour qu'il vît à quel
point il en est... Maître Hercule écrit àVotre Seigneurie par la lettre incluse, il écrira sans doute
encore pour informer de la marche du travail .
Ferrare, le 15 Octobre 1504.
Le 11 août 1505 seulement, Hercule a livré la commande; elle est parvenue
aux mains d'Isabelle par l'entremise de Hieronymo Zilliolo, un de ses correspondants de Ferrare, et, par les moyens qu'Isabelle a employés pour les obtenir, on
verra avec quelle impatience elle attendait ses bijoux : il faut dire aussi que
maître Hercule, non seulement avait été lent à la satisfaire, mais, chargé d'une
commande quelques années auparavant, ne la lui avait jamais livrée.
Retenons un autre pointimportant: Hercule,orfèvre du duc de Ferrare, est un
dessinateur habile, puisqu'en exécutant les commandes de bijoux pour Isabelle
d'Este, il a devant lui un projet dessiné avec tant de talent « qu'entre l'exécution
et lui il y a la même différence qu'entre un portrait et un homme vivant. » Or,
nous venons de produire une série de dessins originaux du maître, et on a pu
juger des nombreux points de contact qu'ils présentent avec les compositions
des lames; il ne nous reste donc plus à prouver qu'un fait,
c'est que le graveur
des armes de César et autres, porte non seulement le même prénom que l'orfèvre
du duc de Ferrare, mais que son nom de famille est aussi le même, et par conséquent, qu'il n'y a là qu'un seul et même personnage. A cet égard nous n'avons
jamais hésité, mais il nous manquait le document vainqueur, une arme signée
non pas seulement du prénom Hercule, mais de ce prénom accompagné du nom
de famille ; la conviction néanmoins était profonde et, pour le prouver, nous rappelons ce que nous écrivions autrefois à ce sujet dans notre première étude : « Le
hasard qui nous a fait rencontrer à Mantoue les lettres relatives au maître dont
nous cherchons à préciser les traits, s'il nous avait mieux servi aurait pu nous
livrer sa correspondance avec Alphonse, duc de Ferrare, ou avec François Gonzague, et cette fois, il est bien probable qu'au lieu de descriptions de bijoux,
colliers , boutons ou bracelets , celui qu'on appelait en Italie le vainqueur du
Taro, nous aurait parlé des épées de parement ou des épées courtes qu'il avait
commandées au maître Hercule. »
Nous ne voulons pas insister. Une épée courte ayant appartenu à François
Gonzague marquis de Mantoue, vient de surgir à la lumière; la voici, avec tous
les attributs et les imprese du combattant de Fornoue, c'est-à-direl'Aigle, la Biche
(accompagnée de la devise BID-CRAF pour Wider-Kraft), le Soleil et la Muserolle. Au Vatican comme à Bologne et à Ferrare, l'aurifex auquel nous nous
étions trop pressé de donner jadis le nom d'Hercule de Pesaro, s'appelle HERCULE DE FIDELI , il est à la fois graveur d'épées, orfèvre délicat, dessinateur
habile et sculpteur, aussi fort dans l'ornementation comme arrangement que
dans l'exécution; et pour qu'il ne reste plus de doute à cet égard, nous allons
donner la preuve de notre assertion en produisant sa signature sur une de ses
œuvres.
ETAT CIVIL D'HERCULE DE FIDELI.
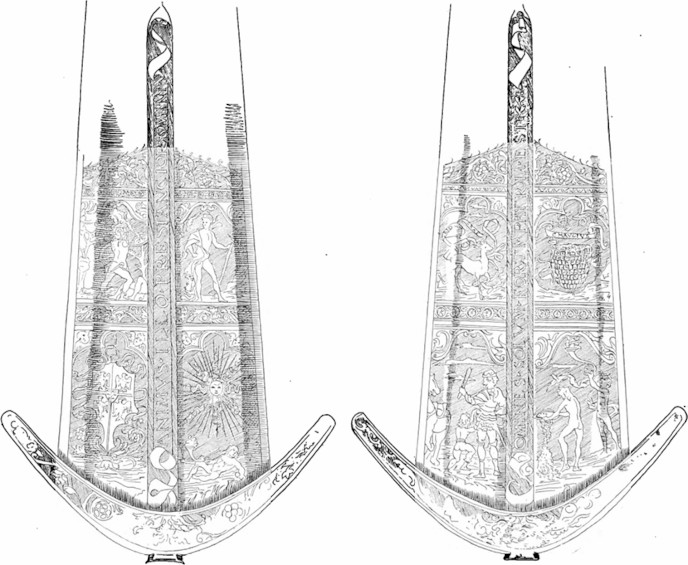
Cinque-dea aux Armes du Marquis de Gonzague (Face).
Cinque-dea aux Armes du Marquis François Gonzague de Mantoue.
(Musée du Louvre)
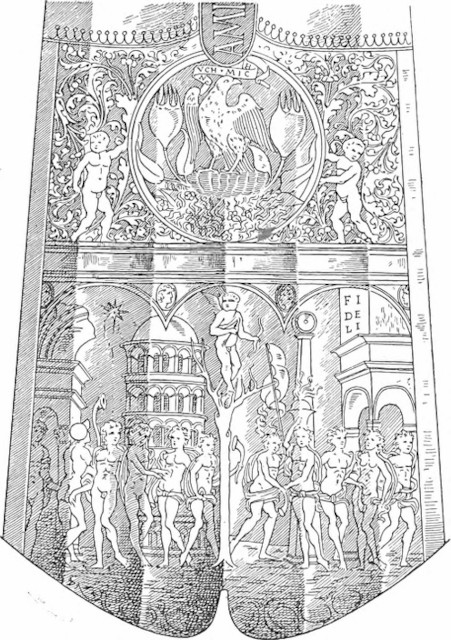
Cinque-dea du Maître Hercule au Musée de Berlin, portant le Nom de Famille du Maître (Fideli).
CONCLUSION.
N'eût-il gravé que l'épée de Borgia, la lame de cinque-dea de la tour de Londres, celle du prince Frédéric-Charles, et quelques autres : le nom d'Hercule
méritait d'être sauvé de l'oubli : son bagage ne peut plus que s'augmenter et sa
réputation ne peut plus que croître. On peut désormais écrire son nom à côté de
celui des Piccinino, des Andrea de Ferrare, des Lazzarino Caminazzi , des
Colombo, et de Serafino de Brescia son contemporain, qui fut armé chevalier par
François Ir auquel il présentait une riche armure sortie de ses mains.
DOCUMENTS A L'APPUI
1.
MCCCCLXXXVIJ. E a di xj di Novembre Lire 6 de Marchexana per sua signoria a
Salomon da Sese Ebreo orevexe controscripto per conto de soi salarij.- (R° entr. usc. di Eleo.
nora d'Aragona, Arch° stato Modena, c. 99).
2.
MCCCCLXXXXJ. E a di xxj de Marzo lire sedexe de Marchª per sua Signoria a Salomon da Sexo, Ebreo, per conto de lavorerj fatti a suó sporto controscritto la chasandra de Chrestovalla dai chapelletti. (méme source c. 223.)
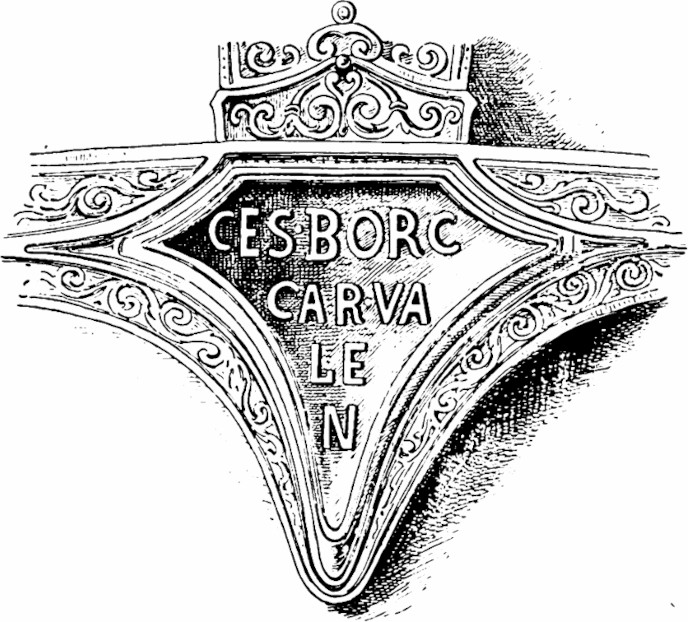
Inscription sur la Fusée de l'Épée de César. (César Borgia, Cardinal de Valence )
TABLE
DU
PLACEMENT DES DIX-HUIT PLANCHES HORS TEXTE
AVEC
INDICATION DES PAGES DONNANT LEUR EXPLICATION
PLANCHES HORS TEXTE
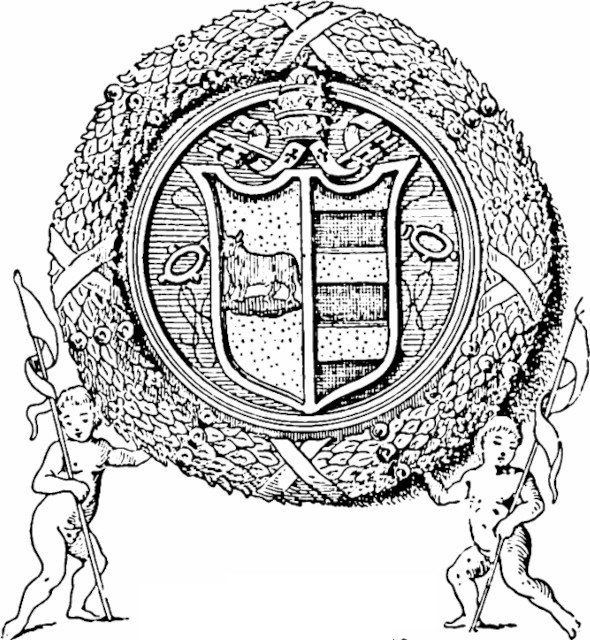
Armes de César Borgia
Duc des Romagnes
D'après un Manuscrit de la Malatestiana de Cesena.
TABLE
DES GRAVURES PLACÉES DANS LE TEXTE
記載日